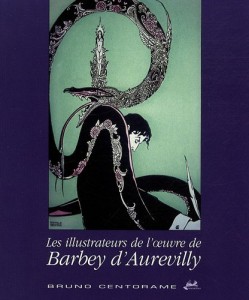Sociologie du mot
 En épigraphe, une citation de Coluche donne le ton : « Un jour, Dieu a dit : “Je partage en deux : les riches auront de la nourriture, les pauvres auront de l’appétit.” » C’est dit : Jean-Louis Fournier ne craint ni la provocation, ni la caricature, ni, bien sûr, un cynisme salutaire qui est depuis longtemps sa marque de fabrique. On retrouve donc avec plaisir, par son dernier opuscule, le créateur d’Antivol et de la Noiraude (si, si!) l’ami et collaborateur de Pierre Desproges, l’auteur de l’excellent Où on va, papa ?, Prix Femina 2008.
En épigraphe, une citation de Coluche donne le ton : « Un jour, Dieu a dit : “Je partage en deux : les riches auront de la nourriture, les pauvres auront de l’appétit.” » C’est dit : Jean-Louis Fournier ne craint ni la provocation, ni la caricature, ni, bien sûr, un cynisme salutaire qui est depuis longtemps sa marque de fabrique. On retrouve donc avec plaisir, par son dernier opuscule, le créateur d’Antivol et de la Noiraude (si, si!) l’ami et collaborateur de Pierre Desproges, l’auteur de l’excellent Où on va, papa ?, Prix Femina 2008.
Les Mots des riches, les Mots des pauvres est hilarant et triste. C’est du Fournier. Du Fournier en vignettes caustiques et percutantes, illustrées dans l’esprit par Jean Mineraud. Quelques sentences définitives :
« En pauvre, chambre d’amis se dit canapé convertible. »
« En pauvre, invitation se dit convocation. »
Ainsi, répondant au questionnement lancinant de la rubrique précédente et de Jean-Loup Chiflet, nous pouvons désormais l’affirmer avec certitude : « En pauvre, Fauchon se dit ED. »
Au-delà de la formule choisie et volontiers acide, les réalités de la misère vraie et de l’injustice quotidienne :
« Pourquoi les salles d’attente sont-elles remplies de pauvres, jamais de riches ?
Monsieur Riche n’a pas le temps d’attendre, parce que tout le monde l’attend. Il lui faut tout, tout de suite. Quand il regarde sa Rolex qui vaut sept ans de salaire de Monsieur Pauvre, Monsieur Riche vérifie que le temps, c’est de l’argent.
Quand il regarde son tarif horaire sur sa fiche de paie, Monsieur Pauvre voit que son temps, ce n’est pas beaucoup d’argent. »
Fournier, qui a connu le vrai malheur, ne connaît pas la condescendance. C’est donc sans hésiter qu’on le suivra sur ce chemin, coup de griffe humoristique à des vérités hélas inchangées.
Les Mots des riches, les Mots des pauvres, Jean-Louis Fournier, éditions Anne Carrière, mai 2009, 147 p., 17 €.
Article paru dans le Normandie Magazine (n° 231, septembre-octobre 2009) 
Gwenaëlle Ledot.
 Un été chez Amette
Un été chez Amette
On ne présente plus Jacques-Pierre Amette, même pas en tant qu’écrivain normand (1) : critique littéraire au Point, il a longtemps voyagé en compagnie choisie : Brecht, Hölderlin, Voltaire… La Maîtresse de Brecht obtient un prix Goncourt surprise en 2003. Depuis, le succès de Jacques-Pierre Amette, critique, romancier, dramaturge, ne se dément pas.L’été 2008, Amette l’a passé dans un village breton : vue sur la mer, prégnance élémentaire. Depuis longtemps l’auteur pressent que l’essentiel est de ce côté. « Lumière forte, horizontale, divine, qui s’étale. Au loin les rochers blanchissent et bouillonnent (…) Bouffée de vents tièdes. »Le flic très spécial du Lac d’or (paru en 2008) était en quête, déjà, de la « fontaine lumineuse » des jours passés. La substance des éléments prend le pas sur les jeux des hommes. Ce Journal météorologique permet à Amette d’aller jusqu’au bout de ses certitudes : «Il y avait autre chose, il y avait autre chose d’irréductible, de fidèle. La terre s’obstinait à durer et persévérer au-delà des regards humains. » (2)
Diariste de l’éternel et de l’élément, Amette se livre dans ce journal si particulier à la contemplation. Y participent Ariane, à la vénusté antique et marmoréenne – et l’Écrivain, visiteur du soir, Swann de circonstance. Les deux compagnons d’Amette ont le goût de tenir leur rôle à la perfection : conversations littéraires et doucement embrumées, visites vespérales pour l’un ; sensualité de muse et jupe vichy pour l’autre. L’écrivain, proustien jusqu’à la plume, « achète une botte d’asperges pour la décrire ». Au-delà des notations subtilement décalées, une amitié empathique s’écrit. Un été chez Amette, c’est un été parfait, anéantissement des contingences, résurgence des nécessités. Une prose poétique à découvrir. En épigraphe, Baudelaire, d’ailleurs : « Le monde stupéfié s’affaisse lâchement et fait la sieste, une sieste qui est une espèce de mort savoureuse où le dormeur, à demi éveillé, goûte les voluptés de son anéantissement. »
Journal météorologique, de Jacques-Pierre Amette, éditions des Équateurs, mars 2009, 153 pages, 16 €.
(1) Jacques-Pierre Amette, in Écrivains de Normandie, numéro spécial de Normandie Magazine, 2007.
(2) Un été chez Voltaire, Jacques-Pierre Amette, Albin Michel, 2007.
Gwenaëlle Ledot
Article paru dans le Normandie Magazine ° 229, mai-juin 2009. 
Sagesse éclectique

L’art difficile de ne presque rien faire, de Denis Grozdanovitch, n’est pas un nouvel hymne à la paresse au bureau. L’oisiveté dont il entretient son lecteur est un art contemplatif, difficile et profond. L’auteur s’efface devant le bruit du monde, le murmure de l’autre, les quelques pistes d’espérance. Le parcours de l’auteur-honnête homme est étonnant : champion de tennis, champion d’échecs, auteur de nombreux ouvrages salués par la critique (son Petit Traité de désinvolture a reçu le prix de la Société des gens de lettres en 2002), « Grozda » s’est fait un art des dissertations profondes et légères sur le tout et le rien, l’existence, le plaisir et le déplaisir de vivre. Il semble ainsi chercher la Voie, un chemin personnel inspiré des philosophies ou religions orientales, au premier rang desquelles le taoïsme. Il laisse résonner en lui la félicité du souvenir comme l’indignation devant le mal quotidien. Avec une humilité d’écriture non feinte, une érudition vertigineuse et une sensibilité universelle : capter l’air du temps, le vent, les feuilles mortes et les âmes mortes. Il chemine en bonne compagnie puisque Gourmont, Lorrain, Tchékhov ou Sebald l’accompagnent. Humanisme sans frontières, humanité, humilité: l’époque nous intime, comme une leçon de vie, de (re)découvrir l’univers Grozdanovitch.

L’art difficile de ne presque rien faire, de Denis Grozdanovitch, éditions Denoël, février 2009, 333 p., 20 €.
Gwenaëlle Ledot.
 Est-ce ainsi que les hommes vivent ?
Est-ce ainsi que les hommes vivent ?
Le dernier roman de Didier Decoin est un aboutissement romanesque autant qu’un immense succès : la vie d’une femme s’inscrit, tragique, dans une réflexion humaniste. À ce titre, l’héroïne, Kitty, prend place près de Babe Ozouf et Sarah MacNeill, silhouettes pérennes dans les mémoires des lecteurs (1).Le roman s’inspire d’un fait divers. Mars 1964 : quelques mois après l’assassinat de JFK, Kitty Genovese meurt poignardée dans le Queens. Dix-sept plaies et une lente agonie. Ce n’est pas la mort sordide d’une très jeune femme qui retient l’attention des journalistes du New York Times, mais la présence physique et l’absence morale des témoins : trente-huit habitants de l’immeuble ont entendu les cris de détresse de leur voisine, et son martyre de trente minutes. Ils n’ont pas appelé la police.L’auteur ne connaît pas le pathos ; le style est épuré et minimaliste. Le roman, àl’issue connue, fait l’effet du meilleur polar. Les points de vue croisés tissent les destins, une tragédie grecque est en marche. Mais aucun dieu n’aurait pu sauver ni condamner Kitty ; son sort dépend des humains, et c’est à ce moment que les humains manquent aussi. Citation d’Einstein en épilogue : « Le monde est un endroit redoutable. Non pas tant à cause de ceux qui font le mal qu’à cause de ceux qui voient ce mal et ne font rien pour l’empêcher. »Au-delà de l’étude psychologique et la « dilution » de la responsabilité, Decoin pose des questions éternelles et nécessaires. La meilleurefiction au service d’une profonde humanité.« Ce fut […] au petit jour que dans ton cœur un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? » (2)
Est-ce ainsi que les femmes meurent ? Didier Decoin, Grasset, février 2009, 227 pages, 17,90 €.(1) Les Trois Vies de Babe Ozouf et La Promeneuse d’oiseaux. Voir la notice consacrée à Didier Decoin dans Écrivains de Normandie, numéro spécial de Normandie Magazine, 2007 : « Celui qui aimait la tempête ».(2) Louis Aragon, cité par Didier Decoin en épigraphe du roman.
Gwenaëlle Ledot
Article paru dans le Normandie Magazine ° 229, mai-juin 2009. 
Une grande famille.
 Rappelons-le, non sans plaisir : Jérôme Garcin est un écrivain normand. Le numéro spécial de Normandie Magazine, Écrivains de Normandie, a consacré, il y a quelque temps, une notice à l’auteur de la Chute de cheval (prix Nimier en 1998), au maître d’œuvre du Masque et la Plume, au critique littéraire du Nouvel Observateur, au spécialiste de Jean Prévost.
Rappelons-le, non sans plaisir : Jérôme Garcin est un écrivain normand. Le numéro spécial de Normandie Magazine, Écrivains de Normandie, a consacré, il y a quelque temps, une notice à l’auteur de la Chute de cheval (prix Nimier en 1998), au maître d’œuvre du Masque et la Plume, au critique littéraire du Nouvel Observateur, au spécialiste de Jean Prévost.

Son dernier ouvrage, Les livres ont un visage, évoque sa famille en littérature. Des visites rendues, des rencontres amicales et admiratives avec Éric Holder, Jonathan Littell, Sempé, d’autres encore. Garcin recueille les réflexions, les confidences et les lectures. Il est question des livres, de tous les livres.L’ouverture de l’opus commence avec d’autres grands, pas tout à fait disparus, et nous fait pénétrer, de façon fugace et frustrante, dans l’intimité de quelques-uns : Paul Morand nous emmène chez Marcel Proust, fait découvrir le champagne tiède, les pommes frites préparées par Céleste, les « yeux orientaux » de l’écrivain. Nous retrouvons Alphonse Daudet, malade et soutenu par le même Proust; Françoise Sagan prenant soin de Sartre vieillissant. Ronde infinie, où les uns croisent les autres, où les nouveaux citent les anciens…Les époques et les genres s’y mêlent avec gaieté et respect: Éric Holder chantonne du Vincent Delerm. Jonathan Littell évoque Kafka. Julian Barnes vénère Flaubert et Mallarmé.L’autre guide de l’ouvrage, dont la présence parcourt les pages en fil d’Ariane, c’est le père de Jérôme Garcin: Philippe Garcin, l’éditeur, l’ami des écrivains, l’initiateur au monde du livre.Des figures se succèdent, étonnantes ou émouvantes: Jonathan Littell, en ange noir, décidément. Patrick Rambaud en sa Normandie : la Manche argentée de Trouville. Julien Gracq se refuse à écrire « le livre de trop » et vit sereinement ses jours de « retraité intégral ». La figure mystérieuse de J.M.G. Le Clézio, éternel voyageur revenu en sa Bretagne. On découvre Gabrielle Wittkop, l’étonnante « vieille dame indigne » ; on redécouvre Régis Jauffret. Garcin redessine la silhouette de Zouc, ses farces grinçantes, son humanité.Chapitre « Un philosophe dans la nuit » : Il s’agit de Clément Rosset, qui prend soudain les traits du Vladimir de Godot. Jérôme Garcin nous rappelle à son œuvre, littéraire et philosophique, forte et désillusionnée. Nous apprenons, par hasard, que l’auteur du justement célèbre Traité de l’Idiotie est normand, lui aussi : « Dehors, une pluie normande n’a pas cessé de tomber sur Paris. Clément Rossé jauge en souriant sa vieille amie. C’est un natif de Carteret, un nageur d’eau froide, un tutoyeur de vent. »
Julien Gracq est mort le samedi 22 décembre 2007: pour tous les amoureux d’Argol et des Syrtes, un phare s’éteint : « On s’enfonce dans le temps comme on fonce dans le brouillard. Nous reverrons-nous ? Je ne sais. » (extrait d’une lettre écrite à Jérôme Garcin en 2004). Julien Gracq est parti, doucement. D’autres restent, d’autres viennent…
Une douce mélancolie illumine ces pages… C’est le monde, et ce n’est plus tout à fait le monde. Plutôt la lumière tiède d’un bureau, le clair-obscur d’une bibliothèque. C’est Jérôme Garcin qui vous invite.
Jérôme Garcin, Les livres ont un visage, éditions Mercure de France, décembre 2008, 234 p., 17 €.
Gwenaëlle Ledot.

Article paru dans le Normandie Magazine N° 228 avril-mai 2009.
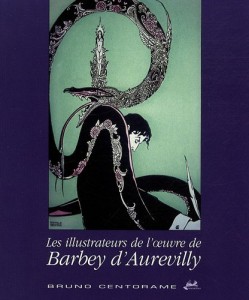 Phares obscurs
Phares obscurs
On s’attend à une nouvelle exploration de l’univers de Barbey, mais c’est un autre voyage que Bruno Centorame nous prépare: une étrangeté inquiétante et familière, une descente dans une époque spirituelle et diabolique, perverse et inventive : Les Illustrateurs de l’œuvre de Barbey d’Aurevilly.
Constat d’une difficulté : « Illustrer un auteur tel que Jules Barbey d’Aurevilly peut sembler de prime abord une tâche difficilement surmontable, tant la richesse et la complexité de l’œuvre du Connétable des Lettres paraissent susceptibles de déconcerter un artiste exigeant… » Barbey a été longtemps classé parmi les auteurs « inillustrables ». Qui, par ailleurs, s’est souvent montré juge sévère pour ses propres illustrateurs…
Combien sont-ils alors, qui ont relevé le gant ?
Félix Buhot vient le premier: c’est un contemporain de Barbey, qui excelle à restituerl’atmosphère aurevillienne. Dès 1878, il livre une interprétation magistrale d’Une vieille maîtresse. Natif de Valognes, « ville adorée » de Barbey, Buhot se plaît justement à restituer les aspects les plus caractéristiques de « son cher petit Valognes ». L’auteur souligne la force expressive de ce maître de la gravure, son trait vif et précis. Les études pour Un chemin de perdition, magnifiquement reproduites dans l’ouvrage, révèlent « sa fidélité à l’esprit d’un certain romantisme noir ». La composition la plus magistrale de Buhot étant, selon Bruno Centorame, la chevauchée nocturne de l’abbé de La Croix-Jugan dans la lande de Lessay : vision spectrale, tourbillon éperdu.
Barbey par Félicien Rops: rencontre extraordinaire! Le jugement de Barbey est savoureux et implacable : « Rops a embourgeoisé le Diable. » Il est, par essence, le Scandaleux de l’époque décadente. Bruno Centorame rappelle justement qu’ « en acceptant que Félicien Rops illustrât les Diaboliques, Barbey fit montre d’une indépendance d’esprit bien dans sa manière. » Rops est un genre à lui tout seul: licencieux, méphistophélique. Il joint magnifiquement et étrangement son univers personnel à celui de Barbey et livre une lecture unique, vertigineuse, tragique, perverse et désespérée.
D’autres viennent alors : Alfred Kubin, dessinateur et écrivain allemand du tournant du siècle. Célèbre pour L’Autre Côté, ouvrage sulfureux et profond, il s’est attaqué à son tour, et à sa manière, au Bonheur dans le crime. La panthère de Kubin s’associe à Hauteclaire : le bestiaire de la Décadence marie sa symbolique visionnaire aux thèmes aurevilliens.
On découvre Donald Denton : c’est la couverture de ce magnifique ouvrage, attractive et fascinante : Ce qui ne meurt pas de 1928, sous l’influence certaine d’Aubrey Beardsley.

Page de manuscrit d'un ouvrage de Jules Barbey d'Aurevilly (Musée de Saint Sauveur Le Vicomte - Manche)
…Et l’on s’en veut de ne pas évoquer les autres, si nombreux, dont les œuvres démontrent brillamment la puissance suggestive des ouvrages de Barbey: Alastair et Ivanoff, dont Bruno Centorame évoque l’univers avec subtilité. Des échos plus proches: Marc Ollivier, Florence Burnouf, Guillaume Sorel, Christophe Rouil…, tous rappelant à nous les vers fameux de Baudelaire:
« Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes,
Ces extases, ces cris, ces pleurs, ces Te Deum,
Sont un écho redit par mille labyrinthes ;
C’est pour les cœurs mortels un divin opium ! »
(« Les Phares » in Les Fleurs du mal)
Les Illustrateurs de l’œuvre de Barbey d’Aurevilly de Bruno Centorame, éditions Isoète, 2008, 138 p., 25 €.
Gwenaëlle Ledot.
Article paru dans le Normandie Magazine n° 228 (avril-mai 2009) 
 Jean Echenoz, prix Goncourt 1999 pour Je m’en vais, vient de publier aux éditions de Minuit un roman biographique sur le coureur tchèque Émile Zatopek : Courir.
Jean Echenoz, prix Goncourt 1999 pour Je m’en vais, vient de publier aux éditions de Minuit un roman biographique sur le coureur tchèque Émile Zatopek : Courir.
Étranges romans où les faits ne sont qu’un arrière-plan, où la vie devient simple décor. Chez Jean Echenoz, les personnages sont les mots. Émile, Chopin ou Salvador passent leur vie glissant, sans fin, sur les phrases de leur auteur.
Doucement ironique, l’écriture s’attarde sur un système velcro et un nez busqué ; volette d’une carte routière à une mouche violette. Un monde s’anime, précis et éthéré, piquant, léger ; un monde d’entomologiste, empli de flux rapides, de courants évanescents. Les personnages sont traversés par la vie, décidément plus forte qu’eux, et traversés par les mots. Habités par une odeur de chlore et un parfum de citron, absorbés éventuellement par une chevelure blonde, croisant des « phosphatines fantomatiques ».
L’ironie est partout présente, délicieuse et fluide ; partout, jusque dans l’existence étrange des Grandes Blondes (1995): « Précipiter un homme dans le vide étant de ces choses qui vous feraient oublier de vous démaquiller ». Le vide cotonneux et doux de la réalité permet toutes les fantaisies de l’écriture : « Donatienne se distingue par le port de vêtements surnaturellement courts et miraculeusement décolletés, quelquefois en même temps si courts et si décolletés qu’entre ces adjectifs ne demeure presque plus rien de vrai tissu. »
Petites bulles en plastique ou bulles de varech, l’écriture soufflée glisse et disparaît. Ses métaphores se multiplient : « Un vent électronique indifférencié, monochrome et lisse, tiède et sourd. » Un titre de roman : « How to disappear completely and never be found ». Ou bien le sommeil encore : « Écharpe grise, écran de fumée, sonate. Vol plané d’un grand oiseau pâle, portail vert entrouvert. Plaines. »
En cet automne 2008, le style d’Echenoz s’est incarné dans un homme, un homme qui court : Émile Zatopek, athlète de légende, est le héros de son dernier roman. Il court, et le style comme lui, épuré, volant vers l’essentiel. Émile, émouvant de simplicité, court sa quête tragique et banale, qui l’emmène ailleurs ; la banalité, toujours affleurant, dément les moments de grâce, les moments de course, de victoire. En contrepoint, l’Histoire, celle de la Tchécoslovaquie de l’époque communiste, la dénonciation et la terreur ignorée de l’Occident. L’amertume et l’obscurité soulevées, peut-être, par la grâce de l’écriture.

Christian Gailly ou la substance de l’absent. Le dernier roman de Christian Gailly est placé, dès l’épigraphe, sous l’égide de Beckett : « C’est tuant, les souvenirs ». Beckett, ou la non-communication érigée en principe dramatique. La folie de ceux qui, intarissables, voudraient, désespérément, converser :
« Toutes les voix mortes
Ça fait un bruit d’ailes
De feuilles
De sable. De feuilles. »
Et, chez Gailly, l’insignifiance érigée en principe narratif. Les personnages n’y sont plus rien ; ils sont là. Tout juste, encore. Les mots aussi s’en vont ; les phrases souvent nominales, peu apparues. La prose tente simplement de concurrencer le Rien. Pas si simple. Ou concurrencer Beckett. Pas simple, décidément. Là est pourtant la gageure : porter des destins parfois tragiques, parfois drôles, toujours accidentés. Il s’agit ici pour deux journalistes, nommés Brighton et Schooner, d’aller à la rencontre d’artistes oubliés du grand public. Des artistes dont, parfois, dans le souvenir, il ne reste rien. Écrire l’histoire de vides qui se succèdent. « Non, monsieur, dit Brighton, ça ne s’appelait pas Les Oubliés, ça s’appelait Que sont-ils devenus ? Mais vous avez raison, monsieur. Oui, vous avez raison. Les Oubliés c’est mieux. Plus parlant. Plus émouvant. »L’un des deux journalistes meurt ; bêtement, bien sûr : « Il ne reste rien de Paul Schooner. La goélette s’est évaporée. »Ce tragique-là est aspiré tout entier par l’insignifiance ; par l’ironie. Celle qui accompagne, en contrepoint délicieux, les trajets perdus de nos Vladimir et Estragon : « Si tu dis non nous risquons d’en mourir tous les trois. Brighton : N’exagérons rien, mais bon, pourquoi pas ? Allons-y comme ça. On verra bien. » On a parlé de la petite musique de Christian Gailly. Je dirais plutôt un bruit de feuilles. De sable. De feuilles…

Un autre écrivain de Minuit, Christian Oster, a publié des ouvrages de littérature de jeunesse, séduisants de vivacité et de fantaisie, et des polars, pour les éditions Fleuve Noir. Ses romans sont salués par la critique, dont Mon Grand Appartement, prix Médicis en 1999.
On évoque volontiers son art de la digression, mais aussi une extraordinaire dilution du temps psychologique qui le rapproche irrésistiblement de l’inspiration proustienne. Les atermoiements des personnages deviennent vite ludiques : « Je mettais rarement mes clés dans une poche. Je les rangeais plutôt dans ma serviette. Mais j’avais, quelque part, oublié ma serviette. Or, jusque-là, je n’avais jamais égaré ma serviette. C’est ce qui m’avait arrêté, devant ma porte. »Le héros de Mon Grand Appartement, aux prises avec la perte conjointe de cette serviette et de sa compagne, la récurrente Anne Lebedel, agace et amuse par ses circonlocutions autant que par son introspection entêtée. Ses tentatives de construire une existence, d’abord velléitaires, font naître quelques dialogues réjouissants : « Tu es marié ?… Non, pas spécialement. Comment ça, pas spécialement ? »Christian Oster évoque une vérité de l’existence, celle qui confine à l’insignifiance et au doute ontologique : « Et encore, elle ne me vit pas tout de suite. Puis elle ne crut pas que ce pût être moi. Je le compris. Elle avait toujours eu du mal, elle aussi, dans son genre, à croire à ma présence. C’est moi, fus-je obligé de dire, pour y croire, moi aussi, à ma présence. »
Le narrateur, qui brille par sa transparence à la vie, affiche la conviction que son existence frôle l’hypothétique. Serge Ganz, le narrateur de Trois Hommes seuls, paru en septembre 2008, porte une identité pareillement vacillante. Cerné lui aussi par la prégnance d’objets résolument insignifiants. Réminiscence de Ionesco peut-être, dont on devine que l’univers n’est pas étranger à celui construit par Oster, une chaise se fait particulièrement encombrante, et accompagne en signe de non-sens absolu le trajet de trois hommes vers la Corse. Le non-choix étant une option permanente pour ces trois-là, le voyage se mue vite en balbutiement affectif et existentiel. Le pari, réussi, de Christian Oster est de maintenir un équilibre de funambule entre une trame narrative légère mais convaincante, et un sentiment de l’absurde qu’il caresse sans jamais lui céder tout à fait.
Courir, Jean Echenoz, éditions de Minuit, octobre 2008, 142 p., 13,50 €.
Les Oubliés, Christian Gailly, éditions de Minuit, janvier 2007, 141 p., 13 €.
Trois Hommes seuls, Christian Oster, éditions de Minuit, septembre 2008, 174 p., 13 €.
Le 15 Janvier 2009, par Gwenaëlle Ledot
 En épigraphe, une citation de Coluche donne le ton : « Un jour, Dieu a dit : “Je partage en deux : les riches auront de la nourriture, les pauvres auront de l’appétit.” » C’est dit : Jean-Louis Fournier ne craint ni la provocation, ni la caricature, ni, bien sûr, un cynisme salutaire qui est depuis longtemps sa marque de fabrique. On retrouve donc avec plaisir, par son dernier opuscule, le créateur d’Antivol et de la Noiraude (si, si!) l’ami et collaborateur de Pierre Desproges, l’auteur de l’excellent Où on va, papa ?, Prix Femina 2008.
En épigraphe, une citation de Coluche donne le ton : « Un jour, Dieu a dit : “Je partage en deux : les riches auront de la nourriture, les pauvres auront de l’appétit.” » C’est dit : Jean-Louis Fournier ne craint ni la provocation, ni la caricature, ni, bien sûr, un cynisme salutaire qui est depuis longtemps sa marque de fabrique. On retrouve donc avec plaisir, par son dernier opuscule, le créateur d’Antivol et de la Noiraude (si, si!) l’ami et collaborateur de Pierre Desproges, l’auteur de l’excellent Où on va, papa ?, Prix Femina 2008.