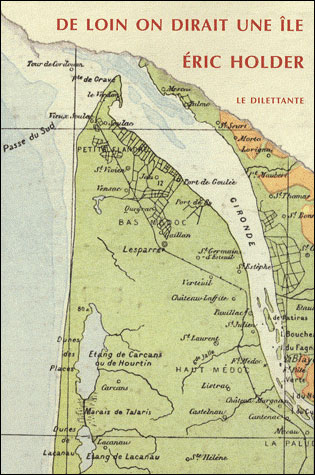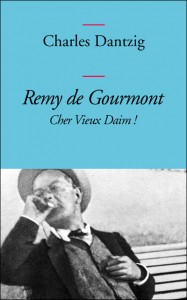La vie comme un songe
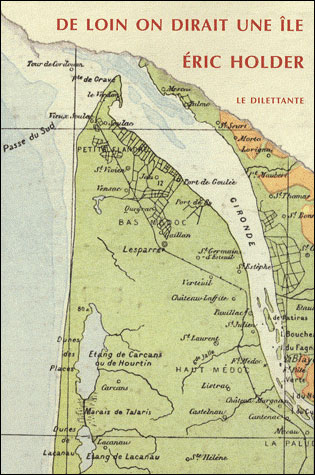
De loin on dirait une île. Le dernier roman d’Éric Holder prend pied tout près de l’Atlantique. Le Médoc est ce pays, qu’un narrateur venu du Nord prend plaisir à découvrir, définir, mettre en mots. C’est un repérage sur une carte : « l’intersection du 45e parallèle et de l’ouest de Greenwich » ; c’est la proximité de l’Océan. Ce n’est que du bleu, sur une page de couverture.
Les ciels de Turner, cités dans les premières pages, appartiennent ici à Éric Holder, qui rejoint son univers délicat et rugueux, atemporel et circonstancié. Un monde à part, salué par la critique, et par les Prix Fénéon, Novembre (pour La Belle Jardinière en 1994) et Roger-Nimier (En compagnie des femmes, 1996). Un monde s’ouvre ici sur l’estuaire de la Gironde, lorsque le bleu laisse place à un rose indonésien, ou à l’indigo d’un crépuscule littéraire.
Dans ce pays nouveau, l’écrivain Éric commence, naturellement, par la cueillette des mots les « mattes », la « maille », le « belou », le « mahoun »… Des hispanismes, des mots gascons, des césures inattendues. Il traque l’étrangeté jusqu’à l’inventer, la susciter, de même qu’il chasse l’Amour local. Les femmes rencontrées, censées toutes figurer la Médoquine, se succèdent jusqu’à l’insignifiance : Ilona la serveuse, Geneviève l’excentrique, Pocahontas la mystérieuse… La Muse du pays se dérobe ainsi à l’écrivain, lui signifiant cruellement l’absurdité de cette quête. Qu’importe, le narrateur s’obstine, et cherche derrière chaque silhouette croisée l’Ange du Paysage; l’ultime ambassadrice, intercession peut-être entre l’Étranger à la terre et l’âme du pays.
Le pays médoquin daigne finalement répondre, récompense l’obstination et découvre un peu de son mystère. Plusieurs rencontres étonnantes balisent le parcours d’Éric : un autre écrivain, « un aède anachronique, un géant doux et colérique »; un retraité qui apprend le grec, et qui lui révèle le sens du latin. Le narrateur apprend ainsi l’art des conversations légères qui, elles aussi, dévoilent leur raison d’être. Les énigmes du quotidien se succèdent. Une femme se découvre, enfin : « On dirait une allégorie de la Littérature. Derrière elle je vais soupirant. »
Cette leçon du Sud découvert manifeste l’abandon programmé du Pays du Nord : « Parce que le Nord, le froid séparent les fleurs de la tige, cristallisent le vrai, fanent le faux. » Le narrateur, sous Midi le juste, choisit donc le faux. Saisir la réalité du Médoc l’amène finalement à la recréation d’un entre-deux, une synthèse chimérique :
« Le panorama pourrait être de Normandie ou d’Irlande, une brise de mer coiffe les oyats, la plage connaît le genre de calme qui précède un débarquement. En bas, après avoir dévalé la pente, on songe plutôt au Sénégal. »
C’est un Médoc intérieur que le narrateur emporte avec lui. C’est le pouvoir du texte que manifeste bruyamment ce voyage dans un entre-deux : à partir de rien, ou si peu de choses, s’érige un pays entièrement reconstruit par l’auteur, tout à la fois démiurge et spectateur de son œuvre.
« Elle est retrouvée.
Quoi ? - L’Éternité.
C’est la mer allée
Avec le soleil. » (1)
De loin on dirait une île, Éric Holder, éditions Le Dilettante, novembre 2008, 190 pages, 16 €.
(1) Arthur Rimbaud, cité par Éric Holder, page 162.
Gwenaëlle Ledot.