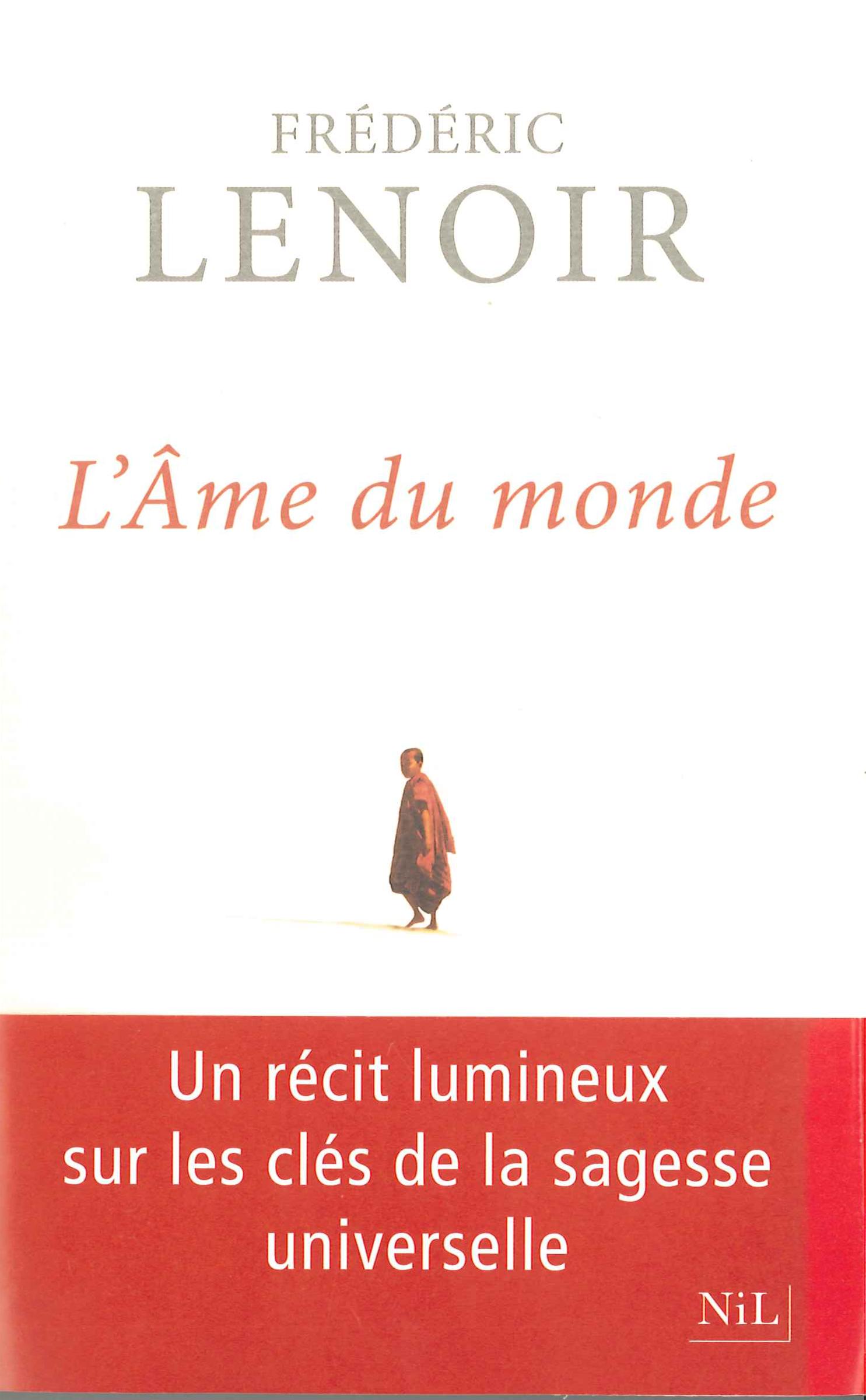« Ah ! Que la vie est quotidienne…»
Dans L’Herbe des nuits, le narrateur prend des notes. Précises, parcellaires ; essentielles et énigmatiques, dans un petit carnet. Lieux, rues et quartiers parisiens : l’Unic Hôtel, les Gobelins, Jussieu, le Luxembourg. Il recense des rencontres de hasard : une femme nommée (peut-être) Dannie et un faux étudiant. Autant de silhouettes esquissées, puis reprises, redessinées, complétées au fil du roman, qui croisent des figures illustres et venues du passé. Car le narrateur tricote aussi des existences littéraires : Charles Cros, Tristan Corbière, Jeanne Duval sont l’autre mémoire parisienne.
Quand ? Peut-être en janvier… Les saisons comme les silhouettes se croisent et se confondent. La mémoire se noie dans une brume bleue, gouttelettes de souvenirs en pluie fine. On imagine Paris nocturne, sous les lampadaires incertains. Le narrateur à la recherche d’une femme, d’un temps recommencé, d’une lumière tremblotante. Une fenêtre éclairée, où peut-être quelqu’un vous attend. Peut-être pas, d’ailleurs.
Au milieu de cette brume bleue, il y a un crime, auquel on ne s’intéresse pas. Le narrateur, lui, note. Garde des preuves de l’existence des gens, des choses. Il y a eu cette femme autrefois, et il y a eu Paris. Quelques petits cailloux de souvenirs qui persistent, résistent, n’empêchant pas cette dilatation étonnante du temps et de l’espace. Un art de mémoire.
L’Herbe des nuits, Patrick Modiano, Paris, Gallimard, septembre 2012.
Gwenaëlle Ledot
 Jolie ma bouche et verts mes yeux.
Jolie ma bouche et verts mes yeux.
« Absurde était le hasard qui nous avait réunis, et bien cruel le marionnettiste qui s’amusait à nous faire trébucher ». Le dernier roman d’Alexis Salatko se lit comme un écho lointain et persistant du mythique Salinger. Il y a là deux individus égarés, l’un et l’autre suicidaires. L’homme, Axel Ribolowski, se définit comme un artiste raté ; elle, Marie-Angélique, a des secrets. Leurs premiers mots échangés, entre la neige de décembre et la bruine du Cotentin, sont surréels.
« La rencontre d’une femme déprimée et d’un homme au bout du rouleau un soir de Noël… »
Cette rencontre initiale fait surgir quelques images autobiographiques et auto-référencées : un balcon au bord du vide, un tigre de papier et Horowitz… Vie et œuvre de Salatko. Jusqu’à sa rencontre fameuse avec le cinéaste Roman Polanski, qu’il met en scène.
L’auteur s’amuse de lui-même, comme « jeune romancier à succès», écrivain naïf en pleine ascension. L’artiste cherbourgeois qui voulait croire (et pouvait écrire sérieusement) que « le crachin c’est du soleil qui mouille ». Le texte aujourd’hui dessine la Normandie en vingt-deux nuances de gris. Un gris velours, gris iodé, où renaissent les brumes de Lessay et L’Ensorcelée, la silhouette de Barbey ; l’atmosphère fascinante et lourde du Cotentin.
Puis la mémoire de son père entraîne le roman de Salatko sur un versant policier, vacillant. L’essentiel est ailleurs, au bord du vide peut-être, où la vie et l’écriture doucement se mêlent.
Le parieur d’Alexis Salatko, Fayard, août 2012.
Gwenaëlle Ledot
18 juillet 2011 13:37
 Plume non recommandable.
Plume non recommandable.
« Existe-t-il d’autres véritables réalisations de nos profonds tempéraments que la guerre et la maladie, ces deux infinis du cauchemar ?
La grande fatigue de l’existence n’est peut-être en somme que cet énorme mal qu’on se donne pour demeurer vingt ans, quarante ans, davantage, raisonnable, pour ne pas être simplement, profondément soi-même, c’est-à-dire immonde, atroce, absurde. Cauchemar d’avoir à présenter toujours comme un petit idéal universel, surhomme du matin au soir, le sous-homme claudicant qu’on nous a donné. » (Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit )
Difficulté d’écrire Céline, d’écrire sur Céline. Haïr l’antisémite, le xénophobe, et célébrer le Voyage au bout de la nuit : « T’ouvres Le Voyage et t’es happé… En trois lignes, Céline est là, il s’adresse à toi, il te parle dans la tête, il s’introduit dans ton système nerveux, il te raconte son histoire qui devient ton histoire, si tu t’avises de lui résister, il t’écrase du talon… »
Alexis Salatko écrit Céline’s band, roman biographique captivant, sur une vie dévorée et errante. « Céline, es-tu là ? » Dans une existence vouée à l’écriture, retracer l’un des cercles de l’Enfer…
« L’écriture le rongeait. Au fond, il n’y avait que ça qui comptait, les mots, les visions qu’il portait sur le papier avec infiniment de patience et de souffrance, tournant le dos à tout ce qu’il aimait. »
Salatko devient chasseur d’apocalypses. Style étincelant au service d’une sombre épopée. Pose la question implacable, primaire : « Pourquoi Céline avait-il si mal tourné ? » Fouille la question lycéenne, naïve, lancinante : « Comment l’écrivain du vingtième siècle qui avait le mieux parlé de l’homme du vingtième siècle pouvait-il passer pour le pire des hommes ? »
Et martèle l’interrogation des lecteurs de Céline, devant l’horreur du pamphlet Bagatelle pour un massacre. L’incompréhension devant cette diatribe hallucinatoire et haineuse. Irrécupérable, irrattrapable.
Signe d’un mal d’époque ? Alliance hideuse et banale de la littérature et du Mal absolu :
« Ruée frénétique de l’art vers le giron totalitaire. Le surréalisme au service de la Révolution. Eluard chantant Staline en alexandrins. Aragon célébrant la Tcheka. Antonin Artaud dédiant ses Nouvelles Révélations à Hitler. »
La cécité idéologique des artistes : criminelle, impardonnable, humaine.
Accepter ce paradoxe ; le disséquer à l’infini, comme le fait Salatko. Le creuser et fouiller sa chair, au scalpel. Comme le faisait Céline :
« Quand on sera au bord du trou, faudra pas faire les malins nous autres, mais faudra pas oublier non plus, faudra raconter tout sans changer un mot, de ce qu’on a vu de plus vicieux chez les hommes, et puis poser sa chique et puis descendre. Ça suffit comme boulot pour une vie tout entière. » (Voyage au bout de la nuit)
Alexis Salatko, Céline’s band. Editions Robert Laffont, mai 2011. 18 euros.
Gwenaëlle Ledot.
« Il est temps de lire Alexis Salatko. » (1)

Horowitz et mon père, chef-d’œuvre d’Alexis Salatko publié en 2006 chez Fayard, a été récompensé par le Prix Jean Freustié et le Grand Prix Littéraire de la ville de Caen. En 2008, l’auteur fait le choix d’un long récit, tout entier consacré aux fileurs d’or, moufletiers, marcheurs de pâtes et hommes de four : une fabrique de porcelaine en 1847. Ville de porcelaine, ville de bourbe, Limoges y apparaît, médiévale, laborieuse et alcoolisée. L’itinéraire de Marc Dubreuil nous est conté par sa fille China, dont l’histoire s’entrelace à la sienne. Une rencontre, qu’on dirait rêvée, avec Camille Corot change le destin de l’enfant chétif. Le peintre, « voleur d’ombre et de lumière », donne à Marc la force d’échapper à l’enfer de la tannerie et à son bourreau Sophocle, surnommé Le Cyclope : dernier avatar de tous les Rois des Aulnes qui parcourent en prédateurs l’œuvre de Salatko. « Le privilège des bâtards n’est-il pas de pouvoir se choisir un père parmi les hommes que le hasard place sur sa route ? »
Le monde terreux de Marc voit se détacher soudain la finesse des fils d’or. Initié aux couleurs des maîtres chinois et aux contrastes de Rembrandt, Marc affine son art et devient le « peintre-fleur ». Son épouse Luna se fait muse orientale, China à son tour convoque Botticelli et Ruysdael. Jusqu’à la « mort en pleine vie » de Marc Dubreuil, l’on voit Salatko poursuivre en trait filigrané sa rêverie maîtrisée sur la création, art et artisanat. « Harmonie des mouvements, expression de la réalité, concordance des tonalités, respect de la composition, copie des grands maîtres. » Fresque romanesque, dit-on ? Art poétique sans nul doute.
Alexis Salatko, China et la grande fabrique aux éditions Fayard, janvier 2008. 20 euros.
(1) Patrick Besson dans l’hebdomadaire Marianne, à propos du roman Horowitz et mon père, publié en 2006 chez Fayard.
Gwenaëlle Ledot
Captation

Au cœur de ce livre, il y a des pages bleues vers lesquelles on va, en un premier mouvement. Une déclaration absolue faite par l’auteur à une femme aimée.
Dans ce livre, l’enjeu sérieux est d’attraper le bleu, l’éclat du diamant, la lumière du monde. Fuir l’attrait de la mélancolie et capter un soleil éclatant : « Nous avons, vous et moi, un Roi-Soleil assis sur son trône rouge dans la grande salle de notre cœur. Et parfois, quelques secondes, ce roi, cet homme-joie, descend de son trône et fait quelques pas dans la rue. C’est aussi simple que ça. »
Ce livre comme un pari : le bleu en majesté chassera la mélancolie. Il faudra saisir au fil des pages les vrais éclats de beauté et d’amour, rares. Ce qui rapproche de l’éternel. « Explosions intérieures, non décidables ». Aussi l’auteur nous parle-t-il de la musique et des fleurs ; de Glenn Gould et d’un paradis blanc ; de Dante, et d’un animal aussi.
« Les gitans, les chats errants et les roses trémières savent quelque chose sur l’éternel que nous ne savons plus. »
Car le secret est dans le regard autant que dans le monde vu : capter l’essentiel signifie adopter des yeux différents, pour un moment privilégié et bien sûr éphémère ; Christian Bobin les appelle « les yeux d’or ». Dans les courbes du texte se dessine un crescendo, l’écriture s’envole comme un Hallelujah païen.
Pas de mièvrerie, pas de naïveté. Ni l’auteur ni le lecteur n’oublieront la souffrance et le sang. Parfois la couleur des fleurs sera bue par l’ombre. Le sang des vivants disparaîtra. Il y aura des pleurs, de toutes couleurs. Des mains rougies de criminel.
Mais sous l’obscurité l’artiste tire le fil d’or, l’écriture qui invoque l’éternel.
Christian Bobin, L’homme-joie, éditions L’Iconoclaste, août 2012.
« Les fleurs sont les premières gouttes de pluie de l’éternel. »
Gwenaëlle Ledot.

« A Amélie Nothomb.
… Oui, je sais, vous vous en fichez. »
Don Elemirio Nibal y Milcar pourra-t-il rivaliser avec Prétextat Tach ? Angoissante question qui saisit le lecteur assidu d’Amélie Nothomb en cette fin du mois d’août. « Un lecteur est un sac de phrases », écrit Charles Dantzig. Par les charmes de l’auteur fécond, le lecteur est devenu un sac de noms. Véritable Robert des noms propres.
Août 2012 : la nouvelle héroïne d’Amélie se nomme Saturnine Puissant. A vingt-cinq ans, elle est, selon son admirateur, belle comme une créature de Khnopff.

Des caresses, ou l’Art, ou le Sphinx, 1896, Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles.
Don Elemirio lui propose une colocation à un prix modique, dans un univers luxueux : lit douillet, marbre chauffé, champagne à flots, cristal de Tolède.
Au milieu de tout ce luxe, il y a une chambre noire. Interdite parce que. Barbe bleue, donc. Saturnine prend un risque évident, celui de la littérature : il est contenu dans le titre. Risque d’y entrer par curiosité, comme toutes les femmes du conte, risque d’y entrer par distraction (ah bon ?), risque d’y entrer par goût. Du risque.
« Si vous entriez dans cette chambre, je le saurais et il vous en cuirait. »
Mais Saturnine le clame haut et fort : ce n’est pas son genre. La curiosité n’est pas le propre d’une Saturnine, pas plus que d’un Saturnin ou d’un Robert. Dont acte.
Le duel commence donc : Saturnine – jeune, mais pas naïve ; femme, mais pas curieuse ; belge, et non française, elle y tient - contre l’aristocrate espagnol. Don Elemirio semble un homme banal, de prime abord. Capable de cuisiner des omelettes intimidantes et des anguilles sous roche, mais tout de même. Paraît bien loin d’égaler Barbe bleue et Prétextat Tach.
La joute verbale qui s’engage, savoureuse, portera sur des sujets aussi divers que les mérites méconnus de l’Inquisition et l’hérésie du champagne rosé. L’essence théologique de l’œuf. La métaphysique du jaune. J’en passe, bien sûr.
Fil rouge du roman : Saturnine, incarnation de la sagesse humaine, peut-elle tomber amoureuse « d’un malade mental, d’un homme infatué, d’un être parfaitement biscornu ? » Voire d’un assassin ? … Il serait bien regrettable de se refuser un tel plaisir de lecture, surprenant et dense jusqu’à la dernière goutte : tout de savoureuse finesse, les mots pétillants d’Amélie Nothomb.
Barbe bleue, d’Amélie Nothomb, Albin Michel, août 2012.
Gwenaëlle Ledot.
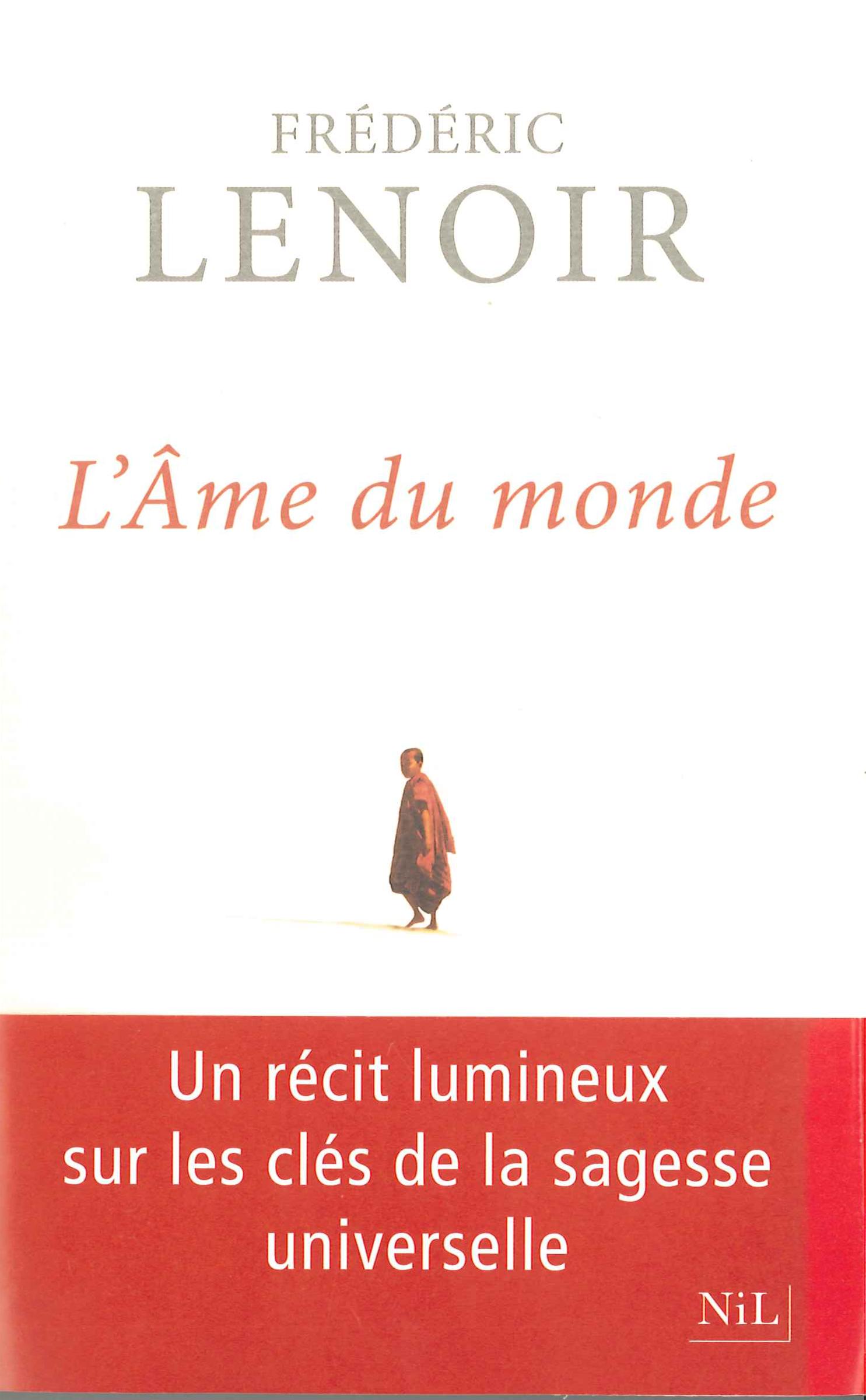 Les voix du GPS
Les voix du GPS
Les voix (voies ?) du GPS sont impénétrables : un sage chinois, maître Kong, découvre un jour sur son écran des coordonnées mystérieuses : latitude et longitude du sanctuaire de Toulanka. Cet appel aussi énigmatique qu’inattendu le convainc et il décide de rejoindre ce monastère tibétain. D’autres sont appelés : une philosophe néerlandaise, une mystique hindoue, un rabbin kabbaliste juif, un maître soufi musulman, une femme chamane, un moine chrétien, un maître du Tibet… Huit sages, représentants des principales traditions philosophiques et des grands courants spirituels du monde sont ainsi réunis.
Frédéric Lenoir n’avance pas masqué : de la part du philosophe, historien des religions, on s’attend à une fable, des paraboles, un petit vadémécum de sagesse pour les nuls… Ce que le titre du chapitre 4 semble confirmer, façon conte philosophique : « Une source, un éléphant et une montagne ».
L’intuition d’une source commune s’impose à eux : celle de la vie et de l’amour. A partir de ce commun identifié, les sages développent deux images illustrant leur quête : l’éléphant symbolise la fragmentation possible de la sagesse universelle. La montagne montre l’importance de la quête elle-même : c’est le cheminement qui compte, non le point d’arrivée. Convaincant.
Quelques songes terrifiants catalysent l’énergie spirituelle des huit sages et leur permettent d’identifier clairement le but : « formuler ensemble les fondements universels de la sagesse » (assorti d’ailleurs d’une gageure : « dépasser nos différences »).
On demeure en revanche surpris (déçu ?) par la représentation de la pensée laïque : la philosophe qui censément la porte est spinoziste, ce qui donnera : « Dieu se confond avec la Nature. […] Il est une force impersonnelle qui demeure en tout être et apporte son harmonie au monde. » Aïe ! Dieu si vite de retour ? Plus loin il sera question de « l’énergie spirituelle qui maintient en harmonie la Nature ». Hem ! Laïcité molle, à tout le moins…
Cet obstacle digéré, le reste coule de source, et se lit avec grand plaisir. Impression délicieuse de syncrétisme où l’on retrouve, sur le chemin : « Deviens ce que tu es » (mais qui a dit… ?) « Tout dans le monde est soumis au changement. » (qui encore ?) « On ne naît pas libre, on le devient. ». « Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu’il te fasse… »
Sept points principaux seront développés, qui résument « l’essentiel de la sagesse humaine ». Apprendre à vivre est nécessaire, car « nous sommes seuls, nous sommes nés seuls et nous mourrons seuls… » Par la voix des sages on rencontrera Socrate, Héraclite, Bouddha… On est en bonne compagnie, et Frédéric Lenoir un narrateur fort plaisant. Idées fortes, nécessaires. Anecdotes souriantes et judicieuses. Humanisme chaleureux.
Ce petit trésor ainsi rassemblé, de manière digeste, demeure jusqu’à la fin un vrai plaisir de lecture. Séduisant quand on ne l’attend pas, dans ses questionnements incarnés : et continuer à espérer lorsqu’on a tout perdu.
L’âme du monde, de Frédéric Lenoir, éditions Nil, mai 2012.
Gwenaëlle Ledot.
 Poétique de la carpe
Poétique de la carpe
Le dernier roman de Jacques-Pierre Amette est la petite histoire d’un journaliste : envoyé à Rome fin mars 2005, pour « savoir ce que pensaient les Romains de ce pape polonais. L’article de six mille signes environ devait donner l’ambiance de la ville, sa ferveur. »
L’écriture de l’article s’associe au voyage amoureux ; le journaliste est accompagné par Constance : elle-même reflet d’Italie, promesse de vie douce et d’enivrement… Glycine et rayons, poussière lumineuse, terrasses d’or deviennent le cadre idéal de la liaison romaine.
Eau tiède de Rome, mortifère : au-delà du « pétillement romain » subtilement peint par Amette, l’eau de vie devient marais, marécage. Si l’homme amoureux tente de posséder sa mystérieuse compagne, c’est encore et en vain… De l’importance de ne pas être constant.
Les reflets aquatiques se font ondoyants, obscurs. Un été chez Voltaire, autre roman d’Amette, se rappelle au souvenir nostalgique : « Elle baignait parfois dans le vide énigmatique du ciel, parfois grinçait, et pivotait sur un impalpable reflet. Elle pénétrait dans l’obscurité. Elle tournait sur les ondes, perdue dans les zones troubles d’un étang formant miroir. »
La thématique de l’eau porte donc son ambivalence. Que restera-t-il au journaliste ? La vacuité d’une gloire éphémère ? L’impuissance qui guette le don d’écrire ? Le mutisme possible et une menace sur l’amour.
Survit, simplement, une poétique des éléments. Ironie tranquille qui balaye toute vanité humaine :
« Il y avait autre chose, il y avait autre chose d’irréductible, de fidèle. La terre s’obstinait à durer et persévérer au-delà des regards humains. »
Liaison romaine, de Jacques-Pierre Amette, Paris, Albin Michel, mai 2012.
Gwenaëlle Ledot.
 Peintre de la vie moderne
Peintre de la vie moderne
« Life is a bitch, and then you die » (proverbe anglais)
Notre époque (postmoderne, hype, bio, numérique, twitteuse, infantile, inculte et dérisoire) se dessine sous la plume aguerrie de Pascal Fioretto. L’auteur croque avec gourmandise (et l’élégance du maigrichon) quelques figures alphabétiquement ordonnées : l’Adulescent, l’Artisan, l’Arty, le Blogueur, le Cadre… Morceau choisi : la visite de l’artisan.
« A la torture physique (la radio calée sur Chéri FM et la trépigneuse hydraulique à mèche titane qui fait sauter les plombs), l’artisan ajoute volontiers la culpabilisation : « Ouh là là ! Mais ça fait combien de temps qu’il a pas décolmaté le réinjecteur ? » et la punition humiliante : « On a un problème pour aléser le rivet de sertissage de la vrillette du chauffe-eau : vous allez rester trois semaines sans manger ni vous laver. »
Les portraits défilent, irrésistibles, jubilatoires : si donc le sourire peut sauver du désespoir, Desproges est vivant. Même verve, même justesse dans l’instantané (numérique, bien sûr).
« La sagesse populaire oppose couramment le cadre du privé, payé avec notre argent, et le cadre du public, payé avec nos impôts. Mieux rémunéré, le cadre du privé peut s’offrir une maîtresse à talons hauts et un infarctus foudroyant tandis que le cadre du public doit se contenter d’une secrétaire en arrêt maladie et d’une dermite chronique. Dans l’Eurozone, les espèces les plus courantes sont le cadre exploité, le cadre surbooké, le cadre stressé, le cadre pressuré, le cadre harassé, le cadre séquestré, le cadre suicidé et le jeune cadre. »
Lettre à lettre, Fioretto devient le chantre du Blues des aires d’autoroute, le rhapsode des retours en RER, le ménestrel des abonnements au Gymnase club et des open space… Douce petite musique de l’ère moderne: on-line shopping, speed dating, fast divorcing…
Sélectionnons dans ce Petit dictionnaire énervé, et par snobisme pur, l’entrée « Weltanschauung » : « Plus mes cheveux tombent, plus ma Weltanschauung s’éclaircit. A croire que c’était ma frange Jean-Louis David qui m’empêchait de bien voir les trucs importants. »
Désenchanté et désabusé, d’une ironie tranquille, l’auteur suit son temps. Une certitude : l’écriture sauvera tout cela.
(Marco aussi, peut-être.)
Nos vies de cons, Petit dictionnaire énervé, de Pascal Fioretto. Editions de l’Opportun, 2012.
Gwenaëlle Ledot.
 Noli me tangere.
Noli me tangere.
Une problématique universelle portée par Camille Laurens se déploie dans ce flamboyant ouvrage d’art et d’histoire : l’éternel féminin, en origine du monde et origine du mal ? Une interrogation déclinée sous forme picturale et littéraire, de l’Antiquité au vingt-et-unième siècle : d’Eve à Lilith, projections fantasmatiques et provocations existentielles questionnent naissance, mort, destinée humaine :
« La Femme ?
J’en sors,
La mort
Dans l’âme… »
Fin de siècle et peinture décadente multiplient les provocations : femme-serpent (de Franz von Stück), femme chauve-souris (Pénot), femme-araignée (Kubin). L’horreur du féminin, à son comble, a rarement été aussi explicite : le danger est palpable, mis en images et en mots. Les mystères supposés et les menaces sourdes sont métaphorisés et peints : allégories de Félicien Rops, sonnets de Baudelaire façonnent une créature projetée par le désir, captivante et mortifère.
L’enquête de Camille Laurens requiert de croiser Simone de Beauvoir aussi bien que Freud ou Virginie Despentes : comment expliquer ce rapprochement peint, écrit, sculpté, entre la femme et l’élément primitif ? L’être animal ainsi associé au féminin semble « hanter l’imaginaire et les représentations depuis l’Antiquité, et ses avatars sont innombrables ».
Judith et Salomé entrent dans une danse séduisante et macabre. Puis Dalila, Circé, Morgane. Femme-sirène chez Chagall. Sabbat des sorcières chez Goya. La fille terrifiée devenue femme terrifiante, stigmatisée par une peur ancestrale et un rejet primitif. La danse continue : de Mérimée à Bukowski, la femme est ensorceleuse, et l’ensorceleuse vouée à la mort.
« L’homme se défend contre la femme en tant qu’elle est source confuse du monde et trouble devenir organique. » résume Simone de Beauvoir.
Captivants trésors iconographiques, enchantement irrésitible de formes et de couleurs, qui cachent une vraie misère idéologique : identification hâtive de ce qui peut être « l’Autre » (Autre de l’homme ? Autre de l’humain ?), rejet, angoisse et condamnation.
Les Fiancées du Diable. Enquête sur les femmes terrifiantes, de Camille Laurens. Editions du Toucan, 2011.
Jules Laforgue
Gwenaëlle Ledot

Âmes envolées
L’écriture subtile de François Cheng est portée par le souffle puissant de l’épopée ; cette limpide polyphonie aura un titre chantant : Quand reviennent les âmes errantes. Au troisième siècle avant J.-C., l’ « Empereur inaugural », Zheng, réunifie la Chine et construit un vaste et nouveau royaume, régi par un ordre implacable.
« Orgueil, ambition, ivresse du pouvoir absolu, tout cela habite l’homme, le pousse à la folie. L’humain devient inhumain, et l’inhumain monstrueux. »
Dans le chaos et la guerre, dans l’assassinat et la torture, naît et croît le nouvel empire.
En pleine tourmente de l’histoire, trois êtres se rencontrent, se découvrent. Une valse d’amitié et d’amour emporte Chun-niang, la belle, « fine fleur de la terre du Nord » ; l’artiste, Gao Jian-Li, joueur de zhou et le guerrier Jing Ko.
Histoire d’amour et de mort, où François Cheng fait passer, fleur translucide, l’âme chinoise. Où l’auteur trace un roman comme une calligraphie. Où le lecteur pense comprendre, douce présomption, le Yin et le Yang, le dragon et le lotus, la montagne du Nord peut-être…
Livre comme un trait de plume, une porcelaine peinte. « Chante, Muse, la colère d’Achille… » Trois voix s’élèvent et deviennent prières face à la peur, et face au gouffre : l’élégance amoureuse de Chun-niang, le courage éperdu de Jing Ko, l’art sacrificiel de Jian-Li. Un chant ascensionnel aura le dernier mot.
Car si Chun-niang est seule, les âmes la rejoindront :
« En cette nuit terrestre, dans l’affreuse solitude, je vois : les âmes perdues seront étoiles filantes. Les âmes aimantes, elles, seront étoiles aimantantes et aimantées ; elles formeront constellation. »
Pari éternel et renouvelé du poète, du rhapsode ou du calligraphe : sur le limon, faire s’élever le chant des âmes. Point d’âmes errantes, finalement ; mais l’aspiration vers l’infini, par l’art, l’amour et l’amitié ; trois étoiles dans un autre ciel.
Quand reviennent les âmes errantes : drame à trois voix avec choeur, de François Cheng, éditions Albin Michel, avril 2012.
Gwenaëlle Ledot