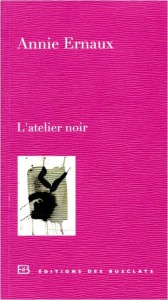Mémoire de fille, d’Annie Ernaux 
Qu’est-ce que la mémoire et qu’est-ce qu’une fille ? Saisir un fantôme, peindre une silhouette, attraper une « sylphide au fond de la coulisse » (1) ? Et creuser sans relâche, questionner un passé violent, interroger sans limites l’essence d’une fille qu’elle a (peut-être) été. L’objet du texte est explicitement réflexif, puisqu’on construit une identité par l’écriture. Quelle est la possibilité de comprendre ce qu’on a été un jour ? Quelle possibilité de l’appréhender par les mots ?
De quoi est constituée cette fille de 1958 ? Les données sociologiques et psychologiques sont vite survolées ; ce sont des images gravées par la souffrance qui vont donner l’élan au texte. Elles n’existeront que par les mots qui les informent. Car « l’autre fille » torture de la pâte à papier pour en exprimer une parcelle de vérité.
« Horloge ! Dieu sinistre, effrayant, impassible… »
Que se passe-t-il au moment où « la fille » cède aux avances d’un quasi-inconnu ? Qui est-elle lorsqu’elle se laisse emporter par la volonté d’un Autre ? Où est-elle lorsqu’elle abdique son être et sa conscience ? L’auteur décrit une « fille de chiffon », prisonnière de son désir confus et du désir émietté d’autrui : « Il m’est impossible de saisir tous les glissements, la logique, qui l’ont conduite à l’état où elle se trouve. » (2)
Elle est donc celle qui disparaît sciemment, pour explorer (peut-être) un anéantissement prévisible, et plonger au fond du gouffre. Elle est celle, aussi, constituée déjà de morceaux textuels : poèmes de Prévert et de Laforgue, phrases de Proust ou de Gide mémorisés. Elle est un nom (Annie Duchesne), mais ce nom pourrait être un autre (Duménil), et plus tard ne sera plus le sien.
Lorsqu’elle se cherche dans les autres du passé, quelques camarades de 1958, ceux-ci ont disparu (même sur Google). Il reste quelques scènes, monstrueusement distendues, tandis que d’autres « ponts » de la mémoire se sont absolument effacés. Caprices du souvenir.
La saisie et la construction du moi par le texte restent eux-mêmes frappés d’insuffisance et d’impuissance : « Il manque toujours ceci : l’incompréhension de ce qu’on vit au moment où on le vit, cette opacité du présent qui devrait trouer chaque phrase, chaque assertion. » (3)
Et encore ce déséquilibre vertigineux : qui étions-nous dans le regard des autres ? Que reste-t-il de nous dans leur esprit ? Ceux qui ont envahi et habité notre âme pendant des années nous ont mystérieusement balayés. Distorsion de la durée, disproportion des impacts.
« Le jour décroît ; la nuit augmente, souviens-toi ! »
Mais une phrase paradoxale écrite par la fille du passé, retrouvée dans les pages d’un journal, semble livrer la clef du récit, sinon la clef d’une vie : « Je ne suis pas culturelle, il n’y a qu’une chose qui compte pour moi, saisir la vie, le temps, comprendre et jouir. » La fille rend compte par anticipation de la lutte acharnée, parfois violente, menée par l’auteur pour saisir avec de l’encre quelques paillettes d’existence.
« Le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. »
Mémoire de fille, Annie Ernaux, Gallimard, mars 2016.
Gwenaëlle Ledot.

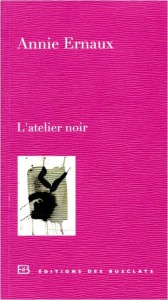



 Le bruit que fait le bonheur en partant
Le bruit que fait le bonheur en partant
Le bruit du texte, comme une célébration : mot à mot, Jean-Louis Fournier dessine le portrait de sa femme, brutalement décédée, aujourd’hui disparue. Des petites touches, qui veulent dire la vérité du sentiment, de la souffrance et du souvenir. Des souvenirs qui collent, une image qui reste, têtue. Une exigence qui s’impose. Le texte traque l’expression juste, parce qu’il y a là une nécessité : rendre l’hommage de la vérité à une silhouette lumineuse.
« A toi qui es devenue entièrement légère. Tu es maintenant impondérable. Tu ne ferais même pas osciller l’aiguille d’un pèse-lettre.
Tu es en apesanteur, légère comme un nuage, une buée, un parfum, un souvenir… »
Le souci obstiné de dire vrai, tout en finesse aussi : la plume comme une harpe. Délicatesse et politesse du désespoir. « Il est poli d’être gai », rappelle Voltaire en épigraphe.
« Je n’ai jamais pleuré, je crois, quand tu es morte. J’ai envie de dire que j’étais trop malheureux, et les larmes paraissaient dérisoires. Je pleure seulement au cinéma, parce que c’est du cinéma. »
Le chemin qu’on fait, nécessaire. La tempête de la douleur sur une existence prostrée. Puis l’idée qu’on va malgré tout, étrangement, continuer. Et comment ? En demi-teinte sans doute, cette âme qui survit :
« Mes souvenirs continuent à briller comme les étoiles mortes. Le passé me semble parfait, le futur pas très sûr. Je préfère conjuguer l’irréel du présent. »
Veuf, de Jean-Louis Fournier. Stock, 2011. Livre de poche, février 2013.
Gwenaëlle Ledot.
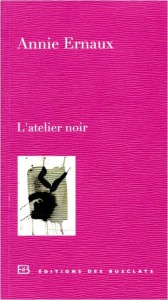 Plus que la vie.
Plus que la vie.
Recueil rose pour l’œuvre au noir… Annie Ernaux expose et explore un “parcours d’hésitation”, ainsi nommé « corps à corps avec l’écriture ». L’atelier noir rend palpables la durée, la souffrance, la quête des mots et des formes. Une réflexion incarnée et physique, sur l’écriture et par l’écriture.
Un chemin balisé de phares littéraires, Peter Härtling, Flaubert, Proust… dont elle jauge et questionne l’œuvre : « Proust, c’est assez lourd, mal écrit parfois, ennuyeux à hurler, ou dérisoire, mais la beauté, l’importance, viennent de la recherche, du projet de connaissance, qui de ce fait a transformé l’histoire de la littérature. »
Eviter la littérature ? Paradoxe ultime soutenu depuis longtemps par Annie Ernaux, qui revendique d’écrire « en-dessous de la littérature » ; « écrire pour faire advenir un peu de vérité. Mais que cette vérité ne soit pas advenue seulement pour une élite ». Cette vérité est exigée par l’auteur, extirpée au monde qui l’entoure et à sa chair même. « Dire le monde, et pourquoi. »
Ecriture au couteau, où la vérité s’arrache par lambeaux. Jusqu’à dissolution du moi, s’il le faut : « Or, quand j’écris vraiment, je m’aperçois que je n’ai pas de moi… »
Et, pendant ce temps même, atteindre le plus intime…

L’icône de L’atelier noir est une œuvre picturale, qui hante le projet : L’anniversaire de Dorothea Tanning. Figure de femme, transfigurée par l’art, mais aussi vecteur de l’art ; corps sacrificiel et néanmoins triomphant.
De jour en jour, mots en mots, le projet d’écriture d’Annie Ernaux éclot et se ramifie en plusieurs feuillets, plusieurs volets : d’abord, le récit de la « ville-nouvelle », ville de banlieue. Il s’agit de Cergy. Il y aura Journal du dehors en 1993 et La vie extérieure en 2000. Cergy sera « la coulée froide » de l’écriture.
Plus tard, l’auteur arrache à sa vie souffrante un récit âpre : ce seront Passion simple et Se perdre, nés de son amour pour le diplomate russe Serguei, dit S. L’histoire indicible : « J’écrirai un livre sur toi devient : je n’écrirai pas un livre sur toi, mais je l’écris quand même. C’est ce non-livre qui devient le livre. »
Peu à peu, présence et absence de S. reviennent au même, reviennent aux mots :
« Ce désir, la jointure la plus mince entre la littérature et la vie, ne concerne que la relation S. C’est évidemment très fort et neuf poussé à cette limite. »
« Mais comment agencer tout cela : que l’amour c’est de l’écriture vécue, que l’écriture c’est de l’amour écrit ? »
Le fil des mots encercle l’enjeu : se trouver soi-même en disparaissant… s’évanouir et faire place à l’écrit.
L’atelier noir, d’Annie Ernaux, éditions des Busclats, septembre 2011.
Gwenaëlle Ledot.

« L’aimé c’est toujours l’Autre… »
« Dors : on t’aimera bien - L’aimé c’est toujours l’Autre…
Rêve : la plus aimée est toujours la plus loin. » (Tristan Corbière, Les Amours jaunes)
« Tu as toujours été morte. Tu es entrée morte dans ma vie l’été de mes dix ans. »
Annie Ernaux écrit une lettre fictive à sa sœur, l’enfant du ciel. Morte depuis deux ans et demi lorsqu’Annie est née. Celle qu’elle n’a jamais rencontrée. Rappelant Les Années, cet opuscule en forme de lettre fictive se fait l’écho d’une vie, entre les photos et les mots.
Un jour, la mère d’Annie se confie à une inconnue et révèle qu’elle a eu une autre fille, décédée très jeune. Récit fondateur qu’Annie, à dix ans, entend, écoute. Récit qui fige à jamais la vie d’un petit ange, canonisée par la mère : « Elle raconte qu’ils ont eu une autre fille que moi et qu’elle est morte de la diphtérie à six ans, avant la guerre, à Lillebonne. » La fillette est morte « comme une petite sainte ». La mère se souvient qu’elle était « plus gentille que celle-là. »
Qui est « l’Autre » ?
« Morte et pure. Un mythe. »
Entre Annie et ses parents, il y a désormais l’Autre. L’autre fille. Celle, émergée du discours, qui reste l’ange, l’incomparable, l’incomparée. Il y aura à jamais ce spectre, une première fille parfaite. Plus gentille… Annie se sent « repoussée dans l’ombre tandis qu’elle plane tout en haut dans la lumière éternelle. »
« La réalité est affaire de mots, système d’exclusions. Plus/Moins. Ou/Et. Avant/Après. Etre ou ne pas être. La vie ou la mort. »
Qui devient l’Autre ?
Annie, à son tour, devient l’Autre de sa sœur. Repoussée du côté de la terre, de l’humain, de l’imparfait. Double insuffisant de la petite martyre. Annie, symboliquement tuée par les mots, par le récit de sa mère : « un récit clos, définitif, inaltérable, qui te fait vivre et mourir comme une sainte […] Le récit qui profère la vérité et m’exclut. »
« Je ne leur reproche rien. Les parents d’un enfant mort ne savent pas ce que leur douleur fait à celui qui est vivant. »
Plus tard, l’écriture va inverser les destins : œuf de perfection était ce récit, où la sœur est née et morte. L’écriture d’Annie Ernaux va créer une autre bulle, faisant d’elle-même, enfant sombre, le vecteur de l’art. L’écrivain.
Pour une sœur défunte qui s’abîme dans l’ineffable, et renaît par le pouvoir des mots.
L’autre fille, d’Annie Ernaux, éditions NiL, avril 2011.
Gwenaëlle Ledot.
Les Années
par Anni e Ernaux
e Ernaux
le temps palimpseste
L’entreprise d’Annie Ernaux atteint dans un précédent ouvrage un aboutissement : aller au-delà des béances du temps. Défier l’oubli, pas en son nom propre, mais au nom de tous, de toutes. Le destin d’une femme, des années 1940 jusqu’en 2007, est l’objet d’un long travail de mémoire, d’écriture de la mémoire ; quelques photographies, non reproduites, rythment le temps d’une vie.
L’enfance, couleur sépia, nous est narrée sans afféterie : la petite fille est née à Lillebonne dans une époque âpre. La langue de l’enfance normande est « un français écorché, mêlé de patois » et émaillé de rudes maximes : « La vie te dressera », « Il aurait fait bon répondre », « On aura bien le temps de mourir, allez ! » Les parents, les anciens transmettent la résignation, l’acceptation de son sort, la limitation du désir et de l’espace : « On vivait dans la rareté de tout », « On vivait dans la proximité de la merde. Elle faisait rire. »
Les récits d’une époque sombre, « pleins de morts et de violence, de destruction » faits par les vieux aux enfants d’ « après », les repas familiaux qui réchauffent et les refrains d’époque : Fleur de Paris et L’Hirondelle du faubourg… images sonores de ces années où le cours des choses est lent, où l’on meurt « de mal », où peu à peu, tout doucement, perce la nouveauté.
Vient alors le temps des « chics types » et des « filles bien, claires et droites » : la sagesse veut que l’on fortifie la jeunesse ; il s’agit de « l’endurcir physiquement », de la maintenir à l’écart des pièges de la paresse, de l’immoralité… Annie est de cette génération, mais elle est déjà loin aussi : sûre d’une autre vérité, éprise de littérature, assoiffée de liberté.
Soudain, le corps est là, malmené. « Le désastre féminin », dénoncé dans L’Événement ou Les Armoires vides, s’étale : l’avortement clandestin dans les années 1960, puis l’aliénation sournoise et étrangement recommencée de la femme moderne.
La peinture de l’époque est d’une telle acuité, sans nostalgie ni fard, qu’elle fait inévitablement souffrir. Le « je » fait place à un « elle » qui se mêle au « on ». Nous sommes maintenant à la frontière du collectif et de l’individuel, à la jointure de l’histoire et de la littérature. Les caddies de supermarché deviennent sociologie, les conversations familiales se font politiques et nihilistes. Annie est grand-mère maintenant. C’est une nouvelle époque, dite « de consommation » ; « il fallait que la merde et la mort soient invisibles ».
Des photos de famille il y a la suggestion : des enfants chéris, mais étrangement lointains et Annie toujours, accompagnée de son chat, décrit comme « un chat noir et blanc de l’espèce la plus répandue ».
Cette lecture submerge bien vite : d’émotion, de reconnaissance et de vérité. Une vérité qu’Annie Ernaux n’a cessé de traquer de livre en livre, de roman en autofiction, portée par une écriture dépouillée, sobre, dite « au couteau ». Si la perfection est sous nos yeux, c’est qu’elle est soutenue par l’urgence& : sauver la lumière des visages évanouis ; les mots de réconfort perdus ; les refrains et les rires envolés.
Puis le chat d’Annie, décrit toujours comme « d’espèce commune », reçoit une piqûre : le petit chat qui meurt n’est pas de comédie. On devine à travers lui l’acceptation, la solitude ; on comprend étrangement son « enfouissement », et c’est pour Annie que l’on pleure.
Gwenaëlle Ledot