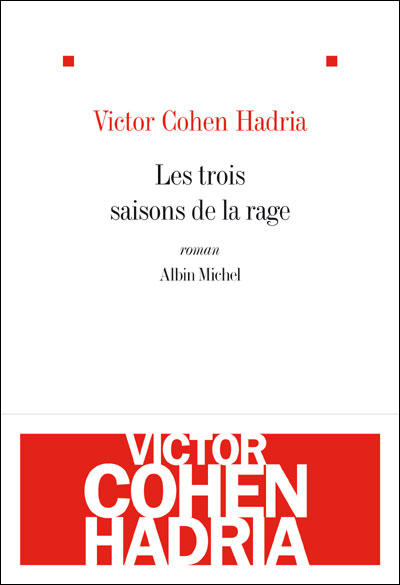Femmes d’hier

Que sait-on de la femme romaine ? Sera-t-elle fille et épouse, matrona (mère de famille) ou domina (maîtresse de maison) ? L’enquête proposée par Nathalie Papin, historienne de formation et journaliste (elle tient la rubrique « Un week-end à Paris » pour Normandie Magazine), révèle un itinéraire parsemé d’embûches. Si les risques d’exposition ou de mort prématurée ont été évités (un tiers des enfants romains meurent avant leur premier anniversaire, et la moitié avant l’âge de dix ans), les destins les plus heureux sont aussi des plus divers, selon l’extraction de la demoiselle. L’esclave et la patricienne, la musicienne ou l’impératrice révèlent ainsi les ressorts étonnants de la société impériale.Quel que soit son statut, le principe de société est « l’incapacité juridique, politique, judiciaire, civique » de la femme. Dans les faits, les choses sont plus complexes : « Dans la réalité, elles ont un certain nombre de privilèges ainsi que des pouvoirs gagnés par leur volonté et selon leur caractère ». Quelques femmes de pouvoir sont restées célèbres sous la plume de Pline ou Martial, mais Nathalie Papin s’attache à décrire quelques trajectoires plus surprenantes encore.
On suit ainsi les pas de Fabiola, la première femme-chirurgien connue, morte en 399 et célèbre pour avoir créé des hôpitaux destinés aux nécessiteux. Une vie exceptionnelle, qui convoque les témoignages du temps. Celius Aurélien, lui-même médecin, décrit en ces termes les exigences liées aux professionnelles de la santé :
« Elles doivent savoir écrire, avoir une mémoire fidèle, une santé robuste, un tempérament égal ; elles doivent avoir de longs doigts effilés, des ongles courts et arrondis, tenir leurs mains très propres et ne pas filer la laine, pour ne pas nuire à la finesse de leur peau. Il faut qu’elles connaissent la diététique, la pharmacie et la chirurgie usuelle. » On découvre en passant tous les paradoxes de la médecine romaine, « mélange de techniques poussées, dont la modernité surprend, et de croyances beaucoup plus fantaisistes. »
Ces ambiguïtés et paradoxes ne sont pas isolés. Même si les Romains goûtent fort l’art de la danse et du chant, musiciennes ou chanteuses gardent un statut infamant, comparé souvent à celui des prostituées. Quant aux femmes du peuple, elles « exercent une foule de petits métiers plus ou moins rémunérés, considérés, méprisés, honnis. La grande majorité des “actives” vit dans des conditions modestes et exerce des activités humbles par nécessité plutôt que par goût. »
Émaillé d’anecdotes piquantes, soutenu par les écrits de Juvénal, Martial ou Pétrone (il n’est jamais inutile de rafraîchir ses classiques), l’essai est à la fois solide et attractif. On y glanera à l’occasion quelques recettes plutôt exotiques (le goût romain, très différent du nôtre, privilégie le bouilli et les épices…) et divers secrets de beauté. Si le lait d’ânesse de Poppée est resté célèbre, certains onguents réservent des formules plus surprenantes encore : graisse d’oie, huile de rose et… toile d’araignée. Ovide lui-même n’a-t-il pas publié un traité consacré à la beauté féminine ? À lire avec quelque précaution…
Femme dans la Rome impériale, Nathalie Papin, éditions Altipresse, mars 2010, 223 p., 22 €.
Gwenaëlle Ledot

La rage humaine
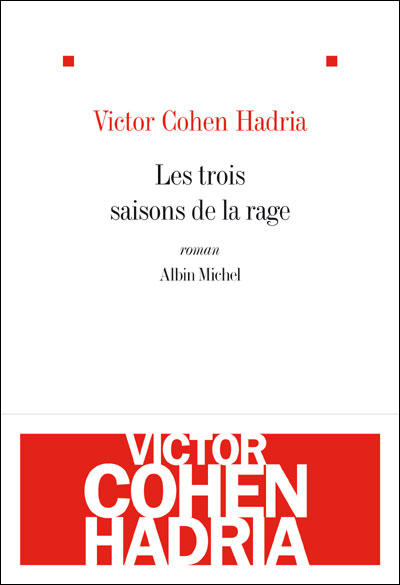
En 1859, un jeune paysan nommé Délicieux accepte contre monnaie trébuchante de prendre la place d’un autre, plus fortuné, et de partir au front. Cet échange humain, mauvaise fortune contre bon numéro, scelle un destin. C’est le point de départ de l’intrigue complexe tramée par Victor Cohen Hadria dans Les Trois Saisons de la rage : première saison ouverte par Brutus Délicieux.
Le jeune homme, devenu ordonnance au sein du régiment, souhaite communiquer par courrier avec sa fiancée et sa famille. Tous sont analphabètes. Deux hommes acceptent alors de devenir les secrétaires de leur quotidien : le médecin-major Rochambaud et le docteur Le Cœur. Ce dernier se présente comme un médecin du monde rural, bien ancré dans sa Normandie de Rapilly.
Place à la première partie de la fresque, palpitante. Dans les échanges croisés (espoirs des parents et des amants, doutes des transcripteurs) se révèlent lentement l’opacité et la confusion des sentiments. On devine avec effroi les vices cachés des uns ou des autres ; certaines petitesses trop humaines, au moment même où le cœur s’ouvre, conduisent les personnages à agir en pleine contradiction avec leurs intentions conscientes et déclarées…
Le roman réserve bien des coups aux protagonistes et quelques chocs pour le lecteur. De l’autre côté de la pleine misère sociale, le docteur Le Cœur assiste les agonisants, recueille les derniers soupirs des prostituées, soigne, ampute, fait son chemin opiniâtre et vaillant à travers les miasmes et les sanies, les soupirs et les membres sanglants. Encore n’est-il qu’un médecin de campagne, au contraire de son collègue envoyé au front, qui témoigne : « Nous sommes dans un enfer que Dante lui-même n’aurait pu inventer et nos Béatrice sont si loin. »
Sur cette vallée de larmes, une rage reparaît. Rage de vivre malgré tout et d’aimer… car le désir charnel «est l’antidote à la mort
».
Les deux médecins, qui ne se prennent certes pas pour des héros, en croisent quelques-uns sur leur chemin. Parmi eux, Henri Dunant, fondateur de la Croix Rouge. Mais aussi des scientifiques obscurs et sans grade, thésards et chercheurs isolés de cet art balbutiant qu’est la médecine du dix-neuvième siècle. Sur ce petit monde plane encore l’ombre du grand Hugo. Le docteur Le Cœur, protecteur d’une nouvelle Cosette, soutient les élans d’une conscience sociale naissante. Rage humaine d’hier… ou d’aujourd’hui :
« Quoi qu’en pensent les bons esprits de notre temps qui découvrent dans la réussite financière le summum de la bénédiction des dieux et qui s’acharnent dans la poursuite des biens matériels, il n’est pas douteux que la trop grande distance de situation entre les êtres ne soit un profond facteur de discorde et que le déséquilibre ainsi engendré n’aille, au contraire du progrès, vers de sanglantes frictions.
Notre peuple devient de plus en plus instruit et, par conséquent, gobe moins ce qui est fait pour le distraire de sa misère. »
Les Trois Saisons de la rage, Victor Cohen Hadria, Paris, Albin Michel, août2010, 458 pages, 22 €.
Gwenaëlle Ledot


… l’impressionnisme littéraire…
L’impressionnisme littéraire existe-t-il ? Voilà la question-défi à laquelle sont sommées de répondre quelques fines plumes normandes. Le recueil de nouvelles Les Couleurs de l’instant décline leurs essais variés : « De beaux et grands ciels tout tourmentés de nuages, chiffonnés de couleur ».
L’ouvrage est inauguré par les carnets d’Eugène Boudin. Vient ensuite Michel Bussi. Fidèle à l’énigme, l’auteur poursuit des ombres : c’est Anaïs Aubert quittant Paris pour Veules-les-Roses (les débuts d’un village qui « s’honfleurise… ») C’est aussi Victor Hugo, attaché à jamais à la terre normande.
Sous l’égide d’Yves Bonnefoy et de François Cheng, Anne Coudreuse peint les couleurs mouvantes de la rencontre amoureuse : une table, des mains, des livres, une chambre d’or. « Iseut est seule, et ceux qui viennent sont obscurs ». L’évocation est là, en suggestion impressionniste.
À la croisée, d’Hubert Heckmann, décline l’art, la nature, l’amour. Enchevêtre les tableaux et les jardins. Les sentiments laissent un petit goût amer, derrière un bow-window, derrière la nature reconstruite. Une Verdurin contemporaine y laisse filer l’amour, laisse naître la mélancolie sereine d’un spectateur de sa vie.
Et d’autres encore : Max Obione, à Paris en 1893. « Des feuilles vert tendre décoraient les arbres des rues. Dans l’agitation de la gare, les couleurs se mélangeaient, se divisaient, des floues, des nettes, des bleus, des mauves, des jaune soufre, des rouges, des gris… » Récit fin de siècle, fond d’absinthe et cruauté.
Cette question, enfin : « Et si plus rien n’était possible après ? Et si l’impressionnisme était un sommet, et surtout, la fin du paysage en peinture ? »
Réponse d’Eugène Boudin : « J’ai la tête gonflée de préoccupations et ne fais rien qui vaille. Métier bien difficile. »
Les Couleurs de l’instant. Nouvelles impressionnistes, textes choisis et présentés par Céline Servais-Picord, Tony Gheeraert, Hubert Heckmann, éditions des Falaises, 320 p., 14 €.
Gwenaëlle Ledot.