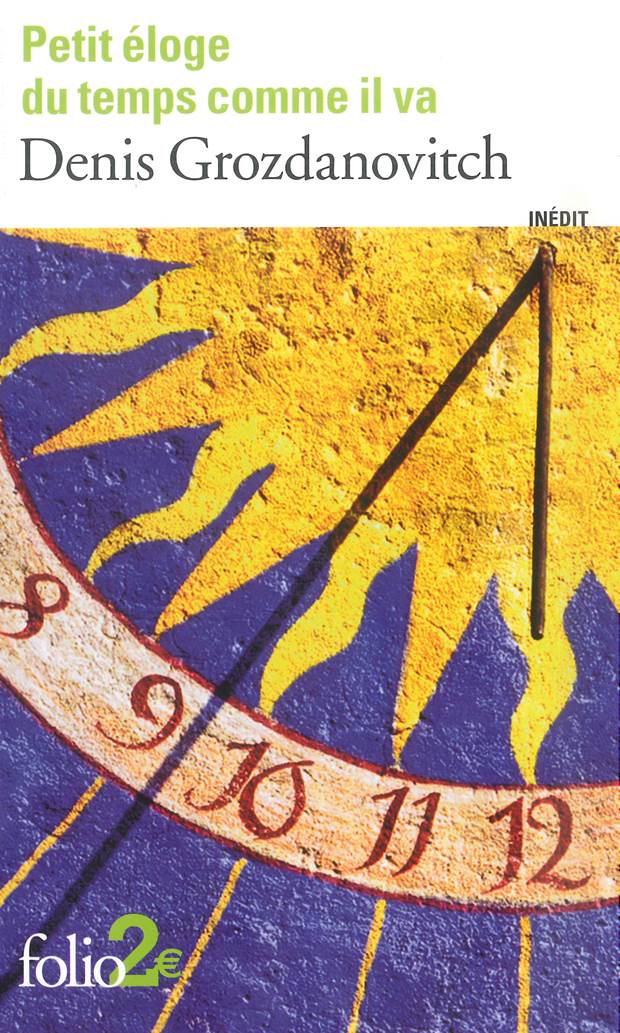« La farce atroce de durer »

Les voix de Vernon Subutex, mêlées, sont celles des marginaux et des employés, des anarchistes et des bourgeois, de droite, de gauche et de nulle part. Bruissant, hurlant, criant le monde avec âpreté : « A ce stade de laideur, ça doit vouloir dire quelque chose. »
Un souffle de colère porte sans aucun paradoxe l’empathie de l’auteur pour les Misérables du nouveau millénaire, autant dire chacun d’entre nous. La polyphonie absorbe le siècle pour mieux le recracher. L’énergie textuelle gratte et écorche les surfaces. Creusant, acharnée, les entrailles de l’humanité.
Pourquoi ces gens quand ils accèdent au pouvoir, cessent de dire la vérité. Pourquoi ils ne s’assoient pas au micro pour raconter, simplement, “voilà comment ça s’est passé”. Voilà comment j’ai défendu une idée, que je croyais juste et bonne, et voilà comment on m’a convaincu de conduire mon pays à l’abattoir.
Nul n’échappe au chaos socialement organisé et au jugement cru des narrateurs : « C’est la seule différence entre le sociopathe et le militant politique – le sociopathe se contrefout d’être dans le camp des justes. Il tue sans les préliminaires, c’est-à-dire sans perdre de temps à construire sa victime comme un monstre. Les militants, eux, font ça correctement : d’abord la propagande, et ensuite seulement le massacre. »
L’éponyme et insaisissable Vernon Subutex a accédé au cours du deuxième tome à un statut de leader spirituel, incarnant par la magie des « convergences » une lumière vacillante. De cette parenthèse enchantée, il ne sera jamais dupe : « Il pense que personne n’est solide. Rien. Aucun groupe. Que c’est le plus difficile à apprendre. Qu’on est les locataires des situations, jamais les propriétaires. » L’auteur fait de Vernon le premier et le dernier témoin du naufrage qui emporte les êtres : ceux qui croient être tout, et ceux qui (disent-ils) ne sont rien…
Ce corps à nous, travesti de molécules agitées et banales, tout le temps se révolte contre cette farce atroce de durer.
(Céline, Voyage au bout de la nuit)
Vernon Subutex 3, Virginie Despentes, Grasset, mai 2017.
Gwenaëlle Ledot.
Horla ? 
Une maison brûle : le narrateur, au lieu d’appeler les secours, temporise et regarde. A l’extérieur de sa maison, et à l’extérieur, semble-t-il, de lui-même. Spectateur de sa vie, hors, là… « C’est cette passivité qui comptait, dans laquelle je m’étais réfugié, ou investi… »
Résolument investi dans le néant, il se rend à Paris et s’installe à l’hôtel. Impliqué modérément dans ses rôles de comédien, il retrouve sur un tournage une actrice autrefois célèbre, France Rivière, qui l’invite chez elle. Là, il comprend que sa présence est requise par la surveillance de Charles, le fils de son hôte, atteint d’une mystérieuse pathologie psychiatrique, sur laquelle il échafaude quelques hypothèses plaisantes :
« Une sorte de tropisme, en somme. Quelque chose comme du japonisme. La manie, à tout moment, et de façon parfaitement inopinée, de s’envoler pour le Japon. Réflexe onéreux, pathologie lourde. Et moi ? »
Un voyage au Japon en compagnie de Charles constitue donc une nouvelle translation, sans plus de sens manifeste que les précédentes. Puis reprennent les tournages. Les scènes, décrites avec minutie et un humour subtil, illustrent le doute hyperbolique qui frappe les personnages :
« … en réalité on travaillait ensemble sur des vies qui n’étaient pas les nôtres, en tentant de les approcher comme si c’étaient les nôtres mais sans rien dévoiler de ce qu’étaient les nôtres, peut-être parce qu’en les dévoilant on aurait vu qu’elles ne nous appartenaient pas tout à fait non plus. »
Au « trou noir » du passé s’oppose la surface blanche et lisse du présent, mimée par des mots qui n’absorberont rien… Ces mots, comme de petites perles, tissent une vie ténue, suspendue au fil têtu de la plume :
« Jusqu’à preuve du contraire, c’est moi le fou. »
Christian Oster, La Vie automatique, éditions de l’Olivier, février 2017.
Gwenaëlle Ledot.
Brassens, une magie reparue

Un essai sociologique fait renaître la magie de la poésie chantée : Salvador Juan démontre en quoi (et dans quelle écriture) Brassens a tracé un portrait génial et inédit d’une certaine société française, composant, à sa manière provocatrice et quasi surréaliste, un tableau kaléidoscopique. L’auteur fait appel à Jean Duvignaud pour mettre en lumière une transgression des normes qui « porte aussi les germes de la résistance humaine et peut engendrer du changement social. »[1] ; à Edgar Morin pour éclairer la situation (complexe) de l’artiste au regard de la culture de masse ; à Elisabeth Badinter pour rendre compte d’une (bien regrettable) essentialisation de la femme, perceptible dans la plupart des textes : Brassens, pointe à ce propos une jeune sociologue, a toujours dépeint les femmes comme « appartenant à une « espèce à part », qui « n’entreront pas dans le club de l’amitié virile où tout est simple et beau, entre individus libres et égaux… »[2] S. Juan souligne quant à lui que le poète a pour essence de « capter et synthétiser l’esprit du temps… », sur ce sujet comme sur bien d’autres…
D’autres facettes, plus souriantes, de Brassens sont élégamment illustrées par d’abondants extraits de l’œuvre : son écriture facétieuse, au service d’un imaginaire puissant, génère des « pantalonnades » riches de sens ; sa méfiance salvatrice assassine les enrôlements suspects et les emportements idéologiques, quels qu’ils soient. L’auteur livre également une subtile analyse des problèmes infinis que posent aux traducteurs étrangers les textes ciselés de Brassens (et d’en montrer aussi les réussites, comme autant de preuves qu’un « traduttore » n’est pas inéluctablement « traditore »…) Le polisson de la chanson, très conscient des ressorts et de l’influence de son art, s’inscrit résolument dans une tradition littéraire, de Villon à Rabelais, Hugo et Aragon ; et l’analyse du discours à laquelle se livre l’auteur met en lumière ses trouvailles verbales innombrables, un art indiscuté de la concision et de la formule, pour parvenir très logiquement à cet énoncé de reconnaissance bien légitime :
“Le prix Nobel de littérature colombien Gabriel Garcia Marquez déclare en 1981 : « Il y a quelques années, au cours d’une discussion littéraire, quelqu’un m’a demandé qui était le meilleur poète contemporain en France. J’ai répondu sans hésitation Georges Brassens.”
Salvador Juan, Sociologie d’un génie de la poésie chantée : Brassens, Le Bord de L’eau éditions, janvier 2017.
Gwenaëlle Ledot.

De l’Âne.

Une icône paradoxale de la bêtise ? Denis Grozdanovitch a beau jeu de démontrer, dans les premières pages de son essai, que l’âne n’est pas celui qu’on croit : les cruautés infligées à l’animal n’en finissent-elles pas de désigner l’ineptie abyssale de l’être humain ? Le poème de Francis Jammes « Prière pour aller au paradis avec les ânes », révèle, à la clef, sa conviction profonde : l’empathie avec le vivant préserverait l’esprit humain des nombreuses ornières de la bêtise.
Dans le catalogue que l’auteur se propose d’établir, la « bêtise primordiale », celle des animaux, est salutaire :
“Or le bonheur qui est relié à la bêtise ressemble à un simple et sourd contentement dont le ronronnement du chat me paraît donner une idée exemplaire. Une dense et douce euphorie, proche de certaines extases matérielles. Une solide et compacte ataraxie où ne s’insinue aucune pointe d’angoisse.”
Être, ne point s’agiter, ni quêter jamais son essence dans l’agitation : « Le chat ne fait rien, il « est », comme un roi. » Une idée toute schopenhauerienne parcourt ces pages : la non-coïncidence avec le réel fait le malheur de l’homme ; tout comme le refus de percevoir cette impuissance spécifique, et de saluer la supériorité animale à cet égard : « En réalité, cette conscience aiguë, dont nous sommes si fiers et qui va de pair avec notre faculté d’abstraction et avec notre volonté de planification systématique, est aussi ce qui fait notre malheur, qui empoisonne nos vies à petit feu… ».
Guidés par une plume dansante, nous découvrons la « bêtise de l’intelligence » : elle dépend, semble-t-il, de « modèles » et de « postures » qui finissent inéluctablement par gommer la complexité mouvante du réel, pour tous ceux qui détiennent la clef explicative (et définitive) de l’existence…(1)
“…savoir que nous passionner pour une idée, pour une théorie, est inévitable, mais garder en même temps à l’esprit que ça n’est qu’une posture, une posture tout aussi bête que toutes celles qui nous apparaissent comme telles chez les autres.”
La bêtise savante est perceptible dans les démonstrations les plus brillantes des plus grands esprits, où se glissent çà et là quelques raisonnements incertains, dont l’auteur pointe habilement les failles. C’est l’occasion d’un rappel à l’humilité : « Quand ça devient trop sophistiqué, j’invoque le sens commun pour qu’il m’assiste » . Car c’est une aventure périlleuse que de vouloir mettre en concepts une réalité héraclitéenne :
“Quelle que soit la valeur, la puissance de pénétration d’une explication, c’est encore et encore la chose à expliquer qui est la plus réelle, - et parmi sa réalité figure précisément ce mystère que l’on a voulu dissiper.” (3)
On n’oublie pas la bêtise névrotique, intégrée aux formes multiples de la bêtise ordinaire : conduites répétitives, comportements absurdes et d’échec, auxquels les esprits brillants ne sauront échapper ; ou encore la bêtise « sociétale » (snobismes esthétiques ou dogmes contemporains, objets de descriptions réjouissantes). On se dira que l’empan est bien large, et que les manières d’être bête donnent l’embarras du choix… La catégorisation importe-t-elle vraiment ? Se dégagent de ces pages, telle une brume rafraîchissante, l’incertitude de toute chose, le risque qu’il y a à théoriser de façon définitive et l’impérieux désir de rejoindre par des chemins divers (jeu, méditation, contemplation) une réalité plus immédiate… Osera-t-on écrire que l’on se sent moins sot à la lecture de cet ouvrage, truffé de références érudites et malicieuses, et dont l’élégance distanciée prévient tout risque de bêtise savante ? L’écriture, avançant à sauts et gambades, mêle l’examen minutieux de textes exigeants à des petits faits narrés avec simplicité, rencontres fécondes et émerveillements esthétiques. « Venez, doux amis du ciel bleu… »
Le Génie de la bêtise, Denis Grozdanovitch, Grasset, janvier 2017.
Gwenaëlle Ledot.