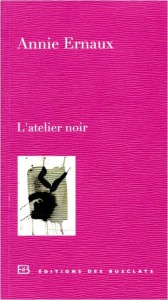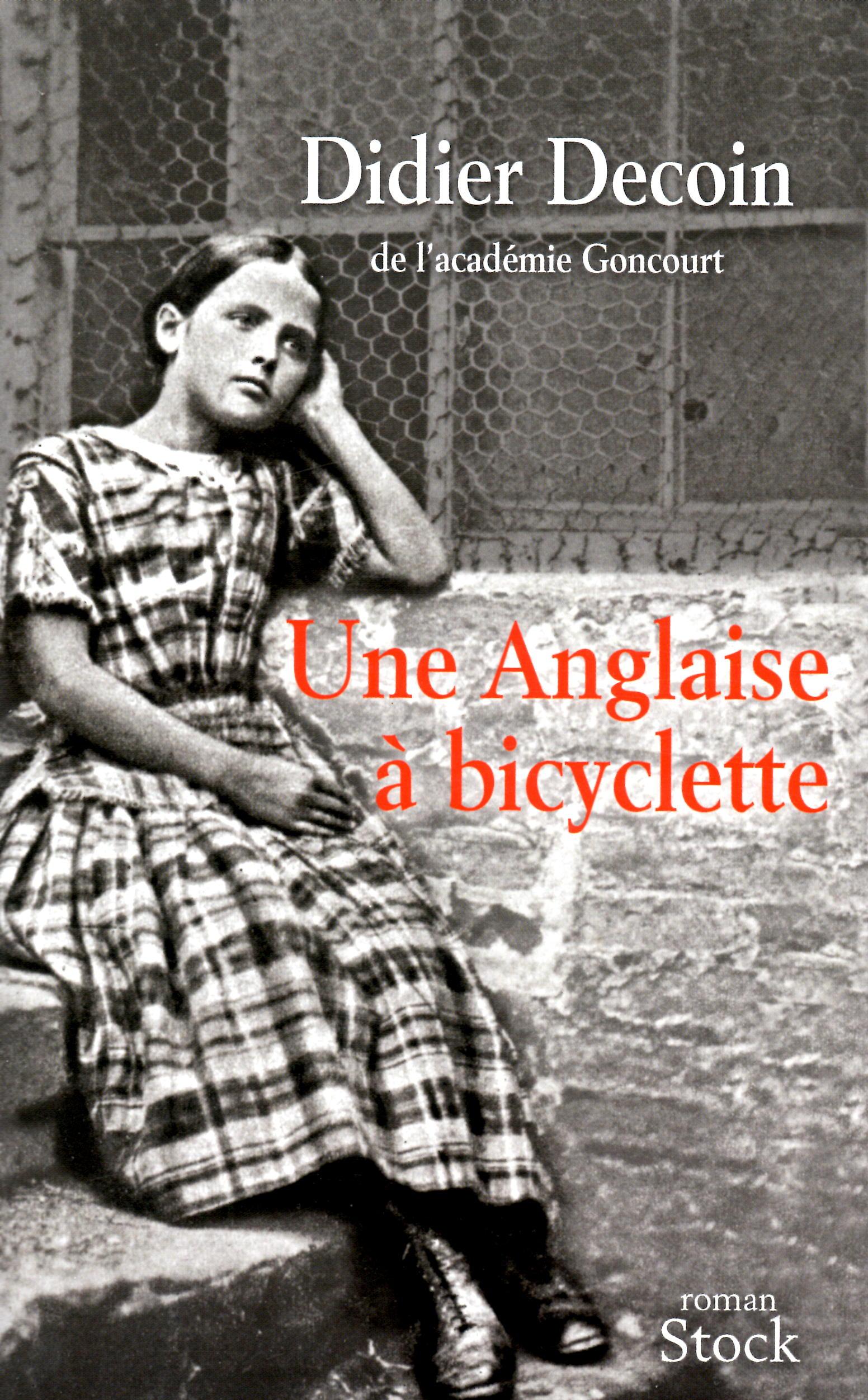Mémoire de fille, d’Annie Ernaux 
Qu’est-ce que la mémoire et qu’est-ce qu’une fille ? Saisir un fantôme, peindre une silhouette, attraper une « sylphide au fond de la coulisse » (1) ? Et creuser sans relâche, questionner un passé violent, interroger sans limites l’essence d’une fille qu’elle a (peut-être) été. L’objet du texte est explicitement réflexif, puisqu’on construit une identité par l’écriture. Quelle est la possibilité de comprendre ce qu’on a été un jour ? Quelle possibilité de l’appréhender par les mots ?
De quoi est constituée cette fille de 1958 ? Les données sociologiques et psychologiques sont vite survolées ; ce sont des images gravées par la souffrance qui vont donner l’élan au texte. Elles n’existeront que par les mots qui les informent. Car « l’autre fille » torture de la pâte à papier pour en exprimer une parcelle de vérité.
« Horloge ! Dieu sinistre, effrayant, impassible… »
Que se passe-t-il au moment où « la fille » cède aux avances d’un quasi-inconnu ? Qui est-elle lorsqu’elle se laisse emporter par la volonté d’un Autre ? Où est-elle lorsqu’elle abdique son être et sa conscience ? L’auteur décrit une « fille de chiffon », prisonnière de son désir confus et du désir émietté d’autrui : « Il m’est impossible de saisir tous les glissements, la logique, qui l’ont conduite à l’état où elle se trouve. » (2)
Elle est donc celle qui disparaît sciemment, pour explorer (peut-être) un anéantissement prévisible, et plonger au fond du gouffre. Elle est celle, aussi, constituée déjà de morceaux textuels : poèmes de Prévert et de Laforgue, phrases de Proust ou de Gide mémorisés. Elle est un nom (Annie Duchesne), mais ce nom pourrait être un autre (Duménil), et plus tard ne sera plus le sien.
Lorsqu’elle se cherche dans les autres du passé, quelques camarades de 1958, ceux-ci ont disparu (même sur Google). Il reste quelques scènes, monstrueusement distendues, tandis que d’autres « ponts » de la mémoire se sont absolument effacés. Caprices du souvenir.
La saisie et la construction du moi par le texte restent eux-mêmes frappés d’insuffisance et d’impuissance : « Il manque toujours ceci : l’incompréhension de ce qu’on vit au moment où on le vit, cette opacité du présent qui devrait trouer chaque phrase, chaque assertion. » (3)
Et encore ce déséquilibre vertigineux : qui étions-nous dans le regard des autres ? Que reste-t-il de nous dans leur esprit ? Ceux qui ont envahi et habité notre âme pendant des années nous ont mystérieusement balayés. Distorsion de la durée, disproportion des impacts.
« Le jour décroît ; la nuit augmente, souviens-toi ! »
Mais une phrase paradoxale écrite par la fille du passé, retrouvée dans les pages d’un journal, semble livrer la clef du récit, sinon la clef d’une vie : « Je ne suis pas culturelle, il n’y a qu’une chose qui compte pour moi, saisir la vie, le temps, comprendre et jouir. » La fille rend compte par anticipation de la lutte acharnée, parfois violente, menée par l’auteur pour saisir avec de l’encre quelques paillettes d’existence.
« Le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. »
Mémoire de fille, Annie Ernaux, Gallimard, mars 2016.
Gwenaëlle Ledot.

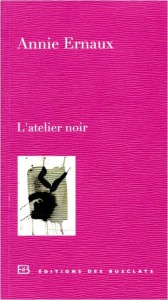



 Fugitive
Fugitive
Le narrateur est à la recherche d’un désir fondamental. Il connaît l’exigence commune des nantis, cet impérieux appel : se sentir vivre, totalement, aller jusqu’à plus que soi. Exigence de tomber amoureux et d’enflammer une vie. Dans cette vie satisfaisante, que l’on pourrait dire accomplie, manquent soudain le feu, l’énergie, la dévoration de l’être. « Le cœur qu’on se suppose… »
C’est l’objet de ce récit amoureux ; c’est l’objet cruel et commun ; est-ce plus que cela, ou est-ce moins ? Rien ne paraît ; pas de jugement. L’auteur cisèle le récit d’une passion avec une lucidité minérale que l’on compare à du Benjamin Constant.
Le narrateur est amoureux parce que la nouvelle femme, appelée « Ellénore », est fugitive. Un charme. Qu’elle soit ou non son genre, il la traque, « elle », « l’autre ». L’incarnation indiscutable du désir amoureux. Parce qu’elle semble d’abord lui échapper, ils s’engloutissent inéluctablement dans un feu charnel. Le roman célèbre avec eux joie vitale et énergie érotique, récit originel toujours recommencé.
Pendant ce temps, l’autre femme, appelée « L’Une », coexiste. Car il ne sera jamais question de sacrifier sa présence, encore moins de sacrifier le couple premier. Cette femme, qui est l’Une, devrait rester l’Unique.
Ellénore devenue prisonnière, le piège amoureux paradoxal se referme également sur le narrateur. Glissement inéluctable vers la froideur, la rancœur de la Prisonnière. Angoisse de perdre le feu intérieur, le nu intérieur. La force du désir se heurte à la perspective de la perte.
L’impossibilité de renoncer mène au deuil annoncé d’une passion fugitive… “Le cœur qu’on se suppose n’est pas le cœur qu’on a.” (1)
Nu intérieur, de Belinda Cannone, éditions de l’Olivier, 2015.
Gwenaëlle Ledot.
(1) Diderot, cité en épigraphe par Belinda Cannone
 Jolie ma bouche et verts mes yeux.
Jolie ma bouche et verts mes yeux.
« Absurde était le hasard qui nous avait réunis, et bien cruel le marionnettiste qui s’amusait à nous faire trébucher ». Le dernier roman d’Alexis Salatko se lit comme un écho lointain et persistant du mythique Salinger. Il y a là deux individus égarés, l’un et l’autre suicidaires. L’homme, Axel Ribolowski, se définit comme un artiste raté ; elle, Marie-Angélique, a des secrets. Leurs premiers mots échangés, entre la neige de décembre et la bruine du Cotentin, sont surréels.
« La rencontre d’une femme déprimée et d’un homme au bout du rouleau un soir de Noël… »
Cette rencontre initiale fait surgir quelques images autobiographiques et auto-référencées : un balcon au bord du vide, un tigre de papier et Horowitz… Vie et œuvre de Salatko. Jusqu’à sa rencontre fameuse avec le cinéaste Roman Polanski, qu’il met en scène.
L’auteur s’amuse de lui-même, comme « jeune romancier à succès», écrivain naïf en pleine ascension. L’artiste cherbourgeois qui voulait croire (et pouvait écrire sérieusement) que « le crachin c’est du soleil qui mouille ». Le texte aujourd’hui dessine la Normandie en vingt-deux nuances de gris. Un gris velours, gris iodé, où renaissent les brumes de Lessay et L’Ensorcelée, la silhouette de Barbey ; l’atmosphère fascinante et lourde du Cotentin.
Puis la mémoire de son père entraîne le roman de Salatko sur un versant policier, vacillant. L’essentiel est ailleurs, au bord du vide peut-être, où la vie et l’écriture doucement se mêlent.
Le parieur d’Alexis Salatko, Fayard, août 2012.
Gwenaëlle Ledot
18 juillet 2011 13:37
 Plume non recommandable.
Plume non recommandable.
« Existe-t-il d’autres véritables réalisations de nos profonds tempéraments que la guerre et la maladie, ces deux infinis du cauchemar ?
La grande fatigue de l’existence n’est peut-être en somme que cet énorme mal qu’on se donne pour demeurer vingt ans, quarante ans, davantage, raisonnable, pour ne pas être simplement, profondément soi-même, c’est-à-dire immonde, atroce, absurde. Cauchemar d’avoir à présenter toujours comme un petit idéal universel, surhomme du matin au soir, le sous-homme claudicant qu’on nous a donné. » (Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit )
Difficulté d’écrire Céline, d’écrire sur Céline. Haïr l’antisémite, le xénophobe, et célébrer le Voyage au bout de la nuit : « T’ouvres Le Voyage et t’es happé… En trois lignes, Céline est là, il s’adresse à toi, il te parle dans la tête, il s’introduit dans ton système nerveux, il te raconte son histoire qui devient ton histoire, si tu t’avises de lui résister, il t’écrase du talon… »
Alexis Salatko écrit Céline’s band, roman biographique captivant, sur une vie dévorée et errante. « Céline, es-tu là ? » Dans une existence vouée à l’écriture, retracer l’un des cercles de l’Enfer…
« L’écriture le rongeait. Au fond, il n’y avait que ça qui comptait, les mots, les visions qu’il portait sur le papier avec infiniment de patience et de souffrance, tournant le dos à tout ce qu’il aimait. »
Salatko devient chasseur d’apocalypses. Style étincelant au service d’une sombre épopée. Pose la question implacable, primaire : « Pourquoi Céline avait-il si mal tourné ? » Fouille la question lycéenne, naïve, lancinante : « Comment l’écrivain du vingtième siècle qui avait le mieux parlé de l’homme du vingtième siècle pouvait-il passer pour le pire des hommes ? »
Et martèle l’interrogation des lecteurs de Céline, devant l’horreur du pamphlet Bagatelle pour un massacre. L’incompréhension devant cette diatribe hallucinatoire et haineuse. Irrécupérable, irrattrapable.
Signe d’un mal d’époque ? Alliance hideuse et banale de la littérature et du Mal absolu :
« Ruée frénétique de l’art vers le giron totalitaire. Le surréalisme au service de la Révolution. Eluard chantant Staline en alexandrins. Aragon célébrant la Tcheka. Antonin Artaud dédiant ses Nouvelles Révélations à Hitler. »
La cécité idéologique des artistes : criminelle, impardonnable, humaine.
Accepter ce paradoxe ; le disséquer à l’infini, comme le fait Salatko. Le creuser et fouiller sa chair, au scalpel. Comme le faisait Céline :
« Quand on sera au bord du trou, faudra pas faire les malins nous autres, mais faudra pas oublier non plus, faudra raconter tout sans changer un mot, de ce qu’on a vu de plus vicieux chez les hommes, et puis poser sa chique et puis descendre. Ça suffit comme boulot pour une vie tout entière. » (Voyage au bout de la nuit)
Alexis Salatko, Céline’s band. Editions Robert Laffont, mai 2011. 18 euros.
Gwenaëlle Ledot.
« Il est temps de lire Alexis Salatko. » (1)

Horowitz et mon père, chef-d’œuvre d’Alexis Salatko publié en 2006 chez Fayard, a été récompensé par le Prix Jean Freustié et le Grand Prix Littéraire de la ville de Caen. En 2008, l’auteur fait le choix d’un long récit, tout entier consacré aux fileurs d’or, moufletiers, marcheurs de pâtes et hommes de four : une fabrique de porcelaine en 1847. Ville de porcelaine, ville de bourbe, Limoges y apparaît, médiévale, laborieuse et alcoolisée. L’itinéraire de Marc Dubreuil nous est conté par sa fille China, dont l’histoire s’entrelace à la sienne. Une rencontre, qu’on dirait rêvée, avec Camille Corot change le destin de l’enfant chétif. Le peintre, « voleur d’ombre et de lumière », donne à Marc la force d’échapper à l’enfer de la tannerie et à son bourreau Sophocle, surnommé Le Cyclope : dernier avatar de tous les Rois des Aulnes qui parcourent en prédateurs l’œuvre de Salatko. « Le privilège des bâtards n’est-il pas de pouvoir se choisir un père parmi les hommes que le hasard place sur sa route ? »
Le monde terreux de Marc voit se détacher soudain la finesse des fils d’or. Initié aux couleurs des maîtres chinois et aux contrastes de Rembrandt, Marc affine son art et devient le « peintre-fleur ». Son épouse Luna se fait muse orientale, China à son tour convoque Botticelli et Ruysdael. Jusqu’à la « mort en pleine vie » de Marc Dubreuil, l’on voit Salatko poursuivre en trait filigrané sa rêverie maîtrisée sur la création, art et artisanat. « Harmonie des mouvements, expression de la réalité, concordance des tonalités, respect de la composition, copie des grands maîtres. » Fresque romanesque, dit-on ? Art poétique sans nul doute.
Alexis Salatko, China et la grande fabrique aux éditions Fayard, janvier 2008. 20 euros.
(1) Patrick Besson dans l’hebdomadaire Marianne, à propos du roman Horowitz et mon père, publié en 2006 chez Fayard.
Gwenaëlle Ledot
 Plume non recommandable.
Plume non recommandable.
« Existe-t-il d’autres véritables réalisations de nos profonds tempéraments que la guerre et la maladie, ces deux infinis du cauchemar ?
La grande fatigue de l’existence n’est peut-être en somme que cet énorme mal qu’on se donne pour demeurer vingt ans, quarante ans, davantage, raisonnable, pour ne pas être simplement, profondément soi-même, c’est-à-dire immonde, atroce, absurde. Cauchemar d’avoir à présenter toujours comme un petit idéal universel, surhomme du matin au soir, le sous-homme claudicant qu’on nous a donné. » (Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit )
Difficulté d’écrire Céline, d’écrire sur Céline. Haïr l’antisémite, le xénophobe, et célébrer le Voyage au bout de la nuit : « T’ouvres Le Voyage et t’es happé… En trois lignes, Céline est là, il s’adresse à toi, il te parle dans la tête, il s’introduit dans ton système nerveux, il te raconte son histoire qui devient ton histoire, si tu t’avises de lui résister, il t’écrase du talon… »
Alexis Salatko écrit Céline’s band, roman biographique captivant, sur une vie dévorée et errante. « Céline, es-tu là ? » Dans une existence vouée à l’écriture, retracer l’un des cercles de l’Enfer…
« L’écriture le rongeait. Au fond, il n’y avait que ça qui comptait, les mots, les visions qu’il portait sur le papier avec infiniment de patience et de souffrance, tournant le dos à tout ce qu’il aimait. »
Salatko devient chasseur d’apocalypses. Style étincelant au service d’une sombre épopée. Pose la question implacable, primaire : « Pourquoi Céline avait-il si mal tourné ? » Fouille la question lycéenne, naïve, lancinante : « Comment l’écrivain du vingtième siècle qui avait le mieux parlé de l’homme du vingtième siècle pouvait-il passer pour le pire des hommes ? »
Et martèle l’interrogation des lecteurs de Céline, devant l’horreur du pamphlet Bagatelle pour un massacre. L’incompréhension devant cette diatribe hallucinatoire et haineuse. Irrécupérable, irrattrapable.
Signe d’un mal d’époque ? Alliance hideuse et banale de la littérature et du Mal absolu :
« Ruée frénétique de l’art vers le giron totalitaire. Le surréalisme au service de la Révolution. Eluard chantant Staline en alexandrins. Aragon célébrant la Tcheka. Antonin Artaud dédiant ses Nouvelles Révélations à Hitler. »
La cécité idéologique des artistes : criminelle, impardonnable, humaine.
Accepter ce paradoxe ; le disséquer à l’infini, comme le fait Salatko. Le creuser et fouiller sa chair, au scalpel. Comme le faisait Céline :
« Quand on sera au bord du trou, faudra pas faire les malins nous autres, mais faudra pas oublier non plus, faudra raconter tout sans changer un mot, de ce qu’on a vu de plus vicieux chez les hommes, et puis poser sa chique et puis descendre. Ça suffit comme boulot pour une vie tout entière. » (Voyage au bout de la nuit)
Alexis Salatko, Céline’s band. Editions Robert Laffont, mai 2011. 18 euros.
Gwenaëlle Ledot.
« Il est temps de lire Alexis Salatko. » (1)

Horowitz et mon père, chef-d’œuvre d’Alexis Salatko publié en 2006 chez Fayard, a été récompensé par le Prix Jean Freustié et le Grand Prix Littéraire de la ville de Caen. En 2008, l’auteur fait le choix d’un long récit, tout entier consacré aux fileurs d’or, moufletiers, marcheurs de pâtes et hommes de four : une fabrique de porcelaine en 1847. Ville de porcelaine, ville de bourbe, Limoges y apparaît, médiévale, laborieuse et alcoolisée. L’itinéraire de Marc Dubreuil nous est conté par sa fille China, dont l’histoire s’entrelace à la sienne. Une rencontre, qu’on dirait rêvée, avec Camille Corot change le destin de l’enfant chétif. Le peintre, « voleur d’ombre et de lumière », donne à Marc la force d’échapper à l’enfer de la tannerie et à son bourreau Sophocle, surnommé Le Cyclope : dernier avatar de tous les Rois des Aulnes qui parcourent en prédateurs l’œuvre de Salatko. « Le privilège des bâtards n’est-il pas de pouvoir se choisir un père parmi les hommes que le hasard place sur sa route ? »
Le monde terreux de Marc voit se détacher soudain la finesse des fils d’or. Initié aux couleurs des maîtres chinois et aux contrastes de Rembrandt, Marc affine son art et devient le « peintre-fleur ». Son épouse Luna se fait muse orientale, China à son tour convoque Botticelli et Ruysdael. Jusqu’à la « mort en pleine vie » de Marc Dubreuil, l’on voit Salatko poursuivre en trait filigrané sa rêverie maîtrisée sur la création, art et artisanat. « Harmonie des mouvements, expression de la réalité, concordance des tonalités, respect de la composition, copie des grands maîtres. » Fresque romanesque, dit-on ? Art poétique sans nul doute.
Alexis Salatko, China et la grande fabrique aux éditions Fayard, janvier 2008. 20 euros.
(1) Patrick Besson dans l’hebdomadaire Marianne, à propos du roman Horowitz et son père, publié en 2006 chez Fayard.
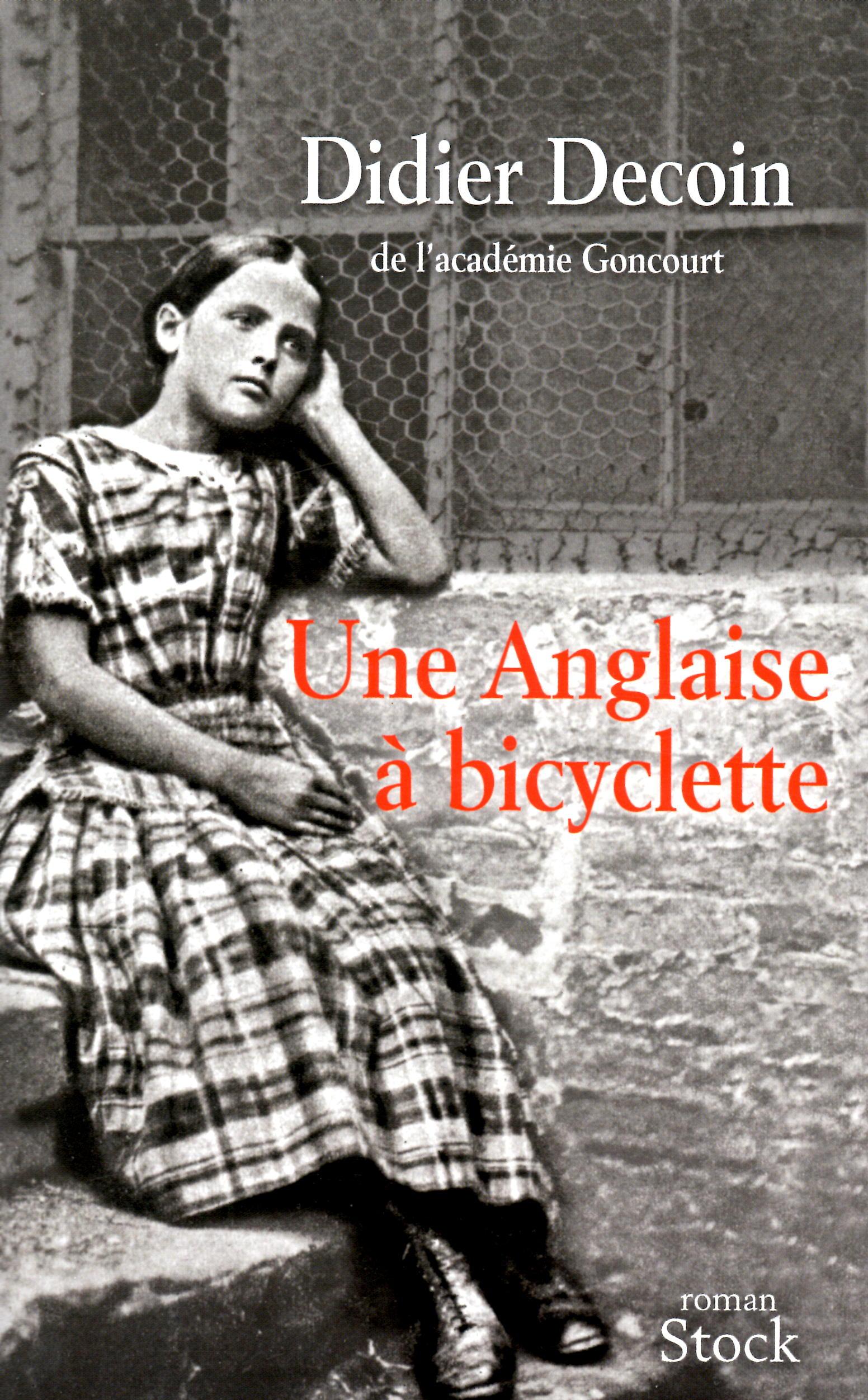 Vent et nuage.
Vent et nuage.
« Je les vois de mon cœur car mes yeux sont fermés. Mon amour au-dessus des fleurs n’a laissé que vent et nuage. » (René Char)
Le premier chapitre du roman de Didier Decoin, comme un coup de poing : la fuite éperdue et sanglante d’une femme sioux, pour la vie d’un enfant. Un massacre perpétré par les hommes du colonel Forsyth, dans les plaines du Dakota du Sud. Et un témoin, Jayson Flannery, photographe ambigu :
« Jayson a pris de nombreux clichés des corps éparpillés, raidis par le froid dans des poses parfois très belles qui font penser à la façon dont la nature torsade et noue les arbres. »
Une fillette indienne, rescapée de l’horreur, est confiée faute de mieux à Flannery. Lequel est censé en faire… quoi ? La pensionnaire d’un orphelinat ? Une servante ? Car le sort d’Ehawee n’intéresse personne. L’enfant, vite rebaptisée Emily, est confiée aux Sœurs de la Charité du New York Foundling Hospital :
« Si elles ne réussissent pas à la requinquer suffisamment pour l’embarquer à bord d’un train d’orphelins, elles la garderont à l’hôpital pour faire la lessive et rafistoler les vêtements des autres enfants. »
Le destin d’Ehawee bascule lorsque Jayson Flannery décide de l’adopter. La fillette sera présentée comme l’orpheline d’une famille de cultivateurs irlandais. Pivotant sur un instant de doute (« A-t-il, en partant, déposé un baiser sur le front d’Emily ? »), le récit ouvre grand le champ des possibles.
Alors, le souffle romanesque de Decoin emporte et brasse ses personnages : dans une campagne anglaise battue des vents apparaissent Emily Brontë, Conan Doyle, des attrapeurs de rêve et des petites fées… Errance dans les limbes, entre le monde dense de la mort (Omnipresence of Death est le titre choisi par Jayson Flannery) et celui des vivants, en partance.
Cet entre-deux s’illumine de présences incertaines : une Anglaise indienne sur sa bicyclette, deux petites filles qui croient aux fées, des vieilles dames retrouvant leur splendeur passée. Un vent doux caresse les personnages et les porte au-delà de la mort…
« Il semble que ce soit le ciel qui ait le dernier mot. Mais il le prononce à voix si basse que nul ne l’entend jamais. » (Paul Eluard)
Didier Decoin, Une Anglaise à bicyclette aux éditions Stock, juin 2011.
Gwenaëlle Ledot.

« L’aimé c’est toujours l’Autre… »
« Dors : on t’aimera bien - L’aimé c’est toujours l’Autre…
Rêve : la plus aimée est toujours la plus loin. » (Tristan Corbière, Les Amours jaunes)
« Tu as toujours été morte. Tu es entrée morte dans ma vie l’été de mes dix ans. »
Annie Ernaux écrit une lettre fictive à sa sœur, l’enfant du ciel. Morte depuis deux ans et demi lorsqu’Annie est née. Celle qu’elle n’a jamais rencontrée. Rappelant Les Années, cet opuscule en forme de lettre fictive se fait l’écho d’une vie, entre les photos et les mots.
Un jour, la mère d’Annie se confie à une inconnue et révèle qu’elle a eu une autre fille, décédée très jeune. Récit fondateur qu’Annie, à dix ans, entend, écoute. Récit qui fige à jamais la vie d’un petit ange, canonisée par la mère : « Elle raconte qu’ils ont eu une autre fille que moi et qu’elle est morte de la diphtérie à six ans, avant la guerre, à Lillebonne. » La fillette est morte « comme une petite sainte ». La mère se souvient qu’elle était « plus gentille que celle-là. »
Qui est « l’Autre » ?
« Morte et pure. Un mythe. »
Entre Annie et ses parents, il y a désormais l’Autre. L’autre fille. Celle, émergée du discours, qui reste l’ange, l’incomparable, l’incomparée. Il y aura à jamais ce spectre, une première fille parfaite. Plus gentille… Annie se sent « repoussée dans l’ombre tandis qu’elle plane tout en haut dans la lumière éternelle. »
« La réalité est affaire de mots, système d’exclusions. Plus/Moins. Ou/Et. Avant/Après. Etre ou ne pas être. La vie ou la mort. »
Qui devient l’Autre ?
Annie, à son tour, devient l’Autre de sa sœur. Repoussée du côté de la terre, de l’humain, de l’imparfait. Double insuffisant de la petite martyre. Annie, symboliquement tuée par les mots, par le récit de sa mère : « un récit clos, définitif, inaltérable, qui te fait vivre et mourir comme une sainte […] Le récit qui profère la vérité et m’exclut. »
« Je ne leur reproche rien. Les parents d’un enfant mort ne savent pas ce que leur douleur fait à celui qui est vivant. »
Plus tard, l’écriture va inverser les destins : œuf de perfection était ce récit, où la sœur est née et morte. L’écriture d’Annie Ernaux va créer une autre bulle, faisant d’elle-même, enfant sombre, le vecteur de l’art. L’écrivain.
Pour une sœur défunte qui s’abîme dans l’ineffable, et renaît par le pouvoir des mots.
L’autre fille, d’Annie Ernaux, éditions NiL, avril 2011.
Gwenaëlle Ledot.
Les Années
par Anni e Ernaux
e Ernaux
le temps palimpseste
L’entreprise d’Annie Ernaux atteint dans un précédent ouvrage un aboutissement : aller au-delà des béances du temps. Défier l’oubli, pas en son nom propre, mais au nom de tous, de toutes. Le destin d’une femme, des années 1940 jusqu’en 2007, est l’objet d’un long travail de mémoire, d’écriture de la mémoire ; quelques photographies, non reproduites, rythment le temps d’une vie.
L’enfance, couleur sépia, nous est narrée sans afféterie : la petite fille est née à Lillebonne dans une époque âpre. La langue de l’enfance normande est « un français écorché, mêlé de patois » et émaillé de rudes maximes : « La vie te dressera », « Il aurait fait bon répondre », « On aura bien le temps de mourir, allez ! » Les parents, les anciens transmettent la résignation, l’acceptation de son sort, la limitation du désir et de l’espace : « On vivait dans la rareté de tout », « On vivait dans la proximité de la merde. Elle faisait rire. »
Les récits d’une époque sombre, « pleins de morts et de violence, de destruction » faits par les vieux aux enfants d’ « après », les repas familiaux qui réchauffent et les refrains d’époque : Fleur de Paris et L’Hirondelle du faubourg… images sonores de ces années où le cours des choses est lent, où l’on meurt « de mal », où peu à peu, tout doucement, perce la nouveauté.
Vient alors le temps des « chics types » et des « filles bien, claires et droites » : la sagesse veut que l’on fortifie la jeunesse ; il s’agit de « l’endurcir physiquement », de la maintenir à l’écart des pièges de la paresse, de l’immoralité… Annie est de cette génération, mais elle est déjà loin aussi : sûre d’une autre vérité, éprise de littérature, assoiffée de liberté.
Soudain, le corps est là, malmené. « Le désastre féminin », dénoncé dans L’Événement ou Les Armoires vides, s’étale : l’avortement clandestin dans les années 1960, puis l’aliénation sournoise et étrangement recommencée de la femme moderne.
La peinture de l’époque est d’une telle acuité, sans nostalgie ni fard, qu’elle fait inévitablement souffrir. Le « je » fait place à un « elle » qui se mêle au « on ». Nous sommes maintenant à la frontière du collectif et de l’individuel, à la jointure de l’histoire et de la littérature. Les caddies de supermarché deviennent sociologie, les conversations familiales se font politiques et nihilistes. Annie est grand-mère maintenant. C’est une nouvelle époque, dite « de consommation » ; « il fallait que la merde et la mort soient invisibles ».
Des photos de famille il y a la suggestion : des enfants chéris, mais étrangement lointains et Annie toujours, accompagnée de son chat, décrit comme « un chat noir et blanc de l’espèce la plus répandue ».
Cette lecture submerge bien vite : d’émotion, de reconnaissance et de vérité. Une vérité qu’Annie Ernaux n’a cessé de traquer de livre en livre, de roman en autofiction, portée par une écriture dépouillée, sobre, dite « au couteau ». Si la perfection est sous nos yeux, c’est qu’elle est soutenue par l’urgence& : sauver la lumière des visages évanouis ; les mots de réconfort perdus ; les refrains et les rires envolés.
Puis le chat d’Annie, décrit toujours comme « d’espèce commune », reçoit une piqûre : le petit chat qui meurt n’est pas de comédie. On devine à travers lui l’acceptation, la solitude ; on comprend étrangement son « enfouissement », et c’est pour Annie que l’on pleure.
Gwenaëlle Ledot
 Les cendres à venir.
Les cendres à venir.
Lecture de Survivre et mourir, de Guy Allix.
Pleurer la chute. Chute solaire, vécue au ralenti… Reste à saisir les instants de feu, les instants de cendre, puis les instants, infinis, où il n’y a rien.
Attraper les minutes de douleur fulgurante, celles où l’on existe encore. La vibration de la vie, le chant des choses, le vif du cœur.
Le poème ou la cendre. La cendre de l’amour ou la vie…
Le recueil de Guy Allix est placé sous l’égide, juste, de Saint Augustin : « Celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa passion. » Ses poèmes sont aussi une histoire, un parcours. Récit de l’homme qui accepte la chute. Récit du poète qui enchante l’instant suspendu. L’écrivain qui prend le risque de la vie et du temps, lorsque le temps même « s’affaisse comme un linge perdu ». Devenu Icare, le poète ressuscite l’instant amoureux, « l’instant consenti ».
« Il y aura le temps de mémoire
De mensonge parfois
Le temps si court d’exister encore
Et puis viendra peu à peu
Le temps de l’oubli
Infini. »
Ce recueil est l’histoire d’une âme. On l’entoure de silence. Elle vibre, palpite, résiste, « dans la nuit de vivre ». On l’écoute.
Et ne rien ajouter…
« Je ne sais que cette voix qui ne sait pas
Et qui s’insurge
Et qui crie malgré tout
De dépit et de rage. »
…que la voix de Beckett :
« Cette voix qui parle, se sachant mensongère, indifférente à ce qu’elle dit, trop vieille peut-être et trop humiliée pour savoir jamais dire les mots qui la fassent cesser, se sachant inutile, pour rien, qui ne s’écoute pas… en est-elle une ?
Elle n’est pas la mienne, je n’en ai pas, je n’ai pas de voix et je dois parler, c’est tout ce que je sais, c’est autour de cela qu’il faut tourner, c’est à propos de cela qu’il faut parler. »
Gwenaëlle Ledot.
Guy Allix, Survivre et mourir, éditions Rougerie, mars 2011, 15 euros.
 Un phare allumé sur mille citadelles…
Un phare allumé sur mille citadelles…
Poètes normands ? Poésie en Normandie ? L’ambition de Christophe Dauphin, auteur de Riverains des Falaises (anthologie des poètes en Normandie du XIe siècle à nos jours), est de questionner cette relation, sa légitimité, son sens. Quelle harmonie secrète entre le pays et l’art des mots ?
« La poésie est cet art très ancien et très neuf à la fois, par lequel les Normands, pour les meilleurs, ont toujours fracturé la réalité intérieure. La poésie parle face à l’abîme que nous sommes, n’avons cessé, et ne cesserons jamais d’être. La normandité pourrait qualifier cet état. C’est une affinité secrète qui relie entre eux les poètes normands. »
Qui sont les sentinelles de la normandité ? Le choix entre les poètes est difficile, évidemment subjectif, subjectif et revendiqué. L’ouvrage est riche et foisonnant, le lecteur est tenté de le dire complet : la réussite est totale.
Commence, sous l’égide de Léopold Sédar Senghor, un merveilleux voyage dans un pays, un langage, une culture qui se construit en métissage : « Je dis que les Normands sont des métis culturels… La normandité est, d’un mot, une symbiose entre les trois éléments majeurs, biologiques et culturels, qui composent la civilisation française : entre les apports méditerranéens, celtiques et germaniques. »
L’élan épique inaugure l’ouvrage : le premier chef-d’œuvre de la littérature française, La Chanson de Rollant, est en anglo-normand… Le Roman de Rou, de Wace, retrace l’histoire des ducs de Normandie. Viennent ensuite, sous la plume de Béroul et Thomas, la légende de Tristan, et d’Iseut la blonde.
Le seizième siècle est également florissant en Normandie : Christophe Dauphin rappelle à nous Pierre Gringore, personnage emblématique d’une tradition essentielle en Normandie, celle des grands satiristes. « Sots lunatiques, sots étourdis, sots sages / Sots de villes, de châteaux, de villages… » signe le très savoureux « Cri du prince des sots ».
Viennent au dix-septième siècle Saint Amant, Corneille et Scudéry… Certains moins connus, telle Madame de Villedieu, dont on découvre avec heureuse surprise les sonnets, jugés à l’époque scandaleusement libertins.
Dans ce jardin des délices, on croisera l’hydropathe Jean Lorrain, le symboliste Remy de Gourmont et le flamboyant Barbey… Rues de Valognes hantées par Gustave le Rouge, la grande lande de Lessay parcourue par Louis Beuve, l’espace normand soudain fragmenté par Jean Follain.
Enfin, l’auteur consacre une section indispensable aux Normands d’adoption : Hugo et Prévert, Neruda et Senghor… les contemporains Hughes Labrusse et Guy Allix : « Nous rentrerons dans l’ombre / Dont nous n’étions jamais sortis / Autrement que par cet amour »
Qu’est-ce alors que la normandité, Christophe Dauphin ? « La normandité pourrait donc bien se définir par un sens aigu et blessé du réel, par le je hypertrophié de l’individu, un état d’être vissé aux tripes comme la naissance et la mort. » La Normandie par le poète, enfin :
« Maisons bleues s’y mêle le gris du ciel »
« Cette pierre qui boit les regards comme en prière ». (Loïc Herry, Ouest)
Riverains des Falaises, de Christophe Dauphin, éditions Clarisse, novembre 2010, 533 pages, 20 euros.
Gwenaëlle Ledot
 Solstice
Solstice
Lorsqu’on sait que le temps s’est déjà écoulé. Lorsqu’on décide de profiter des derniers rayons : Philippe Delerm, à soixante ans, dit être passé de l’autre côté du solstice d’été. « Il y aura encore des jolis soirs, des amis, des enfances, des choses à espérer. Mais c’est ainsi : on est sûr d’avoir franchi le solstice. » Il devient nécessaire et urgent de se placer du bon côté de la vie : Le trottoir au soleil (titre de son dernier opus) traque les rares lumières de l’existence. Au-delà, il s’agira de saisir la bulle d’éternité qui se cache dans les parcelles et les étoiles du quotidien… Les miettes lumineuses d’une vie par avance disparue. Le regret et l’angoisse percent sous sa plume, de façon assez nouvelle. L’espérance est violente, la célébration de la vie se teinte de renoncement, et semble mendier des leitmotivs déjà échappés : un dîner au soleil, en été. Une terrasse de café au printemps. Le goût, profond et léger, d’une poignée de cerises noires. Un ailleurs flottant, « au nord de soi », à Bruges. Et la littérature, parfois. Pour « tailler à l’infini la route d’une intime vérité. »
Le trottoir au soleil, de Philippe Delerm, Gallimard, novembre 2010, 181 pages, 14,90 euros.
Gwenaelle Ledot
 Nymphéas noirs
Nymphéas noirs
Giverny et Monet. Les jardins, les nymphéas, toujours recommencés. Les nymphéas seront noirs cette fois, car le polar s’invite au cœur de la mémoire impressionniste : le romancier Michel Bussi (auteur de Code Lupin et Omaha crimes) emmène son lecteur dans un village-souvenir, où évoluent trois silhouettes féminines : une vieille femme en grand deuil, une jeune institutrice et une fillette artiste. « La première était méchante, la deuxième était menteuse, la troisième était égoïste ». Ce conte étrange, né de l’aquatique et du végétal, prend pied et prend fin dans une atmosphère onirique qui tout entier l’absorbe.
Les trois silhouettes dessinent dans Giverny une ronde macabre. Et lorsqu’un médecin, Jérôme Morval, est retrouvé assassiné, ses maîtresses deviennent rapidement des suspectes. Fleurs du deuil, sirènes et Mélusines, les figures féminines occupent l’espace, autant que les pensées du personnage central.
Dans l’air tremblé, l’atmosphère presque engluée de ce trompe-l’œil impressionniste, les lecteurs de Michel Bussi goûteront aussi les clins d’œil qui s’échappent plaisamment du polar : présence (discrète !) du Normandie Magazine, allusions à quelques best-sellers contemporains, refus du pittoresque figé.
Les trois femmes – en rose, en gris, en noir – captivent le jeune policier Laurenç Sérénac, fraichement débarqué du Sud. La tension et le suspens vont ainsi, crescendo, au sein du village-lumière. Mais les mystères qui s’y révèlent, sous l’égide d’Aragon, sont de l’humain avant toute chose : « Une plainte étranglée en renaît plus touchante / Quand l’écho la reprend avec fidélité. »
Gwenaëlle Ledot.
Nymphéas noirs, de Michel Bussi, Paris, Presses de la cité, janvier 2011, 438 pages, 21 euros.