Virginie Despentes, Vernon Subutex 3
« La farce atroce de durer »
Les voix de Vernon Subutex, mêlées, sont celles des marginaux et des employés, des anarchistes et des bourgeois, de droite, de gauche et de nulle part. Bruissant, hurlant, criant le monde avec âpreté : « A ce stade de laideur, ça doit vouloir dire quelque chose. »
Un souffle de colère porte sans aucun paradoxe l’empathie de l’auteur pour les Misérables du nouveau millénaire, autant dire chacun d’entre nous. La polyphonie absorbe le siècle pour mieux le recracher. L’énergie textuelle gratte et écorche les surfaces. Creusant, acharnée, les entrailles de l’humanité.
Pourquoi ces gens quand ils accèdent au pouvoir, cessent de dire la vérité. Pourquoi ils ne s’assoient pas au micro pour raconter, simplement, “voilà comment ça s’est passé”. Voilà comment j’ai défendu une idée, que je croyais juste et bonne, et voilà comment on m’a convaincu de conduire mon pays à l’abattoir.
Nul n’échappe au chaos socialement organisé et au jugement cru des narrateurs : « C’est la seule différence entre le sociopathe et le militant politique – le sociopathe se contrefout d’être dans le camp des justes. Il tue sans les préliminaires, c’est-à-dire sans perdre de temps à construire sa victime comme un monstre. Les militants, eux, font ça correctement : d’abord la propagande, et ensuite seulement le massacre. »
L’éponyme et insaisissable Vernon Subutex a accédé au cours du deuxième tome à un statut de leader spirituel, incarnant par la magie des « convergences » une lumière vacillante. De cette parenthèse enchantée, il ne sera jamais dupe : « Il pense que personne n’est solide. Rien. Aucun groupe. Que c’est le plus difficile à apprendre. Qu’on est les locataires des situations, jamais les propriétaires. » L’auteur fait de Vernon le premier et le dernier témoin du naufrage qui emporte les êtres : ceux qui croient être tout, et ceux qui (disent-ils) ne sont rien…
Ce corps à nous, travesti de molécules agitées et banales, tout le temps se révolte contre cette farce atroce de durer.
(Céline, Voyage au bout de la nuit)
Vernon Subutex 3, Virginie Despentes, Grasset, mai 2017.
Gwenaëlle Ledot.




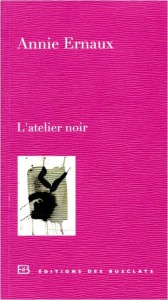





 Caeco carpitur igni (1)
Caeco carpitur igni (1)



