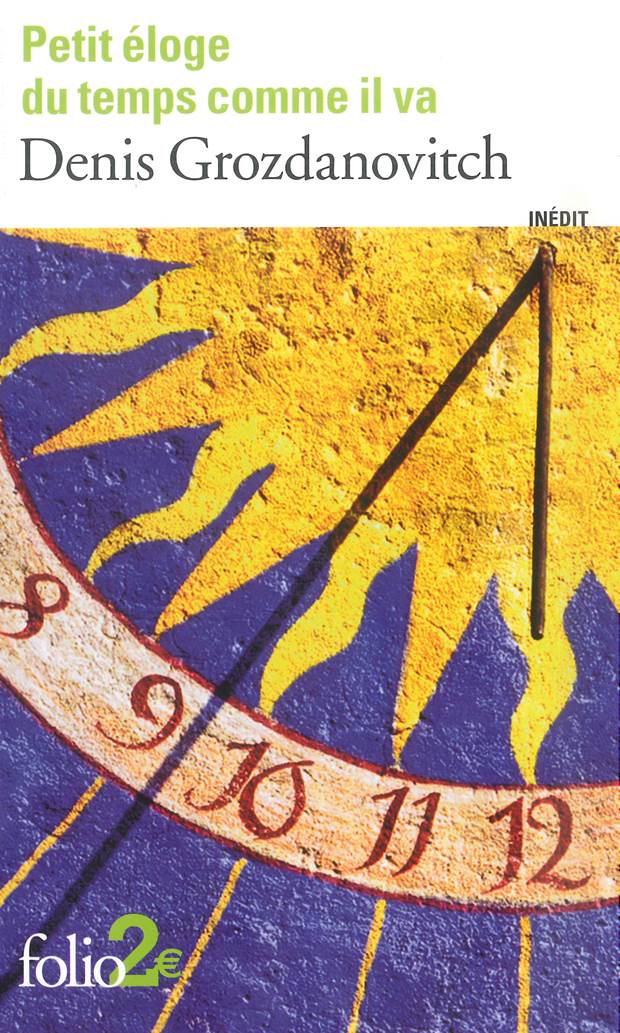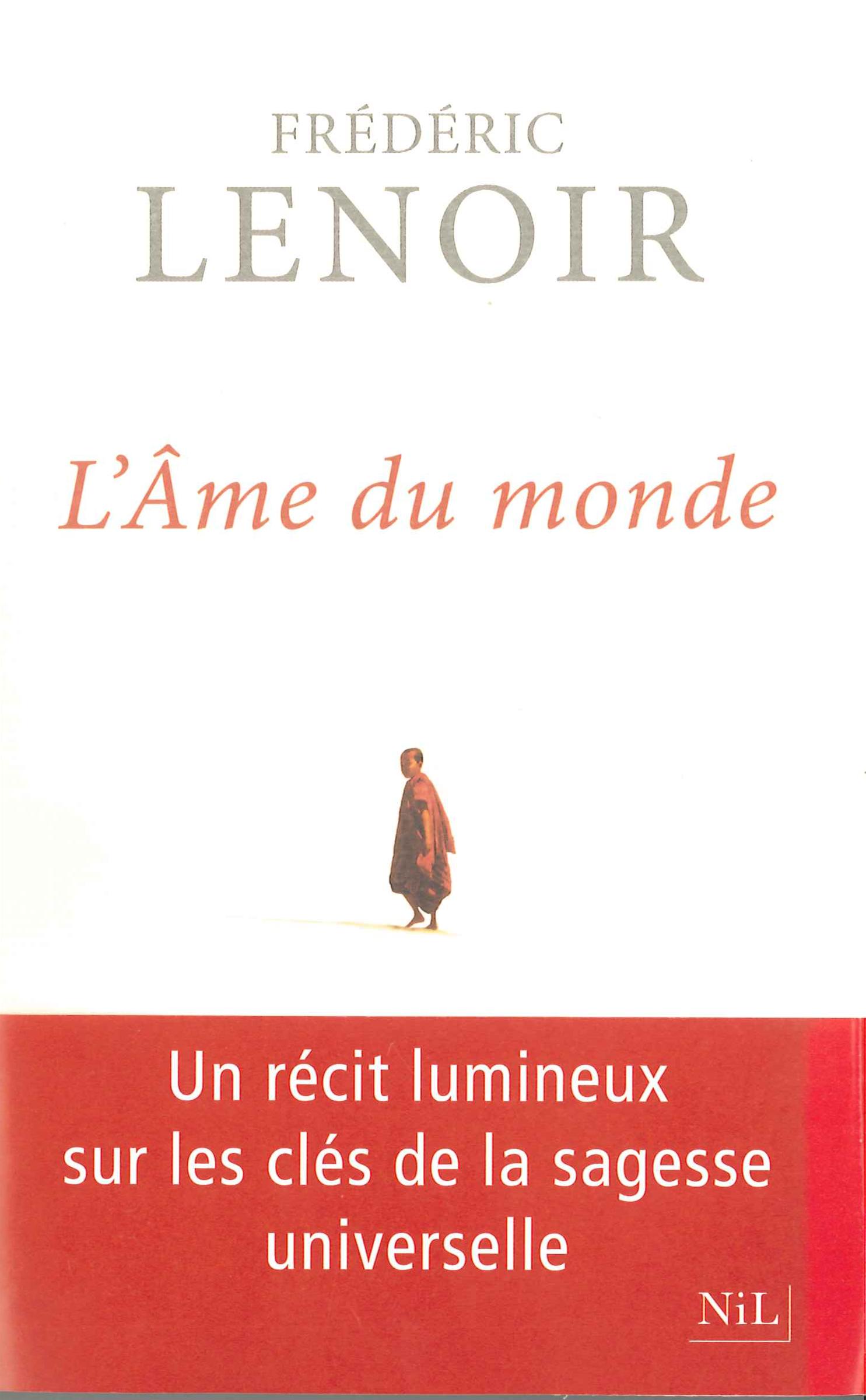Brassens, une magie reparue

Un essai sociologique fait renaître la magie de la poésie chantée : Salvador Juan démontre en quoi (et dans quelle écriture) Brassens a tracé un portrait génial et inédit d’une certaine société française, composant, à sa manière provocatrice et quasi surréaliste, un tableau kaléidoscopique. L’auteur fait appel à Jean Duvignaud pour mettre en lumière une transgression des normes qui « porte aussi les germes de la résistance humaine et peut engendrer du changement social. »[1] ; à Edgar Morin pour éclairer la situation (complexe) de l’artiste au regard de la culture de masse ; à Elisabeth Badinter pour rendre compte d’une (bien regrettable) essentialisation de la femme, perceptible dans la plupart des textes : Brassens, pointe à ce propos une jeune sociologue, a toujours dépeint les femmes comme « appartenant à une « espèce à part », qui « n’entreront pas dans le club de l’amitié virile où tout est simple et beau, entre individus libres et égaux… »[2] S. Juan souligne quant à lui que le poète a pour essence de « capter et synthétiser l’esprit du temps… », sur ce sujet comme sur bien d’autres…
D’autres facettes, plus souriantes, de Brassens sont élégamment illustrées par d’abondants extraits de l’œuvre : son écriture facétieuse, au service d’un imaginaire puissant, génère des « pantalonnades » riches de sens ; sa méfiance salvatrice assassine les enrôlements suspects et les emportements idéologiques, quels qu’ils soient. L’auteur livre également une subtile analyse des problèmes infinis que posent aux traducteurs étrangers les textes ciselés de Brassens (et d’en montrer aussi les réussites, comme autant de preuves qu’un « traduttore » n’est pas inéluctablement « traditore »…) Le polisson de la chanson, très conscient des ressorts et de l’influence de son art, s’inscrit résolument dans une tradition littéraire, de Villon à Rabelais, Hugo et Aragon ; et l’analyse du discours à laquelle se livre l’auteur met en lumière ses trouvailles verbales innombrables, un art indiscuté de la concision et de la formule, pour parvenir très logiquement à cet énoncé de reconnaissance bien légitime :
“Le prix Nobel de littérature colombien Gabriel Garcia Marquez déclare en 1981 : « Il y a quelques années, au cours d’une discussion littéraire, quelqu’un m’a demandé qui était le meilleur poète contemporain en France. J’ai répondu sans hésitation Georges Brassens.”
Salvador Juan, Sociologie d’un génie de la poésie chantée : Brassens, Le Bord de L’eau éditions, janvier 2017.
Gwenaëlle Ledot.

De l’Âne.

Une icône paradoxale de la bêtise ? Denis Grozdanovitch a beau jeu de démontrer, dans les premières pages de son essai, que l’âne n’est pas celui qu’on croit : les cruautés infligées à l’animal n’en finissent-elles pas de désigner l’ineptie abyssale de l’être humain ? Le poème de Francis Jammes « Prière pour aller au paradis avec les ânes », révèle, à la clef, sa conviction profonde : l’empathie avec le vivant préserverait l’esprit humain des nombreuses ornières de la bêtise.
Dans le catalogue que l’auteur se propose d’établir, la « bêtise primordiale », celle des animaux, est salutaire :
“Or le bonheur qui est relié à la bêtise ressemble à un simple et sourd contentement dont le ronronnement du chat me paraît donner une idée exemplaire. Une dense et douce euphorie, proche de certaines extases matérielles. Une solide et compacte ataraxie où ne s’insinue aucune pointe d’angoisse.”
Être, ne point s’agiter, ni quêter jamais son essence dans l’agitation : « Le chat ne fait rien, il « est », comme un roi. » Une idée toute schopenhauerienne parcourt ces pages : la non-coïncidence avec le réel fait le malheur de l’homme ; tout comme le refus de percevoir cette impuissance spécifique, et de saluer la supériorité animale à cet égard : « En réalité, cette conscience aiguë, dont nous sommes si fiers et qui va de pair avec notre faculté d’abstraction et avec notre volonté de planification systématique, est aussi ce qui fait notre malheur, qui empoisonne nos vies à petit feu… ».
Guidés par une plume dansante, nous découvrons la « bêtise de l’intelligence » : elle dépend, semble-t-il, de « modèles » et de « postures » qui finissent inéluctablement par gommer la complexité mouvante du réel, pour tous ceux qui détiennent la clef explicative (et définitive) de l’existence…(1)
“…savoir que nous passionner pour une idée, pour une théorie, est inévitable, mais garder en même temps à l’esprit que ça n’est qu’une posture, une posture tout aussi bête que toutes celles qui nous apparaissent comme telles chez les autres.”
La bêtise savante est perceptible dans les démonstrations les plus brillantes des plus grands esprits, où se glissent çà et là quelques raisonnements incertains, dont l’auteur pointe habilement les failles. C’est l’occasion d’un rappel à l’humilité : « Quand ça devient trop sophistiqué, j’invoque le sens commun pour qu’il m’assiste » . Car c’est une aventure périlleuse que de vouloir mettre en concepts une réalité héraclitéenne :
“Quelle que soit la valeur, la puissance de pénétration d’une explication, c’est encore et encore la chose à expliquer qui est la plus réelle, - et parmi sa réalité figure précisément ce mystère que l’on a voulu dissiper.” (3)
On n’oublie pas la bêtise névrotique, intégrée aux formes multiples de la bêtise ordinaire : conduites répétitives, comportements absurdes et d’échec, auxquels les esprits brillants ne sauront échapper ; ou encore la bêtise « sociétale » (snobismes esthétiques ou dogmes contemporains, objets de descriptions réjouissantes). On se dira que l’empan est bien large, et que les manières d’être bête donnent l’embarras du choix… La catégorisation importe-t-elle vraiment ? Se dégagent de ces pages, telle une brume rafraîchissante, l’incertitude de toute chose, le risque qu’il y a à théoriser de façon définitive et l’impérieux désir de rejoindre par des chemins divers (jeu, méditation, contemplation) une réalité plus immédiate… Osera-t-on écrire que l’on se sent moins sot à la lecture de cet ouvrage, truffé de références érudites et malicieuses, et dont l’élégance distanciée prévient tout risque de bêtise savante ? L’écriture, avançant à sauts et gambades, mêle l’examen minutieux de textes exigeants à des petits faits narrés avec simplicité, rencontres fécondes et émerveillements esthétiques. « Venez, doux amis du ciel bleu… »
Le Génie de la bêtise, Denis Grozdanovitch, Grasset, janvier 2017.
Gwenaëlle Ledot.
 « Ne regardez pas en vous-même, vous ne trouverez rien. »
« Ne regardez pas en vous-même, vous ne trouverez rien. »
Cette phrase du philosophe Clément Rosset, reprise par Annie Ernaux, fait signe et éclaire son œuvre. L’enjeu, dans ces entretiens de 2014, ne sera jamais de « parler de soi », ni même de « parler de ses livres »… Mais de jeter une lumière subtile et précise sur le projet d’écrire, et ce qu’il génère. Se projeter dans un lieu qui est un entre-deux. Entre-deux de lecture-écriture. L’entre deux cultures, pour un écrivain socialement « transfuge ». L’entre deux mondes : celui des faits quotidiens, et celui, tout à côté, où l’on construit le texte. Lisant Annie Ernaux dans ces entretiens avec Michelle Porte, on l’imagine créant sa bulle paradoxale ; la construction d’un édifice (elle parle d’une « maison »), pièce à pièce, un bâtiment textuel. Un lieu ouvert qui dialogue avec le monde « du dehors », auquel elle reste intimement et volontairement connectée : Cergy, des centres commerciaux, des collèges, des paroles et des rues. Le lieu des « Journaux extérieurs ». Le lecteur rappelle à lui Yvetot, village du passé et l’image d’une sœur ; puis Les Années, le petit chat mort dans la grande maison, et la silhouette puissante de la mère, encore.
« Ne regardez pas en vous-même… » Dans cet édifice s’amassent les pièces précieuses du « musée intérieur » qui, dit-elle, la constitue : les œuvres d’art, cinéma, peinture, qui construisent peu à peu la personne et le livre. Investissant un lieu autrefois sacré, l’auteur s’enferme dans sa bulle textuelle, et s’ouvre simultanément. Quand il s’agit de perdre le monde pour mieux le retrouver, dans l’architecture d’une réalité éclaircie.
« … vous ne trouverez rien. »
Annie Ernaux, Le Vrai Lieu, Entretiens avec Michelle Porte, Gallimard, Paris, septembre 2014.
Gwenaëlle Ledot.
Les aubes spirituelles
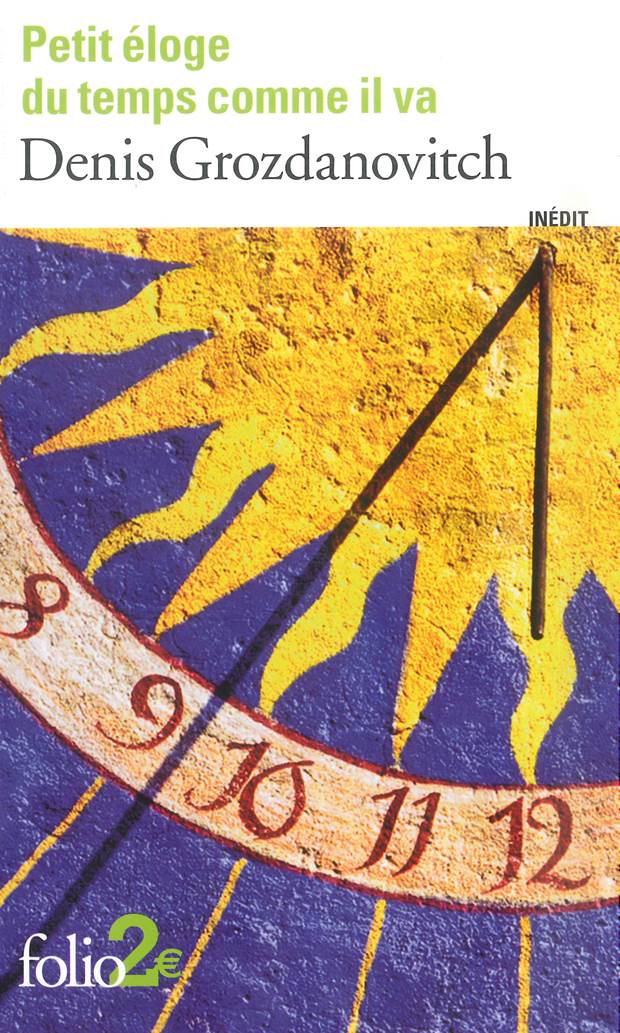
Comment saisir le temps, comment cueillir le jour ? Comment aborder ce texte de Denis Grozdanovitch, consacré au « temps comme il va » ? On imagine un lecteur installé à son aise sous une brise légère. Des bruits de feuillage. Quelques tomes de Proust à proximité et quelques pages relues : Jules de Gaultier et Schopenhauer, peut-être. C’est l’heure exquise et le temps retrouvé. Végétation et forêt se font garantes d’une certaine paix de l’âme : c’est le moment de se pencher sur la météorologie de l’esprit.
L’opuscule s’ouvre sur quelques mots surprenants, attribués à une vieille dame russe, tremplins de la réflexion :
Oui, messieurs. Il fait mauvais temps et nous attendons qu’il change. Mais il vaut mieux qu’il fasse mauvais temps que rien du tout et que nous attendions au lieu de ne rien attendre.
Il s’agit ici du temps qui va, inextricablement lié au temps qu’il fait. Au culte du Dieu soleil, l’auteur préfère décidément les nuances et mouvances météorologiques : l’asphalte mouillé des rues parisiennes, l’odeur sublimée d’un parc ou d’un jardin après l’averse. Ô, le chant de la pluie !
Endless rains, elles font renaître les souvenirs d’Angleterre, lorsque la pluie appelle la douceur du foyer ; un temps arrêté, celui, serein, de la lecture. Temps suspendu et par là même retrouvé. Endless rains : musique des mots, douceur de la mémoire.
Pour un cœur qui s’ennuie : quand le cœur s’ennuie, l’époque lui offre de petits écrans, de petits messages. La grande affaire contemporaine, c’est la vitesse et le réconfort addictif de l’immédiateté. L’esprit, le cœur sont entièrement absorbés par la machine. Engendrant une autre temporalité qui nous dévore ; rythmée par des objets qui nous demeureront fatalement extérieurs, mais insidieusement nous transforment. Qui nous éloignent de l’univers naturel, d’une nature animale, d’une très ancienne forme de spiritualité. L’auteur nous rappelle cette sentence de R. W. Emerson : « la mesure de l’homme est sa manière de saisir la journée. »
Viser la suspension du temps est largement illusoire, cependant. L’homme ne se vit lui-même que dans le flux et la projection. A chacun, alors, de reconnaître sa durée, personnelle et véritablement « appropriée ». Chaque instant prend un certain sens, écrivait Thomas Mann. Retrouver, envers et contre tout, contre l’époque présente et un malheur certes éternel, la saveur intrinsèque de nos heures.
« La rose
ne cherchait pas l’aurore :
presque éternelle sur sa branche,
elle cherchait autre chose.
La rose
ne cherchait ni science ni ombre :
confins de chair et de songe,
elle cherchait autre chose.
La rose
ne cherchait pas la rose.
Immobile dans le ciel
elle cherchait autre chose.»
(Federico Garcia Lorca, extrait de « Casida de la rose »)
Petit éloge du temps comme il va, Denis Grozdanovitch, Paris, Gallimard, « Folio 2 euros », août 2014.
Gwenaëlle Ledot.
« Les voix, chère Marceline… »

« Les voix, chère Marceline, ce sont les fleurs de l’éternel mises dans votre bouche ». Le premier chapitre, tel un chant qui s’élève, concentre la saveur du texte. La limpidité de l’écriture et le flux des mots portent les couleurs de la vie. Le rose sera destiné à la poétesse Marceline Desbordes-Valmore : la grâce intacte de son œuvre émerge, en floraison, au cœur d’un voyage froid. La « femme noyée de bleu » de Vermeer lit une lettre pour l’éternité, nichée dans son tableau, réfugiée dans son rêve d’amour sans fin. Les clochettes des campanules garderont le même bleu, la feuille de buis son vert sombre. Quelques pages plus loin, une larme, « plus précieuse qu’une perle », est l’évocation d’une souffrance translucide.
« Le cœur ignore le temps » : car la vie contient aussi la perte sanglante de l’être aimé, l’organe sanguinolent qui se déchire tous les jours. Rouge à l’infini.
Dans ce long deuil, l’auteur a choisi résolument de jeter un peu de lumière. On ignore si cette aurore fragile va persister.
Des bouquets de mots, des fleurs de cerisiers ; des anges écarlates, et des yeux d’encre. « Nul n’a jamais écrit ou peint, sculpté, modelé, construit, inventé, que pour sortir en fait de l’enfer », écrivait Antonin Artaud. Christian Bobin semble faire tout à la fois : sculpter des mots et peindre de petits soleils. Modeler une fleur, un animal, et rappeler à lui les plus grandes voix. Ronsard ici, Ernst Jünger un peu plus loin, et la pureté violente et fiévreuse de Kierkegaard ; ou encore Hölderlin, « mille fois mort avant sa mort ». Christian Bobin chante, lui aussi, sans ignorer la chute des cœurs. Ceux qui ont quitté, abandonné, avant les autres. Ceux qui sont perdus, et ceux qui vont briller. Les mêmes, peut-être.
« Tout donner, tout perdre, et qu’on n’en parle plus. »
Gwenaëlle Ledot
La grande vie, de Christian Bobin, Paris, Gallimard, janvier 2014.
« Seul l’art m’agrée, parti de l’inquiétude, qui tende à la sérénité. » (Gide)

Avec une curiosité sereine, nous ouvrons ce petit livre : Cinq méditations sur la mort (autrement dit sur la vie). Car nous connaissons bien l’œuvre de François Cheng, le thème du dialogue qui ponctue ses textes et son écriture limpide. Ses essais, réflexifs et profonds, des romans au lyrisme apaisé (Quand reviennent les âmes errantes en 2012) nous accompagnent depuis quelques années déjà.
L’avant-propos de l’éditeur Jean Mouttapa annonce pour ces Méditations une conception alternative de l’existence et une réflexion « en spirale ». Ce qui est tout à fait exact, à condition de ne pas négliger le fait suivant : François Cheng se considère comme un « passeur » entre deux cultures. Et pour étayer sa réflexion sur la vie et la mort (liées), il convoque aussi bien l’intuition du Tao que les poèmes de Keats et Shelley.
L’objet des textes : faire toucher du doigt le mouvant de l’existence, le flux de la vie qui porte aussi la mort.
« Oui, c’est cela, la vie : quelque chose qui advient et qui devient. Une fois advenue, elle entre dans le processus du devenir. Sans devenir, il n’y aurait pas de vie ; la vie n’est vie qu’en devenant. Dès lors, nous comprenons l’importance du temps. C’est dans le temps que cela se déroule. Or le temps, c’est précisément l’existence de la mort qui nous l’a conféré ! » (1)
Cette pensée trouve un écho chez R. M. Rilke, dont la poésie touche intimement François Cheng : l’individu peut lire en sa propre mort le prolongement de lui-même, le prolongement du mouvement de sa vie. Tel est le sens porté par ce vers de Rilke :
« Seigneur, donne à chacun sa propre mort. »
L’auteur fait sienne cette pensée, qui rencontre, très heureusement, certaines philosophies orientales :
« Par la suite, Rilke élargira sa vision. Mais d’ores et déjà, nous remarquons une singulière coïncidence : l’intuition du poète correspond de près à la grande leçon dispensée par Lao-zi dans le Livre de la Voie et de sa vertu. Lao-zi affirme, au chapitre 25, que la marche de la Voie est circulaire. » (2)
Bonheur de la coïncidence. Etonnante convergence qui rapproche la plus ancienne pensée chinoise du poète allemand.
« Rilke ne connaissait pas le taoïsme. En tant que poète de langue allemande, il fut d’abord marqué par les grandes figures de la poésie germanique : Goethe, Hölderlin, Novalis, Heine, etc. »
Et traversant la souffrance amoureuse, Goethe, comme Rilke, comme Hölderlin, ont exploré une voie différente, appelée « L’Ouvert ». Un « double royaume » qui unit en son sein perceptions de la vie et de la mort. L’image qui s’impose entre les lignes fluides est un cheval blanc qui court, réminiscence des Sonnets à Orphée : icône animale, libérée des limites de l’existence perceptible.
« L’animal libre a toujours son déclin derrière lui ;
Devant lui, Dieu. Quand il avance, c’est
Vers l’éternel, comme coule une source. » (3)
Ce regard nouveau suggère d’envisager la mort, non comme une fin absurde, mais comme le fruit de notre être. Qui saura rejoindre, peut-être, « le chant de la haute enfance ».
« La vie engendre la vie, il n’y aura pas de fin. »
Le véritable exploit littéraire, le grand talent de François Cheng se révèle un peu plus loin – troisième méditation - dans cette faculté à dire l’humain, le réel, jusque dans la description de l’insoutenable. Qu’il appelle sobrement « le mal », et qu’il décrit sans détours, comme immonde inhumanité. Et de réaffirmer, au cœur même des enfers inventés par les bourreaux, l’essence humaine et la flamme de vie des victimes. Elle est retrouvée, célébrée par la phrase immémoriale.
« La vie engendre la vie, il n’y aura pas de fin. »
Gwenaëlle Ledot.
Cinq méditations sur la mort, autrement dit sur la vie, de François Cheng, Paris, Albin Michel, octobre 2013.
« Mais ami, nous venons trop tard. » (Hölderlin)

« Sérendipité » : à la clef du dernier essai de Denis Grozdanovitch. Sérendipité, quel drôle de mot…
Traduit de l’anglais « serendipity », lui-même néologisme, il désigne une forme de sagacité, et la capacité à s’emparer des hasards heureux. Reconnaître sa chance. Et finalement compter sur l’inopiné, l’inattendu, l’inespéré.
Mot bien étrange, à la clef d’un très beau texte. Glissant sur le flux méditatif, la pensée qui avance. Fluide et serein comme une eau bleue. Porté par une sagesse ancienne et une plume élégante, Denis Grozdanovitch chemine. Lectures anciennes et contemporaines, fameuses ou non, nourrissent la réflexion. Le texte avance en dansant, livre quelques clartés, doucement. Il est question de « restituer au monde sa chatoyante diversité » : oscillation dans le texte entre l’acceptation du flux et l’imposition du sens, la crispation rationaliste et le lâcher-prise salvateur.
« Il n’y a rien de plus naturel que le hasard ni de plus constant que l’imprévu. L’ordre, en somme, est une entreprise antinaturelle. » Rencontres heureuses, au hasard de l’écriture : Paul Valéry et Montaigne, Jules de Gaultier et le Yi-King… Le texte fait toucher du doigt cette certitude : celle du changement perpétuel. C’est un monde héraclitéen qui se dévoile sous nos pas. L’on connaît la nécessité, peu à peu, de percevoir le mouvant, toute une part du monde qui n’offre pas de prise ; tout ce qui, enfin, échappe au rationalisme et au scientisme.
Urgence, enfin, de quitter la lettre pour l’esprit :
« Le pire des mensonges est de dire la vérité, toute la vérité, en cachant l’âme des faits. »
La puissance discrète du hasard, de Denis Grozdanovitch, Paris, Denoël, février 2013.
Gwenaëlle Ledot.
 Les choses tues.
Les choses tues.
Dans cet essai virevoltant, on reconnaît une écriture entre mille : gracieuse, délicate, légère. Autant de qualificatifs autrefois attribués par Charles Dantzig à Marivaux. On conclurait volontiers à l’identique : « C’est un vol de roses, cet homme ».
Que sont les chefs-d’œuvre ? Inclassables, tenaces, immédiats ? Jeunes éternellement. Nécessaires. « Mais qui sont-ils, dis-moi, ces vagabonds, ces êtres / un peu plus fugitifs encore que nous-mêmes ? »
L’intuition qu’il n’y a rien de commun, et pas nécessairement de règles. Qu’ils imposent par surprise leur couleur, ou leur musique (musique et couleur qui sont bien autre chose que la vie, même si elles portent aussi la vie). Pas un simple récit, ni une simple narration. Car notre vie est « pleine de hoquets, de riens, d’inutilités, d’illogismes ». Sottement bariolée. Le chef-d’œuvre, au contraire, sera une victoire sur l’informe.
La narration n’est pas nécessaire aux chefs-d’œuvre, et le « sujet » généralement pas ce que l’on croit. Oublions démonstration, cause et message.
Alors quoi ? Une vision, un langage ? Une nécessité de dire, parce que « les choses tues tuent ». Une architecture parfois, mais pas toujours telle qu’on l’imagine : ici, Madame Bovary devient « une rue à arcades, élégante et morne » et La Recherche une lasagne farcie…
Les chefs-d’œuvre sont - cela est acquis - anarchistes : autant de petites bombes dans les certitudes et les essais explicatifs. Car le chef-d’œuvre échappe, par essence : « chaque société a régulièrement inventé des causalités utiles, main de Dieu, psychologie, social, et régulièrement des chefs-d’œuvre sont venus les saboter. Le chef-d’œuvre est un anarchiste qui pose une bombe dans les paresses. »
Avec quelque chose de Marivaux, et quelque chose de Voltaire. Le texte circonvient la question par le style, la finesse et l’ironie, bien sûr. Il s’agit de conjurer l’ennui et défier l’issue fatale. Sans espoir, mais de chic.
« Quel ennui serait la vie sans chefs-d’œuvre. Seuls la plupart des hommes pourraient y vivre. »
A propos des chefs-d’œuvre, Charles Dantzig, Paris, Grasset, janvier 2013.
Gwenaëlle Ledot.
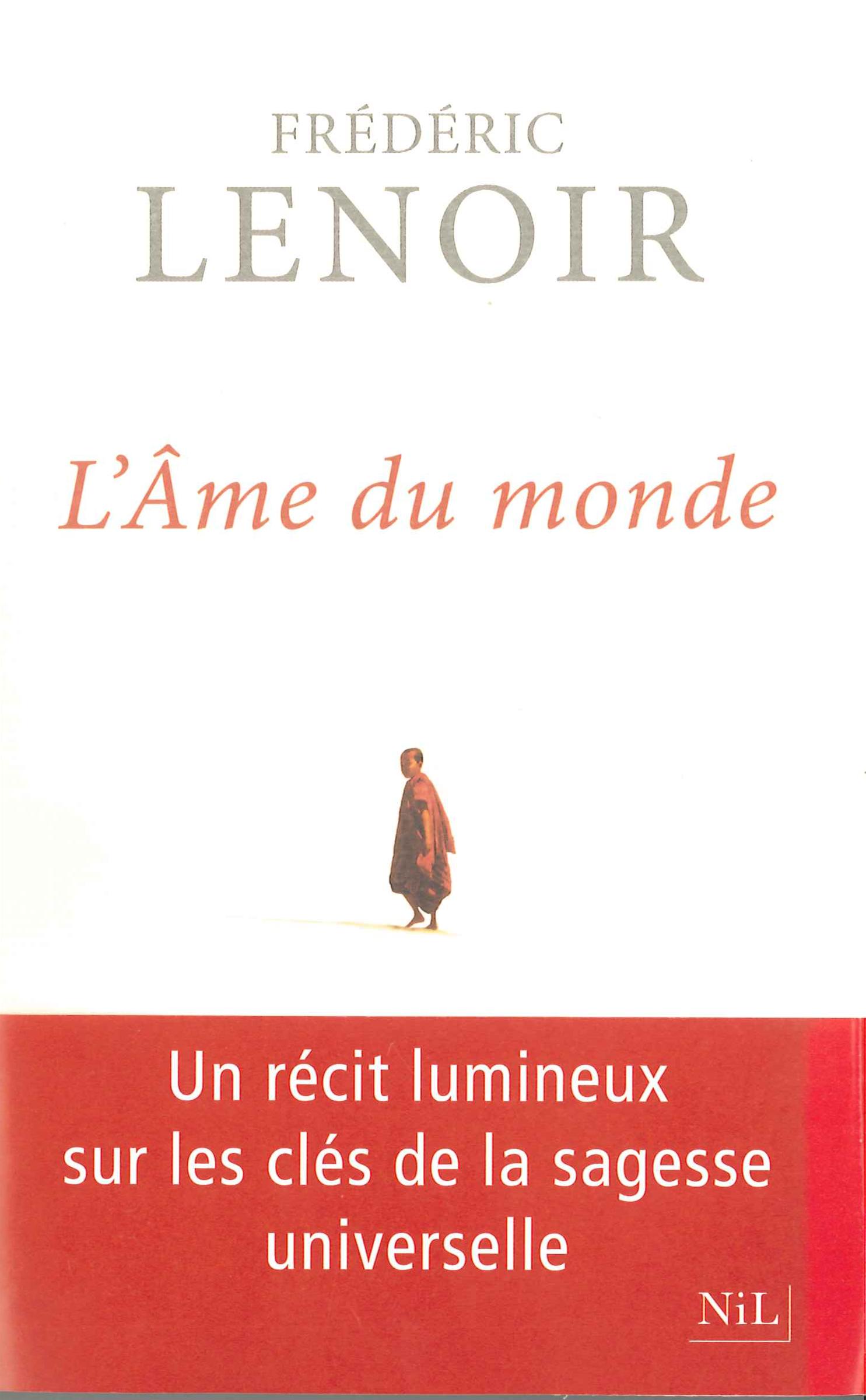 Les voix du GPS
Les voix du GPS
Les voix (voies ?) du GPS sont impénétrables : un sage chinois, maître Kong, découvre un jour sur son écran des coordonnées mystérieuses : latitude et longitude du sanctuaire de Toulanka. Cet appel aussi énigmatique qu’inattendu le convainc et il décide de rejoindre ce monastère tibétain. D’autres sont appelés : une philosophe néerlandaise, une mystique hindoue, un rabbin kabbaliste juif, un maître soufi musulman, une femme chamane, un moine chrétien, un maître du Tibet… Huit sages, représentants des principales traditions philosophiques et des grands courants spirituels du monde sont ainsi réunis.
Frédéric Lenoir n’avance pas masqué : de la part du philosophe, historien des religions, on s’attend à une fable, des paraboles, un petit vadémécum de sagesse pour les nuls… Ce que le titre du chapitre 4 semble confirmer, façon conte philosophique : « Une source, un éléphant et une montagne ».
L’intuition d’une source commune s’impose à eux : celle de la vie et de l’amour. A partir de ce commun identifié, les sages développent deux images illustrant leur quête : l’éléphant symbolise la fragmentation possible de la sagesse universelle. La montagne montre l’importance de la quête elle-même : c’est le cheminement qui compte, non le point d’arrivée. Convaincant.
Quelques songes terrifiants catalysent l’énergie spirituelle des huit sages et leur permettent d’identifier clairement le but : « formuler ensemble les fondements universels de la sagesse » (assorti d’ailleurs d’une gageure : « dépasser nos différences »).
On demeure en revanche surpris (déçu ?) par la représentation de la pensée laïque : la philosophe qui censément la porte est spinoziste, ce qui donnera : « Dieu se confond avec la Nature. […] Il est une force impersonnelle qui demeure en tout être et apporte son harmonie au monde. » Aïe ! Dieu si vite de retour ? Plus loin il sera question de « l’énergie spirituelle qui maintient en harmonie la Nature ». Hem ! Laïcité molle, à tout le moins…
Cet obstacle digéré, le reste coule de source, et se lit avec grand plaisir. Impression délicieuse de syncrétisme où l’on retrouve, sur le chemin : « Deviens ce que tu es » (mais qui a dit… ?) « Tout dans le monde est soumis au changement. » (qui encore ?) « On ne naît pas libre, on le devient. ». « Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu’il te fasse… »
Sept points principaux seront développés, qui résument « l’essentiel de la sagesse humaine ». Apprendre à vivre est nécessaire, car « nous sommes seuls, nous sommes nés seuls et nous mourrons seuls… » Par la voix des sages on rencontrera Socrate, Héraclite, Bouddha… On est en bonne compagnie, et Frédéric Lenoir un narrateur fort plaisant. Idées fortes, nécessaires. Anecdotes souriantes et judicieuses. Humanisme chaleureux.
Ce petit trésor ainsi rassemblé, de manière digeste, demeure jusqu’à la fin un vrai plaisir de lecture. Séduisant quand on ne l’attend pas, dans ses questionnements incarnés : et continuer à espérer lorsqu’on a tout perdu.
L’âme du monde, de Frédéric Lenoir, éditions Nil, mai 2012.
Gwenaëlle Ledot.
 Peintre de la vie moderne
Peintre de la vie moderne
« Life is a bitch, and then you die » (proverbe anglais)
Notre époque (postmoderne, hype, bio, numérique, twitteuse, infantile, inculte et dérisoire) se dessine sous la plume aguerrie de Pascal Fioretto. L’auteur croque avec gourmandise (et l’élégance du maigrichon) quelques figures alphabétiquement ordonnées : l’Adulescent, l’Artisan, l’Arty, le Blogueur, le Cadre… Morceau choisi : la visite de l’artisan.
« A la torture physique (la radio calée sur Chéri FM et la trépigneuse hydraulique à mèche titane qui fait sauter les plombs), l’artisan ajoute volontiers la culpabilisation : « Ouh là là ! Mais ça fait combien de temps qu’il a pas décolmaté le réinjecteur ? » et la punition humiliante : « On a un problème pour aléser le rivet de sertissage de la vrillette du chauffe-eau : vous allez rester trois semaines sans manger ni vous laver. »
Les portraits défilent, irrésistibles, jubilatoires : si donc le sourire peut sauver du désespoir, Desproges est vivant. Même verve, même justesse dans l’instantané (numérique, bien sûr).
« La sagesse populaire oppose couramment le cadre du privé, payé avec notre argent, et le cadre du public, payé avec nos impôts. Mieux rémunéré, le cadre du privé peut s’offrir une maîtresse à talons hauts et un infarctus foudroyant tandis que le cadre du public doit se contenter d’une secrétaire en arrêt maladie et d’une dermite chronique. Dans l’Eurozone, les espèces les plus courantes sont le cadre exploité, le cadre surbooké, le cadre stressé, le cadre pressuré, le cadre harassé, le cadre séquestré, le cadre suicidé et le jeune cadre. »
Lettre à lettre, Fioretto devient le chantre du Blues des aires d’autoroute, le rhapsode des retours en RER, le ménestrel des abonnements au Gymnase club et des open space… Douce petite musique de l’ère moderne: on-line shopping, speed dating, fast divorcing…
Sélectionnons dans ce Petit dictionnaire énervé, et par snobisme pur, l’entrée « Weltanschauung » : « Plus mes cheveux tombent, plus ma Weltanschauung s’éclaircit. A croire que c’était ma frange Jean-Louis David qui m’empêchait de bien voir les trucs importants. »
Désenchanté et désabusé, d’une ironie tranquille, l’auteur suit son temps. Une certitude : l’écriture sauvera tout cela.
(Marco aussi, peut-être.)
Nos vies de cons, Petit dictionnaire énervé, de Pascal Fioretto. Editions de l’Opportun, 2012.
Gwenaëlle Ledot.