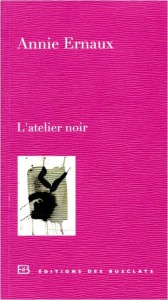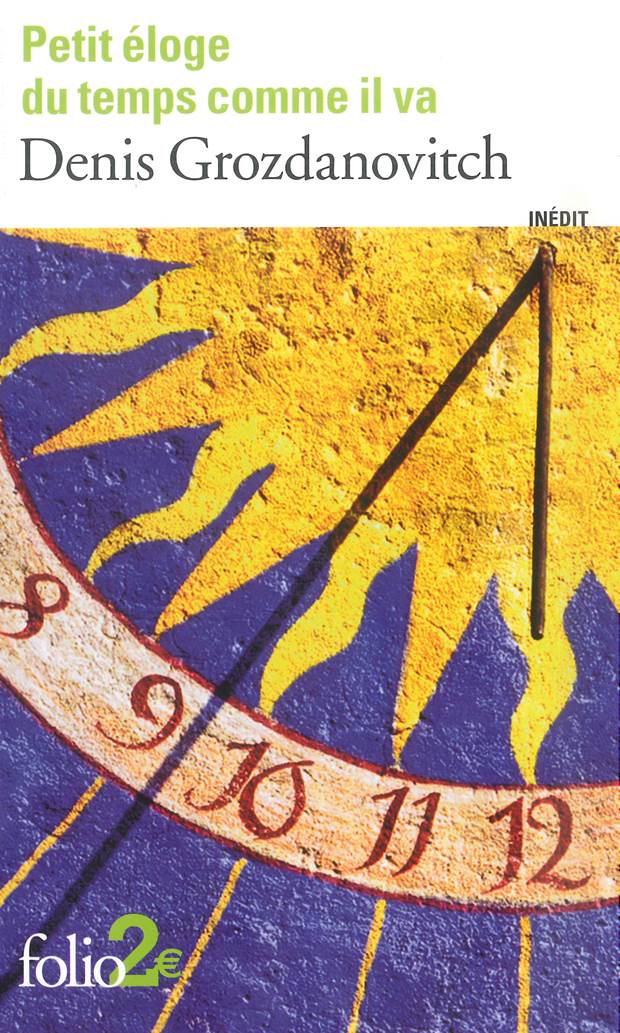Mémoire de fille, d’Annie Ernaux 
Qu’est-ce que la mémoire et qu’est-ce qu’une fille ? Saisir un fantôme, peindre une silhouette, attraper une « sylphide au fond de la coulisse » (1) ? Et creuser sans relâche, questionner un passé violent, interroger sans limites l’essence d’une fille qu’elle a (peut-être) été. L’objet du texte est explicitement réflexif, puisqu’on construit une identité par l’écriture. Quelle est la possibilité de comprendre ce qu’on a été un jour ? Quelle possibilité de l’appréhender par les mots ?
De quoi est constituée cette fille de 1958 ? Les données sociologiques et psychologiques sont vite survolées ; ce sont des images gravées par la souffrance qui vont donner l’élan au texte. Elles n’existeront que par les mots qui les informent. Car « l’autre fille » torture de la pâte à papier pour en exprimer une parcelle de vérité.
« Horloge ! Dieu sinistre, effrayant, impassible… »
Que se passe-t-il au moment où « la fille » cède aux avances d’un quasi-inconnu ? Qui est-elle lorsqu’elle se laisse emporter par la volonté d’un Autre ? Où est-elle lorsqu’elle abdique son être et sa conscience ? L’auteur décrit une « fille de chiffon », prisonnière de son désir confus et du désir émietté d’autrui : « Il m’est impossible de saisir tous les glissements, la logique, qui l’ont conduite à l’état où elle se trouve. » (2)
Elle est donc celle qui disparaît sciemment, pour explorer (peut-être) un anéantissement prévisible, et plonger au fond du gouffre. Elle est celle, aussi, constituée déjà de morceaux textuels : poèmes de Prévert et de Laforgue, phrases de Proust ou de Gide mémorisés. Elle est un nom (Annie Duchesne), mais ce nom pourrait être un autre (Duménil), et plus tard ne sera plus le sien.
Lorsqu’elle se cherche dans les autres du passé, quelques camarades de 1958, ceux-ci ont disparu (même sur Google). Il reste quelques scènes, monstrueusement distendues, tandis que d’autres « ponts » de la mémoire se sont absolument effacés. Caprices du souvenir.
La saisie et la construction du moi par le texte restent eux-mêmes frappés d’insuffisance et d’impuissance : « Il manque toujours ceci : l’incompréhension de ce qu’on vit au moment où on le vit, cette opacité du présent qui devrait trouer chaque phrase, chaque assertion. » (3)
Et encore ce déséquilibre vertigineux : qui étions-nous dans le regard des autres ? Que reste-t-il de nous dans leur esprit ? Ceux qui ont envahi et habité notre âme pendant des années nous ont mystérieusement balayés. Distorsion de la durée, disproportion des impacts.
« Le jour décroît ; la nuit augmente, souviens-toi ! »
Mais une phrase paradoxale écrite par la fille du passé, retrouvée dans les pages d’un journal, semble livrer la clef du récit, sinon la clef d’une vie : « Je ne suis pas culturelle, il n’y a qu’une chose qui compte pour moi, saisir la vie, le temps, comprendre et jouir. » La fille rend compte par anticipation de la lutte acharnée, parfois violente, menée par l’auteur pour saisir avec de l’encre quelques paillettes d’existence.
« Le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. »
Mémoire de fille, Annie Ernaux, Gallimard, mars 2016.
Gwenaëlle Ledot.

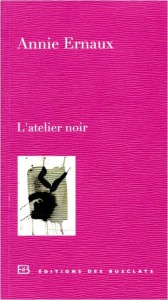



Humus

Le lieu initial est un hôpital psychiatrique, où Claire, l’une des narratrices, s’entretient avec un médecin. C’est cette conversation que retranscrit la majeure partie du roman. Cependant l’agencement du récit, un brin facétieux, met en scène plusieurs protagonistes dont l’identité et l’histoire sont mouvantes ; leurs parcours incertains se partagent entre celle qui vit et celle qui écrit, celle qui regarde et celle qui souffre, masques multiples et avatars d’une même âme. Celle que vous croyez ?
Ce sera donc l’histoire d’une femme et de son malheur, l’histoire de toutes les femmes et leur malheur commun, l’Insupportable d’un asservissement jamais démenti ; certainement, le « désastre féminin » (1) que décrivait un autre grand auteur français contemporain. Mais le constat fait place à l’émanation d’une folie individuelle, parfois vertigineuse et violente, parfois valse mélancolique ; celle qui, prise à la loupe, ouvre sur les nuances universelles du malheur.
“Être folle ? Ce que c’est qu’être folle ? Vous me le demandez ? C’est vous qui me le demandez ?
C’est voir le monde comme il est. Fumer la vie sans filtre. S’empoisonner à même la source.” (2)
L’obsession amoureuse qui devient progressivement l’objet de ces pages n’est qu’une manière parmi d’autres d’accéder à un état d’hyperlucidité ; celui qui nous fera saisir, conjointement, la force de la vie et son anéantissement.
“Elle s’était transformée en attente. Elle attendait, elle était entièrement occupée à cela : attendre. Qu’est-ce qu’elle attendait ? Rien, justement. Elle attendait un mort, qu’il revienne, elle attendait l’amour, qu’il arrive, elle attendait le pardon, qu’il lui soit donné ? […]
L’attente était devenue son être, l’attente avait dissous l’objet de l’attente. Elle était statufiée dans cette posture, un deux trois soleil éternel, Pénélope sans prétendants, Pénélope sans retour d’Ulysse, mais qui s’obstine à défaire la vie qu’elle pourrait vivre.” (3)
La plongée d’un personnage dans la folie est indissociable de sa noyade dans les mots ou dans le désir. « Les livres sont faits de ces souvenirs qui s’entassent comme les feuilles d’arbre deviennent la terre. Des pages d’humus. » Le texte naît à partir d’autres textes – comment pourrait-il en être autrement ? - et aspire pour s’en nourrir le grand chagrin de Claire ou de Camille. Les narratrices absorbent, pour l’écriture, l’amertume du désir et de la perte. Le récit fantasmatique et brumeux qui en émerge, kaléidoscopique, est une pâte à papier, remâchant le grand malheur de toute vie.
Camille Laurens, Celle que vous croyez, Gallimard, 2016.
Gwenaëlle Ledot.
……………………………………….
(1) Annie Ernaux.
(2) Celle que vous croyez, page 69.
(3) Ibid., p. 111.
 « Ne regardez pas en vous-même, vous ne trouverez rien. »
« Ne regardez pas en vous-même, vous ne trouverez rien. »
Cette phrase du philosophe Clément Rosset, reprise par Annie Ernaux, fait signe et éclaire son œuvre. L’enjeu, dans ces entretiens de 2014, ne sera jamais de « parler de soi », ni même de « parler de ses livres »… Mais de jeter une lumière subtile et précise sur le projet d’écrire, et ce qu’il génère. Se projeter dans un lieu qui est un entre-deux. Entre-deux de lecture-écriture. L’entre deux cultures, pour un écrivain socialement « transfuge ». L’entre deux mondes : celui des faits quotidiens, et celui, tout à côté, où l’on construit le texte. Lisant Annie Ernaux dans ces entretiens avec Michelle Porte, on l’imagine créant sa bulle paradoxale ; la construction d’un édifice (elle parle d’une « maison »), pièce à pièce, un bâtiment textuel. Un lieu ouvert qui dialogue avec le monde « du dehors », auquel elle reste intimement et volontairement connectée : Cergy, des centres commerciaux, des collèges, des paroles et des rues. Le lieu des « Journaux extérieurs ». Le lecteur rappelle à lui Yvetot, village du passé et l’image d’une sœur ; puis Les Années, le petit chat mort dans la grande maison, et la silhouette puissante de la mère, encore.
« Ne regardez pas en vous-même… » Dans cet édifice s’amassent les pièces précieuses du « musée intérieur » qui, dit-elle, la constitue : les œuvres d’art, cinéma, peinture, qui construisent peu à peu la personne et le livre. Investissant un lieu autrefois sacré, l’auteur s’enferme dans sa bulle textuelle, et s’ouvre simultanément. Quand il s’agit de perdre le monde pour mieux le retrouver, dans l’architecture d’une réalité éclaircie.
« … vous ne trouverez rien. »
Annie Ernaux, Le Vrai Lieu, Entretiens avec Michelle Porte, Gallimard, Paris, septembre 2014.
Gwenaëlle Ledot.
Les aubes spirituelles
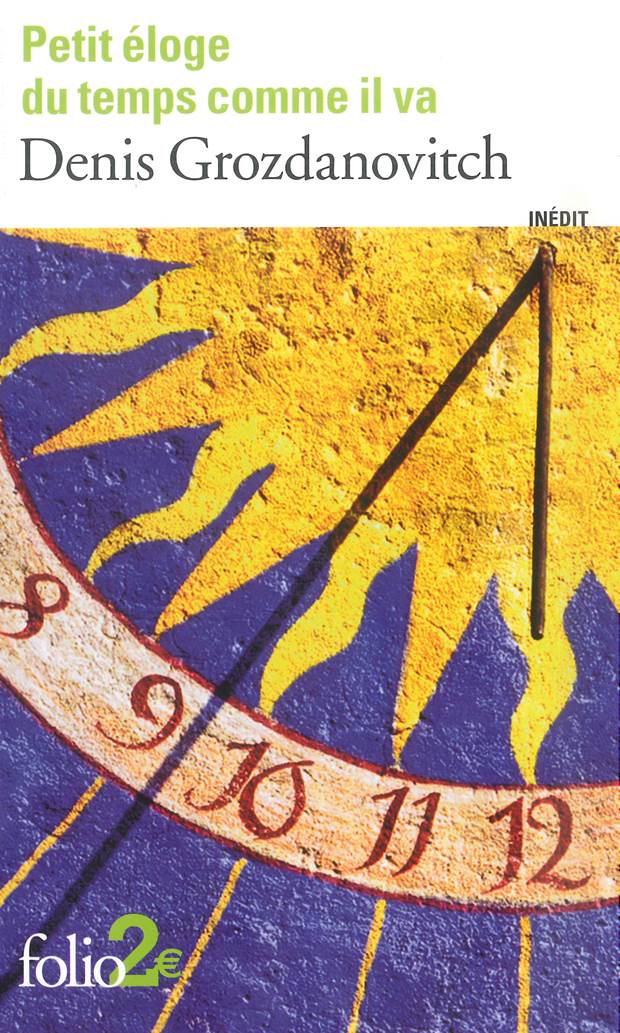
Comment saisir le temps, comment cueillir le jour ? Comment aborder ce texte de Denis Grozdanovitch, consacré au « temps comme il va » ? On imagine un lecteur installé à son aise sous une brise légère. Des bruits de feuillage. Quelques tomes de Proust à proximité et quelques pages relues : Jules de Gaultier et Schopenhauer, peut-être. C’est l’heure exquise et le temps retrouvé. Végétation et forêt se font garantes d’une certaine paix de l’âme : c’est le moment de se pencher sur la météorologie de l’esprit.
L’opuscule s’ouvre sur quelques mots surprenants, attribués à une vieille dame russe, tremplins de la réflexion :
Oui, messieurs. Il fait mauvais temps et nous attendons qu’il change. Mais il vaut mieux qu’il fasse mauvais temps que rien du tout et que nous attendions au lieu de ne rien attendre.
Il s’agit ici du temps qui va, inextricablement lié au temps qu’il fait. Au culte du Dieu soleil, l’auteur préfère décidément les nuances et mouvances météorologiques : l’asphalte mouillé des rues parisiennes, l’odeur sublimée d’un parc ou d’un jardin après l’averse. Ô, le chant de la pluie !
Endless rains, elles font renaître les souvenirs d’Angleterre, lorsque la pluie appelle la douceur du foyer ; un temps arrêté, celui, serein, de la lecture. Temps suspendu et par là même retrouvé. Endless rains : musique des mots, douceur de la mémoire.
Pour un cœur qui s’ennuie : quand le cœur s’ennuie, l’époque lui offre de petits écrans, de petits messages. La grande affaire contemporaine, c’est la vitesse et le réconfort addictif de l’immédiateté. L’esprit, le cœur sont entièrement absorbés par la machine. Engendrant une autre temporalité qui nous dévore ; rythmée par des objets qui nous demeureront fatalement extérieurs, mais insidieusement nous transforment. Qui nous éloignent de l’univers naturel, d’une nature animale, d’une très ancienne forme de spiritualité. L’auteur nous rappelle cette sentence de R. W. Emerson : « la mesure de l’homme est sa manière de saisir la journée. »
Viser la suspension du temps est largement illusoire, cependant. L’homme ne se vit lui-même que dans le flux et la projection. A chacun, alors, de reconnaître sa durée, personnelle et véritablement « appropriée ». Chaque instant prend un certain sens, écrivait Thomas Mann. Retrouver, envers et contre tout, contre l’époque présente et un malheur certes éternel, la saveur intrinsèque de nos heures.
« La rose
ne cherchait pas l’aurore :
presque éternelle sur sa branche,
elle cherchait autre chose.
La rose
ne cherchait ni science ni ombre :
confins de chair et de songe,
elle cherchait autre chose.
La rose
ne cherchait pas la rose.
Immobile dans le ciel
elle cherchait autre chose.»
(Federico Garcia Lorca, extrait de « Casida de la rose »)
Petit éloge du temps comme il va, Denis Grozdanovitch, Paris, Gallimard, « Folio 2 euros », août 2014.
Gwenaëlle Ledot.
« Dites, quoi donc s’entend venir
Sur les chemins de l’avenir
De si tranquillement terrible ? »
(Emile Verhaeren « La révolte »)

Quid du dernier texte de Milan Kundera ? On en dira la légèreté, puisque le titre et l’auteur nous y invitent. Puisqu’une plume se pose, iconique, au milieu du récit. On parlera de Ramon, qui flâne dans le jardin du Luxembourg, observe et ne décide rien. On pensera à son ami D’Ardelo qui s’invente, étrangement, une grave maladie. A tous les personnages de cette ronde romanesque, qui se croisent, se parlent ou non, et jamais ne se comprennent :
« Oui, c’est comme ça, dit Ramon. Les gens se rencontrent dans la vie, bavardent, discutent, se querellent, sans se rendre compte qu’ils s’adressent les uns aux autres de loin, chacun depuis un observatoire dressé en un lieu différent du temps. »
Chaque personnage porte sa théorie, sur tout, sur rien… Chacun a son anecdote. Tous entrent dans la danse enfantine de l’existence : dépourvue de pesanteur, car dépourvue de sens.
De cette ronde se détachent plusieurs temps graves : une tentative de suicide qui se transforme en meurtre. Une mère qui refuse son fils. Un écrivain (Alain) qui finalement n’écrira pas. Ce sera sa plus grande gloire, « la gloire du très grand poète qui, grâce à son humble vénération de la poésie, avait juré de ne jamais écrire un seul vers. »
Le personnage de Charles est absorbé dans la contemplation d’une plume qui volette ; devrait-il y lire l’arrivée imminente d’un ange ? Probablement pas. Le vertige des signes, du sens désespérément traqué, d’un monde dédoublé, est pour les hommes une tentation permanente. « Chacun s’entoure de ses propres signes comme d’un mur de miroirs qui ne laisse filtrer aucune voix du dehors. »( Plus de fêtes galantes.
Ce monde fragmenté se reflète dans les yeux de chaque personnage comme dans un prisme isolé. Il n’en restera que des miettes, ou des brisures. Reste aux hommes un monde résolument non-signifiant. Reste à ponctuer ce désarroi tranquille par des rires :
« Le monde des adultes éclate de rire. Le monde des adultes sait bien que l’absolu n’est qu’un leurre, que rien d’humain n’est grand ou éternel… »(
La ronde romanesque ne deviendra pas valse tragique. Ce que portent les petites icônes du récit (plume, nombril, armagnac ou perdrix), c’est la résistance têtue du réel et l’absence d’autre chose. L’absence métaphysique. L’absence du double :
« Je suis autre et moins que moi-même, ce qui, en définitive, ne mérite pas mieux qu’un éclat de rire, mais le mérite pleinement. »(

La fête de l’insignifiance, Milan Kundera, Paris, Gallimard, mars 2014.
Gwenaelle Ledot.
(1) M. Kundera, Le livre du rire et de l’oubli, Paris : Gallimard (Du monde entier), 1979 - Nouvelle édition revue par l’auteur en 1985 / Gallimard (Folio), 1987.
(2) M. Kundera, La vie est ailleurs, Paris, Gallimard (Collection Blanche), 1973 - Nouvelle édition en 2008
 Chroniques 2014, Romans français
Chroniques 2014, Romans français
 emile verhaeren, fete de l'insignifiance, francois ricard, gallimard, kundera, la fete de l'insignifiance, la revolte, la vie est ailleurs, le livre du rire et de l'oubli, livre du rire et de l'oubli, milan kundera, vie est ailleurs
emile verhaeren, fete de l'insignifiance, francois ricard, gallimard, kundera, la fete de l'insignifiance, la revolte, la vie est ailleurs, le livre du rire et de l'oubli, livre du rire et de l'oubli, milan kundera, vie est ailleurs
« Les voix, chère Marceline… »

« Les voix, chère Marceline, ce sont les fleurs de l’éternel mises dans votre bouche ». Le premier chapitre, tel un chant qui s’élève, concentre la saveur du texte. La limpidité de l’écriture et le flux des mots portent les couleurs de la vie. Le rose sera destiné à la poétesse Marceline Desbordes-Valmore : la grâce intacte de son œuvre émerge, en floraison, au cœur d’un voyage froid. La « femme noyée de bleu » de Vermeer lit une lettre pour l’éternité, nichée dans son tableau, réfugiée dans son rêve d’amour sans fin. Les clochettes des campanules garderont le même bleu, la feuille de buis son vert sombre. Quelques pages plus loin, une larme, « plus précieuse qu’une perle », est l’évocation d’une souffrance translucide.
« Le cœur ignore le temps » : car la vie contient aussi la perte sanglante de l’être aimé, l’organe sanguinolent qui se déchire tous les jours. Rouge à l’infini.
Dans ce long deuil, l’auteur a choisi résolument de jeter un peu de lumière. On ignore si cette aurore fragile va persister.
Des bouquets de mots, des fleurs de cerisiers ; des anges écarlates, et des yeux d’encre. « Nul n’a jamais écrit ou peint, sculpté, modelé, construit, inventé, que pour sortir en fait de l’enfer », écrivait Antonin Artaud. Christian Bobin semble faire tout à la fois : sculpter des mots et peindre de petits soleils. Modeler une fleur, un animal, et rappeler à lui les plus grandes voix. Ronsard ici, Ernst Jünger un peu plus loin, et la pureté violente et fiévreuse de Kierkegaard ; ou encore Hölderlin, « mille fois mort avant sa mort ». Christian Bobin chante, lui aussi, sans ignorer la chute des cœurs. Ceux qui ont quitté, abandonné, avant les autres. Ceux qui sont perdus, et ceux qui vont briller. Les mêmes, peut-être.
« Tout donner, tout perdre, et qu’on n’en parle plus. »
Gwenaëlle Ledot
La grande vie, de Christian Bobin, Paris, Gallimard, janvier 2014.

« Ah ! Que la vie est quotidienne…»
Dans L’Herbe des nuits, le narrateur prend des notes. Précises, parcellaires ; essentielles et énigmatiques, dans un petit carnet. Lieux, rues et quartiers parisiens : l’Unic Hôtel, les Gobelins, Jussieu, le Luxembourg. Il recense des rencontres de hasard : une femme nommée (peut-être) Dannie et un faux étudiant. Autant de silhouettes esquissées, puis reprises, redessinées, complétées au fil du roman, qui croisent des figures illustres et venues du passé. Car le narrateur tricote aussi des existences littéraires : Charles Cros, Tristan Corbière, Jeanne Duval sont l’autre mémoire parisienne.
Quand ? Peut-être en janvier… Les saisons comme les silhouettes se croisent et se confondent. La mémoire se noie dans une brume bleue, gouttelettes de souvenirs en pluie fine. On imagine Paris nocturne, sous les lampadaires incertains. Le narrateur à la recherche d’une femme, d’un temps recommencé, d’une lumière tremblotante. Une fenêtre éclairée, où peut-être quelqu’un vous attend. Peut-être pas, d’ailleurs.
Au milieu de cette brume bleue, il y a un crime, auquel on ne s’intéresse pas. Le narrateur, lui, note. Garde des preuves de l’existence des gens, des choses. Il y a eu cette femme autrefois, et il y a eu Paris. Quelques petits cailloux de souvenirs qui persistent, résistent, n’empêchant pas cette dilatation étonnante du temps et de l’espace. Un art de mémoire.
L’Herbe des nuits, Patrick Modiano, Paris, Gallimard, septembre 2012.
Gwenaëlle Ledot
 Solstice
Solstice
Lorsqu’on sait que le temps s’est déjà écoulé. Lorsqu’on décide de profiter des derniers rayons : Philippe Delerm, à soixante ans, dit être passé de l’autre côté du solstice d’été. « Il y aura encore des jolis soirs, des amis, des enfances, des choses à espérer. Mais c’est ainsi : on est sûr d’avoir franchi le solstice. » Il devient nécessaire et urgent de se placer du bon côté de la vie : Le trottoir au soleil (titre de son dernier opus) traque les rares lumières de l’existence. Au-delà, il s’agira de saisir la bulle d’éternité qui se cache dans les parcelles et les étoiles du quotidien… Les miettes lumineuses d’une vie par avance disparue. Le regret et l’angoisse percent sous sa plume, de façon assez nouvelle. L’espérance est violente, la célébration de la vie se teinte de renoncement, et semble mendier des leitmotivs déjà échappés : un dîner au soleil, en été. Une terrasse de café au printemps. Le goût, profond et léger, d’une poignée de cerises noires. Un ailleurs flottant, « au nord de soi », à Bruges. Et la littérature, parfois. Pour « tailler à l’infini la route d’une intime vérité. »
Le trottoir au soleil, de Philippe Delerm, Gallimard, novembre 2010, 181 pages, 14,90 euros.
Gwenaelle Ledot
 Et si le livre était diaphane…
Et si le livre était diaphane…
« Le traité était diaphane, universel ; il ne semblait pas rédigé par une personne en chair et en os, mais par n’importe quel homme ou, peut-être, par tous les hommes… » (J. L. Borges, Les théologiens)
Pierre Bayard, qui aime le jeu, multiplie les paradoxes : Comment améliorer les œuvres ratées ? est paru en 2000 aux éditions de Minuit et le très célèbre Comment parler des livres qu’on n’a pas lus ? en 2007, chez le même éditeur. En 2010, son nouvel essai, placé sous l’égide de J. L. Borges, choisit le ressort fertile du « Et si… ? » Et si Homère n’avait pas écrit l’Odyssée ? Par Nausicaa aux bras blancs, par le désespoir de Circé, on jure ici que les tourments féminins signent, bien sûr, une âme féminine. La dissonance souvent commentée entre l’Iliade et l’Odyssée autorise cette thèse séduisante : l’auteur de l’Odyssée serait en réalité une poétesse. Pierre Bayard rappelle certains postulats connus de la critique littéraire, qui autorisent cette flambée interprétative : l’auteur n’est jamais celui que nous croyons, et la représentation du lecteur ne coïncide que rarement avec l’individu en chair et os.
« Averroës disparaît à l’instant où je cesse de croire en lui » (Borges, La quête d’Averroës)
L’auteur restera donc, à jamais et de manière irréductible, un autre. Se pose aussi le problème des attributions : nous ignorons tout d’Homère, et tout de Shakespeare. « Tout nom d’auteur est une fiction » affirme encore Pierre Bayard. Et, surtout, « tout nom d’auteur est un roman » : chaque nom-étiquette que nous posons (Flaubert, Proust, Molière) porte avec lui son lot d’images et de représentations, tant individuelles que collectives. Représentations qui contribuent elles-mêmes à enrichir le sens de l’œuvre, construit par le lecteur.
Qui était vraiment Shakespeare ? Un personnage obscur, fils d’un petit boutiquier de Stratford-upon-Avon (hypothèse traditionnelle), ou bien plutôt Edward de Vere, le dix-septième comte d’Oxford, aristocrate lettré et grand voyageur ? Sigmund Freud s’est enflammé, comme d’autres, pour cette seconde hypothèse : elle lui permit de lire Hamlet comme la mise en images géniale du complexe d’Œdipe. C’est la théorie de l’ « auteur intérieur » que développe Pierre Bayard : chaque lecteur construit une image toute personnelle de l’auteur qu’il chérit. De là, un éternel malentendu (presque amoureux). De là, surprises ou désenchantements de la rencontre auteur-lecteur…
Dom Juan, écrit par Pierre Corneille : certaines tentatives de détournement proposées dans l’essai semblent d’abord une gageure. Sauf à penser, comme le rappelle Pierre Bayard, que la thèse selon laquelle Corneille est l’auteur véritable des pièces majeures de Molière est très sérieuse (elle fut défendue et étayée tout au long du vingtième siècle). Allons plus loin dans le jeu, et décidons alors que « Lewis Carroll peut gagner à avancer d’un siècle dans le temps », ou que le compositeur Robert Schumann est le peintre du Cri.
« Un dieu, pensais-je, ne doit dire qu’un seul mot et qui renferme la plénitude » (Borges, L’écriture du Dieu)
Quel est le véritable intérêt du jeu savant proposé par Pierre Bayard ? La formule « … est l’auteur de… » devient la clé d’un univers nouveau. Des perspectives et des miroirs, un pas vers l’infinie liberté du lecteur : « Il n’existe pas à ma connaissance une seule étude critique qui tente d’expliquer les raisons qui ont conduit le grand romancier russe Léon Tolstoï à s’exiler de son pays par l’imagination et à écrire cette vaste fresque sur la guerre de Sécession qu’est Autant en emporte le vent. »
Et si les œuvres changeaient d’auteur ? de Pierre Bayard, Paris, éditions de Minuit, octobre 2010, 156 pages, 15 euros.
L’Aleph, de Jorge Luis Borges, édition citée : Gallimard, 1994.
Gwenaëlle Ledot.
Fragments de paradis.
Longtemps, Christian Bobin n’a écrit que pour une poignée de lecteurs, happy few séduits par l’élégance de l’écriture et la beauté du trait. L’accueil réservé à son dernier opus, Les Ruines du ciel, publié chez Gallimard, souligne un succès, public et critique, qui va croissant.
Sur les pas de Jean Follain, poète normand que Christian Bobin cite volontiers, un hommage aux êtres et aux choses de son monde, disparus ou à disparaître. Les religieuses de Port-Royal célébrées par sa plume sont autant de figures d’intercession qui ouvrent au lecteur les voies du monde, sinon du ciel : « Le sens de cette vie c’est de voir s’effondrer les uns après les autres tous les sens qu’on avait cru trouver. » Un chat noir, comme une pensée charbonneuse, passe.
« Il n’y a aucune différence entre le paradis et l’enfer. » Les traces de la vie et de la mort, entremêlées, se font parcelles de divin : des miettes de pain, ou trois roses fatiguées ; un bouquet de mimosa auquel l’auteur veut rendre grâce ; le peigne en or d’une poupée. « J’ai surpris les yeux de Dieu dans le bleu cassant d’une petite plume de geai. » L’écriture poursuit le monde, ou le rêve du monde. « Je ne sais pas vivre mais qui le sait ? » Christian Bobin traque le réel dans ses éclats ou ses obscures paillettes, dans toute sa lumière blanche et ses reflets dorés.
Pas de trame narrative ici, des fragments plutôt ; morceaux de ciel, éclats de vérité, parcelles du monde, qui rayonnent autour de figures choisies : Angélique Arnauld, abbesse de Port-Royal, Pascal, Louis XIV. L’écriture oscille entre un présent d’éternité et des incursions dans le Grand Siècle : « Au dix-septième siècle même les garçons d’écurie parlent cette langue où les mots s’entrechoquent comme des verres de cristal remplis d’une lumière printanière. »
Article publié dans le Normandie Magazine N° 233 du 23 décembre 2009. Christian Christian Bobin, Les Ruines du ciel, Gallimard, août 2009, 182 pages, 15,50 €.
Christian Christian Bobin, Les Ruines du ciel, Gallimard, août 2009, 182 pages, 15,50 €.
Voir la biographie de Christian Bobin.
Gwenaëlle Ledot