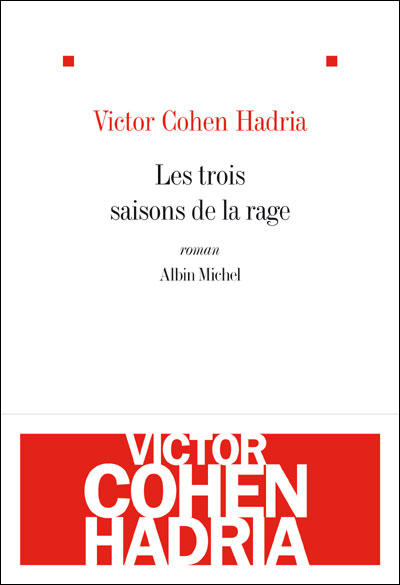« Seul l’art m’agrée, parti de l’inquiétude, qui tende à la sérénité. » (Gide)

Avec une curiosité sereine, nous ouvrons ce petit livre : Cinq méditations sur la mort (autrement dit sur la vie). Car nous connaissons bien l’œuvre de François Cheng, le thème du dialogue qui ponctue ses textes et son écriture limpide. Ses essais, réflexifs et profonds, des romans au lyrisme apaisé (Quand reviennent les âmes errantes en 2012) nous accompagnent depuis quelques années déjà.
L’avant-propos de l’éditeur Jean Mouttapa annonce pour ces Méditations une conception alternative de l’existence et une réflexion « en spirale ». Ce qui est tout à fait exact, à condition de ne pas négliger le fait suivant : François Cheng se considère comme un « passeur » entre deux cultures. Et pour étayer sa réflexion sur la vie et la mort (liées), il convoque aussi bien l’intuition du Tao que les poèmes de Keats et Shelley.
L’objet des textes : faire toucher du doigt le mouvant de l’existence, le flux de la vie qui porte aussi la mort.
« Oui, c’est cela, la vie : quelque chose qui advient et qui devient. Une fois advenue, elle entre dans le processus du devenir. Sans devenir, il n’y aurait pas de vie ; la vie n’est vie qu’en devenant. Dès lors, nous comprenons l’importance du temps. C’est dans le temps que cela se déroule. Or le temps, c’est précisément l’existence de la mort qui nous l’a conféré ! » (1)
Cette pensée trouve un écho chez R. M. Rilke, dont la poésie touche intimement François Cheng : l’individu peut lire en sa propre mort le prolongement de lui-même, le prolongement du mouvement de sa vie. Tel est le sens porté par ce vers de Rilke :
« Seigneur, donne à chacun sa propre mort. »
L’auteur fait sienne cette pensée, qui rencontre, très heureusement, certaines philosophies orientales :
« Par la suite, Rilke élargira sa vision. Mais d’ores et déjà, nous remarquons une singulière coïncidence : l’intuition du poète correspond de près à la grande leçon dispensée par Lao-zi dans le Livre de la Voie et de sa vertu. Lao-zi affirme, au chapitre 25, que la marche de la Voie est circulaire. » (2)
Bonheur de la coïncidence. Etonnante convergence qui rapproche la plus ancienne pensée chinoise du poète allemand.
« Rilke ne connaissait pas le taoïsme. En tant que poète de langue allemande, il fut d’abord marqué par les grandes figures de la poésie germanique : Goethe, Hölderlin, Novalis, Heine, etc. »
Et traversant la souffrance amoureuse, Goethe, comme Rilke, comme Hölderlin, ont exploré une voie différente, appelée « L’Ouvert ». Un « double royaume » qui unit en son sein perceptions de la vie et de la mort. L’image qui s’impose entre les lignes fluides est un cheval blanc qui court, réminiscence des Sonnets à Orphée : icône animale, libérée des limites de l’existence perceptible.
« L’animal libre a toujours son déclin derrière lui ;
Devant lui, Dieu. Quand il avance, c’est
Vers l’éternel, comme coule une source. » (3)
Ce regard nouveau suggère d’envisager la mort, non comme une fin absurde, mais comme le fruit de notre être. Qui saura rejoindre, peut-être, « le chant de la haute enfance ».
« La vie engendre la vie, il n’y aura pas de fin. »
Le véritable exploit littéraire, le grand talent de François Cheng se révèle un peu plus loin – troisième méditation - dans cette faculté à dire l’humain, le réel, jusque dans la description de l’insoutenable. Qu’il appelle sobrement « le mal », et qu’il décrit sans détours, comme immonde inhumanité. Et de réaffirmer, au cœur même des enfers inventés par les bourreaux, l’essence humaine et la flamme de vie des victimes. Elle est retrouvée, célébrée par la phrase immémoriale.
« La vie engendre la vie, il n’y aura pas de fin. »
Gwenaëlle Ledot.
Cinq méditations sur la mort, autrement dit sur la vie, de François Cheng, Paris, Albin Michel, octobre 2013.
 Et découvrir Sylvia Plath
Et découvrir Sylvia Plath
Lire les premières pages abruptes de ce roman biographique, et découvrir Sylvia Plath dans la chair et le sang : la naissance de Nicholas, son deuxième enfant.
Puis découvrir Sylvia Plath dans les mots. Mots qui palpitent de l’écrivaine, suicidée à trente ans : Passer l’hiver dans une nuit sans fenêtre. Wintering…
Cargo de trente ans, je laisse filer mon existence : Sylvia attendant la mort relit sa vie, questionne sa chute. Et pourquoi mourir à trente ans, belle, talentueuse, mère de deux jeunes enfants ?
Le ciel blanc se vide de ses promesses, comme un bol.
Le refus d’un manuscrit, la difficulté d’être mère ? La présence ou l’absence du mari, célèbre, tyrannique ? La vie compliquée d’une femme, différente, ce depuis toujours.
Sylvia égrène les souvenirs de son père : un émigré allemand, Otto Plath, qui pleure un ancien pays, lequel n’a peut-être jamais existé… L’Allemagne balayée par la guerre et le nazisme. Was ist los in unsere alte Welt ? Quelque chose de l’ancienne Allemagne dans la poésie de Sylvia ? Quelque chose de Heine, un souvenir de la Lorelei, de la gloire de Schiller. Mais peut-être un mythe, peut-être un rêve : la brume de l’Allemagne pré-hitlérienne s’envole, avec le suicide de Walter Benjamin :
Les claires voyelles s’élèvent comme des ballons.
Walter Benjamin mort en partance, Otto Plath agonisant dans l’exil américain. Et Sylvia reste seule : Je suis du magicien la fille qui ne bronche pas. Reste avec la culpabilité du peuple allemand. Coupable de son père, aussi.
Elle reste avec ses petits drames à elle : adultère, abandon du mari. « Une mort de plus avec laquelle il avait fallu vivre. »
Sylvia commence à partir, doucement. Pendant que « le monde ricane de sa petite tragédie. » Devient Marylin ou Médée. Devient une vieille femme à trente ans.
Et s’élève.
Mourir est un art, comme tout le reste, d’Oriane Jeancourt Galignani, Albin Michel, janvier 2013.
Gwenaëlle Ledot.

« A Amélie Nothomb.
… Oui, je sais, vous vous en fichez. »
Don Elemirio Nibal y Milcar pourra-t-il rivaliser avec Prétextat Tach ? Angoissante question qui saisit le lecteur assidu d’Amélie Nothomb en cette fin du mois d’août. « Un lecteur est un sac de phrases », écrit Charles Dantzig. Par les charmes de l’auteur fécond, le lecteur est devenu un sac de noms. Véritable Robert des noms propres.
Août 2012 : la nouvelle héroïne d’Amélie se nomme Saturnine Puissant. A vingt-cinq ans, elle est, selon son admirateur, belle comme une créature de Khnopff.

Des caresses, ou l’Art, ou le Sphinx, 1896, Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles.
Don Elemirio lui propose une colocation à un prix modique, dans un univers luxueux : lit douillet, marbre chauffé, champagne à flots, cristal de Tolède.
Au milieu de tout ce luxe, il y a une chambre noire. Interdite parce que. Barbe bleue, donc. Saturnine prend un risque évident, celui de la littérature : il est contenu dans le titre. Risque d’y entrer par curiosité, comme toutes les femmes du conte, risque d’y entrer par distraction (ah bon ?), risque d’y entrer par goût. Du risque.
« Si vous entriez dans cette chambre, je le saurais et il vous en cuirait. »
Mais Saturnine le clame haut et fort : ce n’est pas son genre. La curiosité n’est pas le propre d’une Saturnine, pas plus que d’un Saturnin ou d’un Robert. Dont acte.
Le duel commence donc : Saturnine – jeune, mais pas naïve ; femme, mais pas curieuse ; belge, et non française, elle y tient - contre l’aristocrate espagnol. Don Elemirio semble un homme banal, de prime abord. Capable de cuisiner des omelettes intimidantes et des anguilles sous roche, mais tout de même. Paraît bien loin d’égaler Barbe bleue et Prétextat Tach.
La joute verbale qui s’engage, savoureuse, portera sur des sujets aussi divers que les mérites méconnus de l’Inquisition et l’hérésie du champagne rosé. L’essence théologique de l’œuf. La métaphysique du jaune. J’en passe, bien sûr.
Fil rouge du roman : Saturnine, incarnation de la sagesse humaine, peut-elle tomber amoureuse « d’un malade mental, d’un homme infatué, d’un être parfaitement biscornu ? » Voire d’un assassin ? … Il serait bien regrettable de se refuser un tel plaisir de lecture, surprenant et dense jusqu’à la dernière goutte : tout de savoureuse finesse, les mots pétillants d’Amélie Nothomb.
Barbe bleue, d’Amélie Nothomb, Albin Michel, août 2012.
Gwenaëlle Ledot.
 Poétique de la carpe
Poétique de la carpe
Le dernier roman de Jacques-Pierre Amette est la petite histoire d’un journaliste : envoyé à Rome fin mars 2005, pour « savoir ce que pensaient les Romains de ce pape polonais. L’article de six mille signes environ devait donner l’ambiance de la ville, sa ferveur. »
L’écriture de l’article s’associe au voyage amoureux ; le journaliste est accompagné par Constance : elle-même reflet d’Italie, promesse de vie douce et d’enivrement… Glycine et rayons, poussière lumineuse, terrasses d’or deviennent le cadre idéal de la liaison romaine.
Eau tiède de Rome, mortifère : au-delà du « pétillement romain » subtilement peint par Amette, l’eau de vie devient marais, marécage. Si l’homme amoureux tente de posséder sa mystérieuse compagne, c’est encore et en vain… De l’importance de ne pas être constant.
Les reflets aquatiques se font ondoyants, obscurs. Un été chez Voltaire, autre roman d’Amette, se rappelle au souvenir nostalgique : « Elle baignait parfois dans le vide énigmatique du ciel, parfois grinçait, et pivotait sur un impalpable reflet. Elle pénétrait dans l’obscurité. Elle tournait sur les ondes, perdue dans les zones troubles d’un étang formant miroir. »
La thématique de l’eau porte donc son ambivalence. Que restera-t-il au journaliste ? La vacuité d’une gloire éphémère ? L’impuissance qui guette le don d’écrire ? Le mutisme possible et une menace sur l’amour.
Survit, simplement, une poétique des éléments. Ironie tranquille qui balaye toute vanité humaine :
« Il y avait autre chose, il y avait autre chose d’irréductible, de fidèle. La terre s’obstinait à durer et persévérer au-delà des regards humains. »
Liaison romaine, de Jacques-Pierre Amette, Paris, Albin Michel, mai 2012.
Gwenaëlle Ledot.
La rage humaine
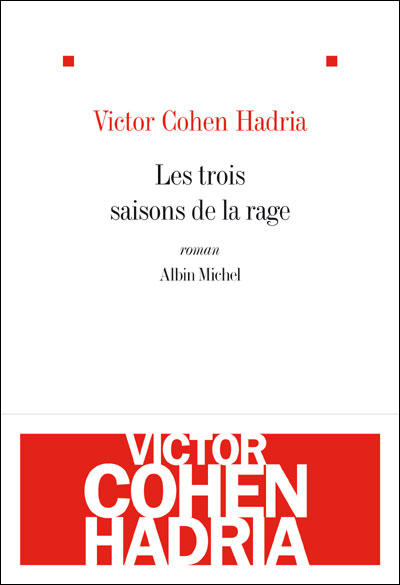
En 1859, un jeune paysan nommé Délicieux accepte contre monnaie trébuchante de prendre la place d’un autre, plus fortuné, et de partir au front. Cet échange humain, mauvaise fortune contre bon numéro, scelle un destin. C’est le point de départ de l’intrigue complexe tramée par Victor Cohen Hadria dans Les Trois Saisons de la rage : première saison ouverte par Brutus Délicieux.
Le jeune homme, devenu ordonnance au sein du régiment, souhaite communiquer par courrier avec sa fiancée et sa famille. Tous sont analphabètes. Deux hommes acceptent alors de devenir les secrétaires de leur quotidien : le médecin-major Rochambaud et le docteur Le Cœur. Ce dernier se présente comme un médecin du monde rural, bien ancré dans sa Normandie de Rapilly.
Place à la première partie de la fresque, palpitante. Dans les échanges croisés (espoirs des parents et des amants, doutes des transcripteurs) se révèlent lentement l’opacité et la confusion des sentiments. On devine avec effroi les vices cachés des uns ou des autres ; certaines petitesses trop humaines, au moment même où le cœur s’ouvre, conduisent les personnages à agir en pleine contradiction avec leurs intentions conscientes et déclarées…
Le roman réserve bien des coups aux protagonistes et quelques chocs pour le lecteur. De l’autre côté de la pleine misère sociale, le docteur Le Cœur assiste les agonisants, recueille les derniers soupirs des prostituées, soigne, ampute, fait son chemin opiniâtre et vaillant à travers les miasmes et les sanies, les soupirs et les membres sanglants. Encore n’est-il qu’un médecin de campagne, au contraire de son collègue envoyé au front, qui témoigne : « Nous sommes dans un enfer que Dante lui-même n’aurait pu inventer et nos Béatrice sont si loin. »
Sur cette vallée de larmes, une rage reparaît. Rage de vivre malgré tout et d’aimer… car le désir charnel «est l’antidote à la mort
».
Les deux médecins, qui ne se prennent certes pas pour des héros, en croisent quelques-uns sur leur chemin. Parmi eux, Henri Dunant, fondateur de la Croix Rouge. Mais aussi des scientifiques obscurs et sans grade, thésards et chercheurs isolés de cet art balbutiant qu’est la médecine du dix-neuvième siècle. Sur ce petit monde plane encore l’ombre du grand Hugo. Le docteur Le Cœur, protecteur d’une nouvelle Cosette, soutient les élans d’une conscience sociale naissante. Rage humaine d’hier… ou d’aujourd’hui :
« Quoi qu’en pensent les bons esprits de notre temps qui découvrent dans la réussite financière le summum de la bénédiction des dieux et qui s’acharnent dans la poursuite des biens matériels, il n’est pas douteux que la trop grande distance de situation entre les êtres ne soit un profond facteur de discorde et que le déséquilibre ainsi engendré n’aille, au contraire du progrès, vers de sanglantes frictions.
Notre peuple devient de plus en plus instruit et, par conséquent, gobe moins ce qui est fait pour le distraire de sa misère. »
Les Trois Saisons de la rage, Victor Cohen Hadria, Paris, Albin Michel, août2010, 458 pages, 22 €.
Gwenaëlle Ledot