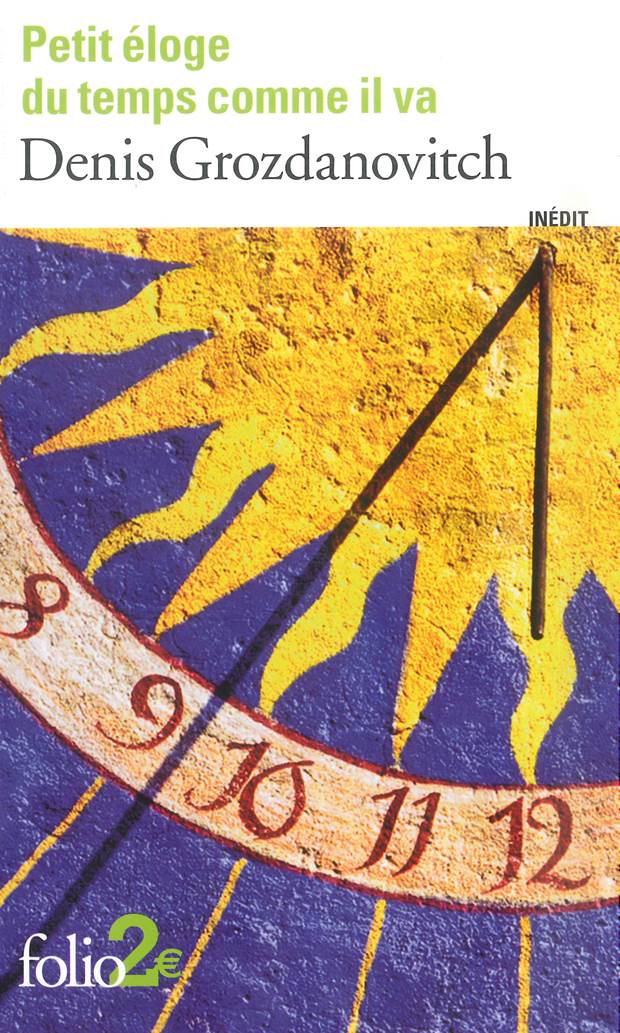De l’Âne.

Une icône paradoxale de la bêtise ? Denis Grozdanovitch a beau jeu de démontrer, dans les premières pages de son essai, que l’âne n’est pas celui qu’on croit : les cruautés infligées à l’animal n’en finissent-elles pas de désigner l’ineptie abyssale de l’être humain ? Le poème de Francis Jammes « Prière pour aller au paradis avec les ânes », révèle, à la clef, sa conviction profonde : l’empathie avec le vivant préserverait l’esprit humain des nombreuses ornières de la bêtise.
Dans le catalogue que l’auteur se propose d’établir, la « bêtise primordiale », celle des animaux, est salutaire :
“Or le bonheur qui est relié à la bêtise ressemble à un simple et sourd contentement dont le ronronnement du chat me paraît donner une idée exemplaire. Une dense et douce euphorie, proche de certaines extases matérielles. Une solide et compacte ataraxie où ne s’insinue aucune pointe d’angoisse.”
Être, ne point s’agiter, ni quêter jamais son essence dans l’agitation : « Le chat ne fait rien, il « est », comme un roi. » Une idée toute schopenhauerienne parcourt ces pages : la non-coïncidence avec le réel fait le malheur de l’homme ; tout comme le refus de percevoir cette impuissance spécifique, et de saluer la supériorité animale à cet égard : « En réalité, cette conscience aiguë, dont nous sommes si fiers et qui va de pair avec notre faculté d’abstraction et avec notre volonté de planification systématique, est aussi ce qui fait notre malheur, qui empoisonne nos vies à petit feu… ».
Guidés par une plume dansante, nous découvrons la « bêtise de l’intelligence » : elle dépend, semble-t-il, de « modèles » et de « postures » qui finissent inéluctablement par gommer la complexité mouvante du réel, pour tous ceux qui détiennent la clef explicative (et définitive) de l’existence…(1)
“…savoir que nous passionner pour une idée, pour une théorie, est inévitable, mais garder en même temps à l’esprit que ça n’est qu’une posture, une posture tout aussi bête que toutes celles qui nous apparaissent comme telles chez les autres.”
La bêtise savante est perceptible dans les démonstrations les plus brillantes des plus grands esprits, où se glissent çà et là quelques raisonnements incertains, dont l’auteur pointe habilement les failles. C’est l’occasion d’un rappel à l’humilité : « Quand ça devient trop sophistiqué, j’invoque le sens commun pour qu’il m’assiste » . Car c’est une aventure périlleuse que de vouloir mettre en concepts une réalité héraclitéenne :
“Quelle que soit la valeur, la puissance de pénétration d’une explication, c’est encore et encore la chose à expliquer qui est la plus réelle, - et parmi sa réalité figure précisément ce mystère que l’on a voulu dissiper.” (3)
On n’oublie pas la bêtise névrotique, intégrée aux formes multiples de la bêtise ordinaire : conduites répétitives, comportements absurdes et d’échec, auxquels les esprits brillants ne sauront échapper ; ou encore la bêtise « sociétale » (snobismes esthétiques ou dogmes contemporains, objets de descriptions réjouissantes). On se dira que l’empan est bien large, et que les manières d’être bête donnent l’embarras du choix… La catégorisation importe-t-elle vraiment ? Se dégagent de ces pages, telle une brume rafraîchissante, l’incertitude de toute chose, le risque qu’il y a à théoriser de façon définitive et l’impérieux désir de rejoindre par des chemins divers (jeu, méditation, contemplation) une réalité plus immédiate… Osera-t-on écrire que l’on se sent moins sot à la lecture de cet ouvrage, truffé de références érudites et malicieuses, et dont l’élégance distanciée prévient tout risque de bêtise savante ? L’écriture, avançant à sauts et gambades, mêle l’examen minutieux de textes exigeants à des petits faits narrés avec simplicité, rencontres fécondes et émerveillements esthétiques. « Venez, doux amis du ciel bleu… »
Le Génie de la bêtise, Denis Grozdanovitch, Grasset, janvier 2017.
Gwenaëlle Ledot.
Les aubes spirituelles
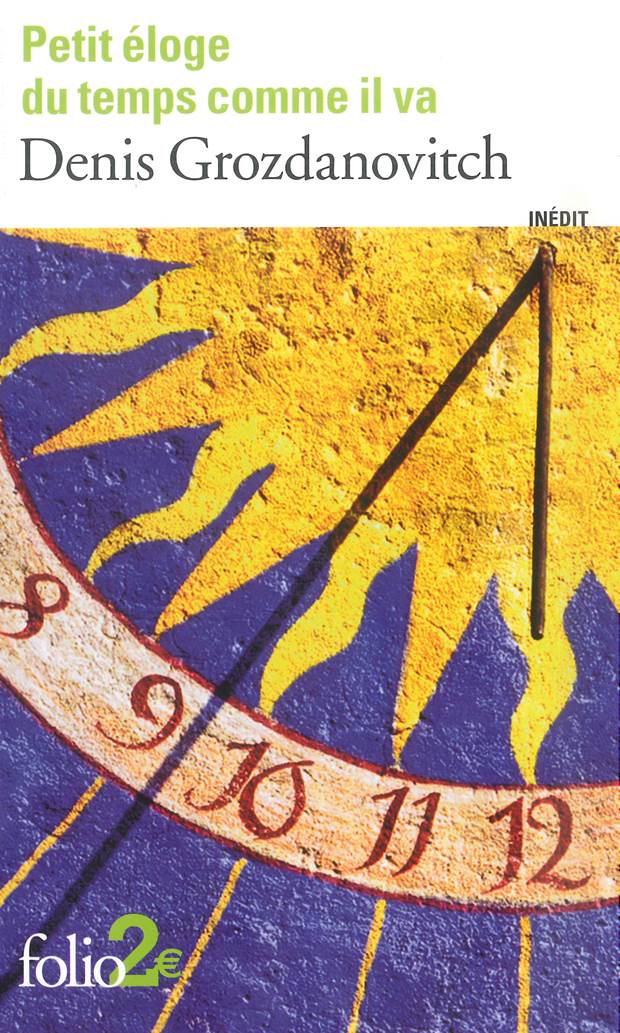
Comment saisir le temps, comment cueillir le jour ? Comment aborder ce texte de Denis Grozdanovitch, consacré au « temps comme il va » ? On imagine un lecteur installé à son aise sous une brise légère. Des bruits de feuillage. Quelques tomes de Proust à proximité et quelques pages relues : Jules de Gaultier et Schopenhauer, peut-être. C’est l’heure exquise et le temps retrouvé. Végétation et forêt se font garantes d’une certaine paix de l’âme : c’est le moment de se pencher sur la météorologie de l’esprit.
L’opuscule s’ouvre sur quelques mots surprenants, attribués à une vieille dame russe, tremplins de la réflexion :
Oui, messieurs. Il fait mauvais temps et nous attendons qu’il change. Mais il vaut mieux qu’il fasse mauvais temps que rien du tout et que nous attendions au lieu de ne rien attendre.
Il s’agit ici du temps qui va, inextricablement lié au temps qu’il fait. Au culte du Dieu soleil, l’auteur préfère décidément les nuances et mouvances météorologiques : l’asphalte mouillé des rues parisiennes, l’odeur sublimée d’un parc ou d’un jardin après l’averse. Ô, le chant de la pluie !
Endless rains, elles font renaître les souvenirs d’Angleterre, lorsque la pluie appelle la douceur du foyer ; un temps arrêté, celui, serein, de la lecture. Temps suspendu et par là même retrouvé. Endless rains : musique des mots, douceur de la mémoire.
Pour un cœur qui s’ennuie : quand le cœur s’ennuie, l’époque lui offre de petits écrans, de petits messages. La grande affaire contemporaine, c’est la vitesse et le réconfort addictif de l’immédiateté. L’esprit, le cœur sont entièrement absorbés par la machine. Engendrant une autre temporalité qui nous dévore ; rythmée par des objets qui nous demeureront fatalement extérieurs, mais insidieusement nous transforment. Qui nous éloignent de l’univers naturel, d’une nature animale, d’une très ancienne forme de spiritualité. L’auteur nous rappelle cette sentence de R. W. Emerson : « la mesure de l’homme est sa manière de saisir la journée. »
Viser la suspension du temps est largement illusoire, cependant. L’homme ne se vit lui-même que dans le flux et la projection. A chacun, alors, de reconnaître sa durée, personnelle et véritablement « appropriée ». Chaque instant prend un certain sens, écrivait Thomas Mann. Retrouver, envers et contre tout, contre l’époque présente et un malheur certes éternel, la saveur intrinsèque de nos heures.
« La rose
ne cherchait pas l’aurore :
presque éternelle sur sa branche,
elle cherchait autre chose.
La rose
ne cherchait ni science ni ombre :
confins de chair et de songe,
elle cherchait autre chose.
La rose
ne cherchait pas la rose.
Immobile dans le ciel
elle cherchait autre chose.»
(Federico Garcia Lorca, extrait de « Casida de la rose »)
Petit éloge du temps comme il va, Denis Grozdanovitch, Paris, Gallimard, « Folio 2 euros », août 2014.
Gwenaëlle Ledot.
« Mais ami, nous venons trop tard. » (Hölderlin)

« Sérendipité » : à la clef du dernier essai de Denis Grozdanovitch. Sérendipité, quel drôle de mot…
Traduit de l’anglais « serendipity », lui-même néologisme, il désigne une forme de sagacité, et la capacité à s’emparer des hasards heureux. Reconnaître sa chance. Et finalement compter sur l’inopiné, l’inattendu, l’inespéré.
Mot bien étrange, à la clef d’un très beau texte. Glissant sur le flux méditatif, la pensée qui avance. Fluide et serein comme une eau bleue. Porté par une sagesse ancienne et une plume élégante, Denis Grozdanovitch chemine. Lectures anciennes et contemporaines, fameuses ou non, nourrissent la réflexion. Le texte avance en dansant, livre quelques clartés, doucement. Il est question de « restituer au monde sa chatoyante diversité » : oscillation dans le texte entre l’acceptation du flux et l’imposition du sens, la crispation rationaliste et le lâcher-prise salvateur.
« Il n’y a rien de plus naturel que le hasard ni de plus constant que l’imprévu. L’ordre, en somme, est une entreprise antinaturelle. » Rencontres heureuses, au hasard de l’écriture : Paul Valéry et Montaigne, Jules de Gaultier et le Yi-King… Le texte fait toucher du doigt cette certitude : celle du changement perpétuel. C’est un monde héraclitéen qui se dévoile sous nos pas. L’on connaît la nécessité, peu à peu, de percevoir le mouvant, toute une part du monde qui n’offre pas de prise ; tout ce qui, enfin, échappe au rationalisme et au scientisme.
Urgence, enfin, de quitter la lettre pour l’esprit :
« Le pire des mensonges est de dire la vérité, toute la vérité, en cachant l’âme des faits. »
La puissance discrète du hasard, de Denis Grozdanovitch, Paris, Denoël, février 2013.
Gwenaëlle Ledot.
 Les marionnettes de Schopenhauer
Les marionnettes de Schopenhauer
Le roman de Denis Grozdanovitch prend comme modèle littéraire le très célèbre Decameron de Boccace : des écrivains, réunis dans une villa Médicis, regardent le monde s’effondrer autour d’eux… non pas cernés par l’épidémie de peste comme chez Boccace, mais sous l’effet de la gangrène consumériste et d’un modèle occidental voué à sa perte.
« Que l’humanité, ou ce qu’il est convenu de nommer ainsi nous oublie et nous laisse tranquilles. Nous formons ici une petite confraternité de cœurs désabusés, mais chaleureux et toujours vaillants.»
S’ensuivent discussions et débats, où Denis Grozdanovitch excelle. Brillant, honnête homme, profond et léger, lorsqu’il quitte le narratif pour le discours impromptu : réflexions sur le Mal, sur l’amour, sur le luxe comme divertissement existentiel. Pour ces êtres privilégiés, « rendre l’atmosphère ambiante irréelle ou surréelle, chercher à débarrasser, du mieux qu’ils le pouvaient, leurs moments d’existence ici-bas de l’inévitable trivialité attachée aux affaires humaines ordinaires, et tenter ainsi de conférer une texture fabuleuse à leur terrestre passage. »
Pendant que ses personnages dansent au-dessus d’un volcan, le narrateur tente de dégager l’axe dynamique de la civilisation occidentale : « leur fameux progrès tant revendiqué n’est qu’une progression têtue vers l’abîme. » Le modèle de société n’aurait d’autre but, inconscient et mortifère, que de « vérifier l’Apocalypse ».
Quant aux marionnettes, elles parcourent l’œuvre en métaphores de l’existence : très vite, le narrateur pense découvrir, avec Schopenhauer, que « nos chères petites personnes ne sont que des marionnettes vibrionnantes actionnées par le désir de reproduction » Sur ce vain théâtre, il aspire à un détachement de vieux sage, seul remède aux tourments annoncés. Et se trouve finalement piégé par un amour violent, vécu ou rêvé, qui surnage comme la dernière vérité.
La secrète mélancolie des marionnettes, de Denis Grozdanovitch, éditions de l’Olivier, janvier 2011, 330 pages, 20 euros.
Gwenaëlle Ledot
Sagesse éclectique

L’art difficile de ne presque rien faire, de Denis Grozdanovitch, n’est pas un nouvel hymne à la paresse au bureau. L’oisiveté dont il entretient son lecteur est un art contemplatif, difficile et profond. L’auteur s’efface devant le bruit du monde, le murmure de l’autre, les quelques pistes d’espérance. Le parcours de l’auteur-honnête homme est étonnant : champion de tennis, champion d’échecs, auteur de nombreux ouvrages salués par la critique (son Petit Traité de désinvolture a reçu le prix de la Société des gens de lettres en 2002), « Grozda » s’est fait un art des dissertations profondes et légères sur le tout et le rien, l’existence, le plaisir et le déplaisir de vivre. Il semble ainsi chercher la Voie, un chemin personnel inspiré des philosophies ou religions orientales, au premier rang desquelles le taoïsme. Il laisse résonner en lui la félicité du souvenir comme l’indignation devant le mal quotidien. Avec une humilité d’écriture non feinte, une érudition vertigineuse et une sensibilité universelle : capter l’air du temps, le vent, les feuilles mortes et les âmes mortes. Il chemine en bonne compagnie puisque Gourmont, Lorrain, Tchékhov ou Sebald l’accompagnent. Humanisme sans frontières, humanité, humilité: l’époque nous intime, comme une leçon de vie, de (re)découvrir l’univers Grozdanovitch.

L’art difficile de ne presque rien faire, de Denis Grozdanovitch, éditions Denoël, février 2009, 333 p., 20 €.
Gwenaëlle Ledot.