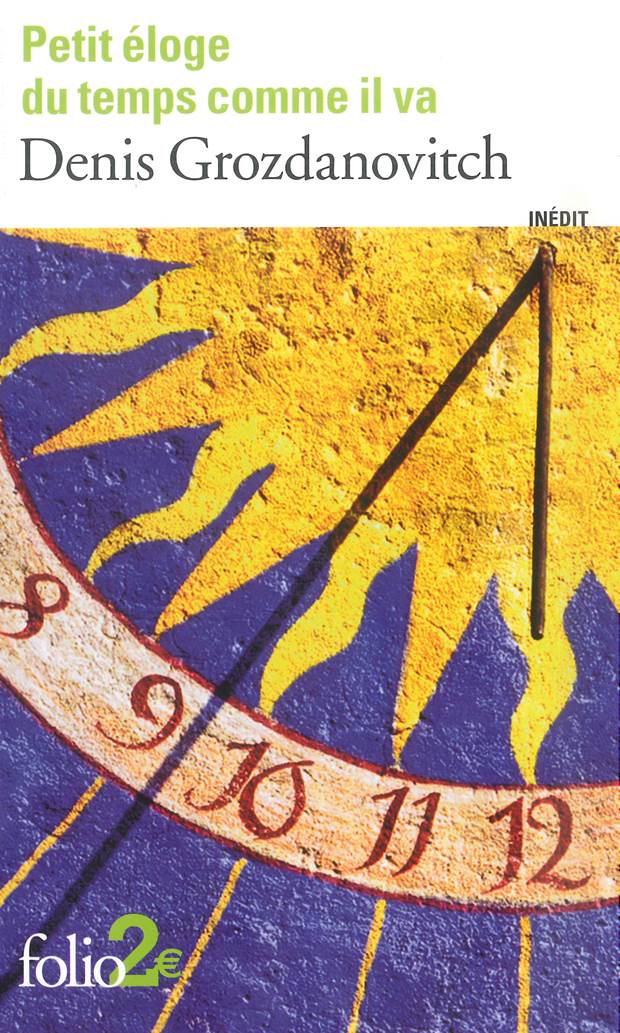Fugitive
Fugitive
Le narrateur est à la recherche d’un désir fondamental. Il connaît l’exigence commune des nantis, cet impérieux appel : se sentir vivre, totalement, aller jusqu’à plus que soi. Exigence de tomber amoureux et d’enflammer une vie. Dans cette vie satisfaisante, que l’on pourrait dire accomplie, manquent soudain le feu, l’énergie, la dévoration de l’être. « Le cœur qu’on se suppose… »
C’est l’objet de ce récit amoureux ; c’est l’objet cruel et commun ; est-ce plus que cela, ou est-ce moins ? Rien ne paraît ; pas de jugement. L’auteur cisèle le récit d’une passion avec une lucidité minérale que l’on compare à du Benjamin Constant.
Le narrateur est amoureux parce que la nouvelle femme, appelée « Ellénore », est fugitive. Un charme. Qu’elle soit ou non son genre, il la traque, « elle », « l’autre ». L’incarnation indiscutable du désir amoureux. Parce qu’elle semble d’abord lui échapper, ils s’engloutissent inéluctablement dans un feu charnel. Le roman célèbre avec eux joie vitale et énergie érotique, récit originel toujours recommencé.
Pendant ce temps, l’autre femme, appelée « L’Une », coexiste. Car il ne sera jamais question de sacrifier sa présence, encore moins de sacrifier le couple premier. Cette femme, qui est l’Une, devrait rester l’Unique.
Ellénore devenue prisonnière, le piège amoureux paradoxal se referme également sur le narrateur. Glissement inéluctable vers la froideur, la rancœur de la Prisonnière. Angoisse de perdre le feu intérieur, le nu intérieur. La force du désir se heurte à la perspective de la perte.
L’impossibilité de renoncer mène au deuil annoncé d’une passion fugitive… “Le cœur qu’on se suppose n’est pas le cœur qu’on a.” (1)
Nu intérieur, de Belinda Cannone, éditions de l’Olivier, 2015.
Gwenaëlle Ledot.
(1) Diderot, cité en épigraphe par Belinda Cannone
 « Ne regardez pas en vous-même, vous ne trouverez rien. »
« Ne regardez pas en vous-même, vous ne trouverez rien. »
Cette phrase du philosophe Clément Rosset, reprise par Annie Ernaux, fait signe et éclaire son œuvre. L’enjeu, dans ces entretiens de 2014, ne sera jamais de « parler de soi », ni même de « parler de ses livres »… Mais de jeter une lumière subtile et précise sur le projet d’écrire, et ce qu’il génère. Se projeter dans un lieu qui est un entre-deux. Entre-deux de lecture-écriture. L’entre deux cultures, pour un écrivain socialement « transfuge ». L’entre deux mondes : celui des faits quotidiens, et celui, tout à côté, où l’on construit le texte. Lisant Annie Ernaux dans ces entretiens avec Michelle Porte, on l’imagine créant sa bulle paradoxale ; la construction d’un édifice (elle parle d’une « maison »), pièce à pièce, un bâtiment textuel. Un lieu ouvert qui dialogue avec le monde « du dehors », auquel elle reste intimement et volontairement connectée : Cergy, des centres commerciaux, des collèges, des paroles et des rues. Le lieu des « Journaux extérieurs ». Le lecteur rappelle à lui Yvetot, village du passé et l’image d’une sœur ; puis Les Années, le petit chat mort dans la grande maison, et la silhouette puissante de la mère, encore.
« Ne regardez pas en vous-même… » Dans cet édifice s’amassent les pièces précieuses du « musée intérieur » qui, dit-elle, la constitue : les œuvres d’art, cinéma, peinture, qui construisent peu à peu la personne et le livre. Investissant un lieu autrefois sacré, l’auteur s’enferme dans sa bulle textuelle, et s’ouvre simultanément. Quand il s’agit de perdre le monde pour mieux le retrouver, dans l’architecture d’une réalité éclaircie.
« … vous ne trouverez rien. »
Annie Ernaux, Le Vrai Lieu, Entretiens avec Michelle Porte, Gallimard, Paris, septembre 2014.
Gwenaëlle Ledot.
 L’humour fou.
L’humour fou.
L’humoriste Pascal Fioretto se veut faire plume sérieuse. Ecrire un « vrai » livre et effacer l’amuseur à succès, le brillant pasticheur. Laisser derrière soi La Joie du bonheur d’être heureux, le Gay Vinci Code, Et si c’était niais… Cesser d’être potache pour revêtir le costume d’Ecrivain. Interroger la dynamique de création, se livrer à l’introspection, chercher çà et là le précieux matériau de l’écriture.
« Où irais-je, si je pouvais aller ? »
Enoncé à portée heuristique et hautement énigmatique, convoquant Samuel Beckett en tête de chapitre. Au hasard des pages, le lecteur croisera encore Alfred de Musset et Maître Gims, Héraclite et Virginie Despentes, Houellebecq et Lou Reed. Eclectisme, quand tu nous tiens… L’écrivain sérieux à peine sorti de l’œuf se lance dans les apories de la création littéraire, les angoisses page-blanchesques, les aurores sombres et les nuits stériles. Peine perdue. Chaque page, presque chaque ligne, est un petit délice (féminin quand pluriel) ; un petit sourire littéraire nourri de dérision.
Pas d’événements et peu de personnages, excepté l’heureux Marco et le savoureux Saturnin, « prof alternatif pour enfants en difficulté dans une école d’obédience Dolto ». Ce dernier, décroissant convaincu et prosélyte, volontiers sentencieux, balade ses certitudes sur « un vieux vélo hollandais qui couine ». Dans cet univers de rurbains s’immiscent Pascal Fioretto, auto-défini comme « parasite culturel désœuvré », sa mélancolie littéraire et sa page (souvent blanche, raturée, désespérante). L’auteur se remémore ses années de gloire, celles où l’on tutoie « l’ennui mortel des espaces culturels, des galeries marchandes et des cocktails offerts par les conseils généraux. » Jusqu’au moment où il décide, à l’instar d’illustres prédécesseurs (tels Salinger et Daft Punk), d’échapper au monde vertigineux de l’après-vente. Sous l’égide de Rilke et de Mort Shuman (selon l’humeur du jour), notre homme se lance donc dans une autre écriture. Pas si lointaine finalement, pas si différente…
Un condamné à rire s’est échappé, de Pascal Fioretto, éditions Plon, Paris, septembre 2014.
Gwenaëlle ledot.
Les aubes spirituelles
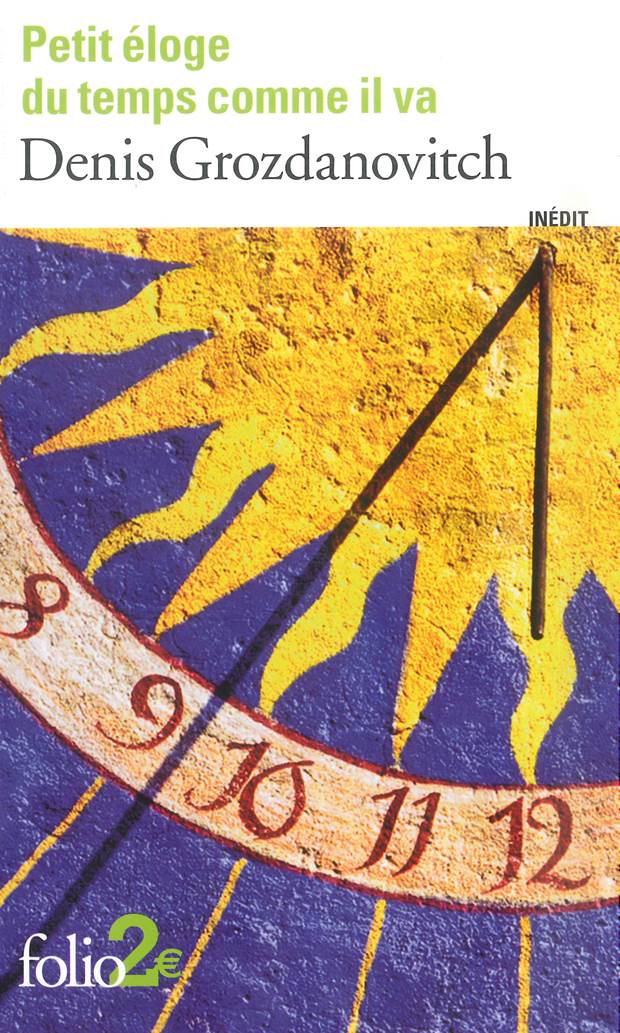
Comment saisir le temps, comment cueillir le jour ? Comment aborder ce texte de Denis Grozdanovitch, consacré au « temps comme il va » ? On imagine un lecteur installé à son aise sous une brise légère. Des bruits de feuillage. Quelques tomes de Proust à proximité et quelques pages relues : Jules de Gaultier et Schopenhauer, peut-être. C’est l’heure exquise et le temps retrouvé. Végétation et forêt se font garantes d’une certaine paix de l’âme : c’est le moment de se pencher sur la météorologie de l’esprit.
L’opuscule s’ouvre sur quelques mots surprenants, attribués à une vieille dame russe, tremplins de la réflexion :
Oui, messieurs. Il fait mauvais temps et nous attendons qu’il change. Mais il vaut mieux qu’il fasse mauvais temps que rien du tout et que nous attendions au lieu de ne rien attendre.
Il s’agit ici du temps qui va, inextricablement lié au temps qu’il fait. Au culte du Dieu soleil, l’auteur préfère décidément les nuances et mouvances météorologiques : l’asphalte mouillé des rues parisiennes, l’odeur sublimée d’un parc ou d’un jardin après l’averse. Ô, le chant de la pluie !
Endless rains, elles font renaître les souvenirs d’Angleterre, lorsque la pluie appelle la douceur du foyer ; un temps arrêté, celui, serein, de la lecture. Temps suspendu et par là même retrouvé. Endless rains : musique des mots, douceur de la mémoire.
Pour un cœur qui s’ennuie : quand le cœur s’ennuie, l’époque lui offre de petits écrans, de petits messages. La grande affaire contemporaine, c’est la vitesse et le réconfort addictif de l’immédiateté. L’esprit, le cœur sont entièrement absorbés par la machine. Engendrant une autre temporalité qui nous dévore ; rythmée par des objets qui nous demeureront fatalement extérieurs, mais insidieusement nous transforment. Qui nous éloignent de l’univers naturel, d’une nature animale, d’une très ancienne forme de spiritualité. L’auteur nous rappelle cette sentence de R. W. Emerson : « la mesure de l’homme est sa manière de saisir la journée. »
Viser la suspension du temps est largement illusoire, cependant. L’homme ne se vit lui-même que dans le flux et la projection. A chacun, alors, de reconnaître sa durée, personnelle et véritablement « appropriée ». Chaque instant prend un certain sens, écrivait Thomas Mann. Retrouver, envers et contre tout, contre l’époque présente et un malheur certes éternel, la saveur intrinsèque de nos heures.
« La rose
ne cherchait pas l’aurore :
presque éternelle sur sa branche,
elle cherchait autre chose.
La rose
ne cherchait ni science ni ombre :
confins de chair et de songe,
elle cherchait autre chose.
La rose
ne cherchait pas la rose.
Immobile dans le ciel
elle cherchait autre chose.»
(Federico Garcia Lorca, extrait de « Casida de la rose »)
Petit éloge du temps comme il va, Denis Grozdanovitch, Paris, Gallimard, « Folio 2 euros », août 2014.
Gwenaëlle Ledot.
« Dites, quoi donc s’entend venir
Sur les chemins de l’avenir
De si tranquillement terrible ? »
(Emile Verhaeren « La révolte »)

Quid du dernier texte de Milan Kundera ? On en dira la légèreté, puisque le titre et l’auteur nous y invitent. Puisqu’une plume se pose, iconique, au milieu du récit. On parlera de Ramon, qui flâne dans le jardin du Luxembourg, observe et ne décide rien. On pensera à son ami D’Ardelo qui s’invente, étrangement, une grave maladie. A tous les personnages de cette ronde romanesque, qui se croisent, se parlent ou non, et jamais ne se comprennent :
« Oui, c’est comme ça, dit Ramon. Les gens se rencontrent dans la vie, bavardent, discutent, se querellent, sans se rendre compte qu’ils s’adressent les uns aux autres de loin, chacun depuis un observatoire dressé en un lieu différent du temps. »
Chaque personnage porte sa théorie, sur tout, sur rien… Chacun a son anecdote. Tous entrent dans la danse enfantine de l’existence : dépourvue de pesanteur, car dépourvue de sens.
De cette ronde se détachent plusieurs temps graves : une tentative de suicide qui se transforme en meurtre. Une mère qui refuse son fils. Un écrivain (Alain) qui finalement n’écrira pas. Ce sera sa plus grande gloire, « la gloire du très grand poète qui, grâce à son humble vénération de la poésie, avait juré de ne jamais écrire un seul vers. »
Le personnage de Charles est absorbé dans la contemplation d’une plume qui volette ; devrait-il y lire l’arrivée imminente d’un ange ? Probablement pas. Le vertige des signes, du sens désespérément traqué, d’un monde dédoublé, est pour les hommes une tentation permanente. « Chacun s’entoure de ses propres signes comme d’un mur de miroirs qui ne laisse filtrer aucune voix du dehors. »( Plus de fêtes galantes.
Ce monde fragmenté se reflète dans les yeux de chaque personnage comme dans un prisme isolé. Il n’en restera que des miettes, ou des brisures. Reste aux hommes un monde résolument non-signifiant. Reste à ponctuer ce désarroi tranquille par des rires :
« Le monde des adultes éclate de rire. Le monde des adultes sait bien que l’absolu n’est qu’un leurre, que rien d’humain n’est grand ou éternel… »(
La ronde romanesque ne deviendra pas valse tragique. Ce que portent les petites icônes du récit (plume, nombril, armagnac ou perdrix), c’est la résistance têtue du réel et l’absence d’autre chose. L’absence métaphysique. L’absence du double :
« Je suis autre et moins que moi-même, ce qui, en définitive, ne mérite pas mieux qu’un éclat de rire, mais le mérite pleinement. »(

La fête de l’insignifiance, Milan Kundera, Paris, Gallimard, mars 2014.
Gwenaelle Ledot.
(1) M. Kundera, Le livre du rire et de l’oubli, Paris : Gallimard (Du monde entier), 1979 - Nouvelle édition revue par l’auteur en 1985 / Gallimard (Folio), 1987.
(2) M. Kundera, La vie est ailleurs, Paris, Gallimard (Collection Blanche), 1973 - Nouvelle édition en 2008
 Chroniques 2014, Romans français
Chroniques 2014, Romans français
 emile verhaeren, fete de l'insignifiance, francois ricard, gallimard, kundera, la fete de l'insignifiance, la revolte, la vie est ailleurs, le livre du rire et de l'oubli, livre du rire et de l'oubli, milan kundera, vie est ailleurs
emile verhaeren, fete de l'insignifiance, francois ricard, gallimard, kundera, la fete de l'insignifiance, la revolte, la vie est ailleurs, le livre du rire et de l'oubli, livre du rire et de l'oubli, milan kundera, vie est ailleurs
« Les voix, chère Marceline… »

« Les voix, chère Marceline, ce sont les fleurs de l’éternel mises dans votre bouche ». Le premier chapitre, tel un chant qui s’élève, concentre la saveur du texte. La limpidité de l’écriture et le flux des mots portent les couleurs de la vie. Le rose sera destiné à la poétesse Marceline Desbordes-Valmore : la grâce intacte de son œuvre émerge, en floraison, au cœur d’un voyage froid. La « femme noyée de bleu » de Vermeer lit une lettre pour l’éternité, nichée dans son tableau, réfugiée dans son rêve d’amour sans fin. Les clochettes des campanules garderont le même bleu, la feuille de buis son vert sombre. Quelques pages plus loin, une larme, « plus précieuse qu’une perle », est l’évocation d’une souffrance translucide.
« Le cœur ignore le temps » : car la vie contient aussi la perte sanglante de l’être aimé, l’organe sanguinolent qui se déchire tous les jours. Rouge à l’infini.
Dans ce long deuil, l’auteur a choisi résolument de jeter un peu de lumière. On ignore si cette aurore fragile va persister.
Des bouquets de mots, des fleurs de cerisiers ; des anges écarlates, et des yeux d’encre. « Nul n’a jamais écrit ou peint, sculpté, modelé, construit, inventé, que pour sortir en fait de l’enfer », écrivait Antonin Artaud. Christian Bobin semble faire tout à la fois : sculpter des mots et peindre de petits soleils. Modeler une fleur, un animal, et rappeler à lui les plus grandes voix. Ronsard ici, Ernst Jünger un peu plus loin, et la pureté violente et fiévreuse de Kierkegaard ; ou encore Hölderlin, « mille fois mort avant sa mort ». Christian Bobin chante, lui aussi, sans ignorer la chute des cœurs. Ceux qui ont quitté, abandonné, avant les autres. Ceux qui sont perdus, et ceux qui vont briller. Les mêmes, peut-être.
« Tout donner, tout perdre, et qu’on n’en parle plus. »
Gwenaëlle Ledot
La grande vie, de Christian Bobin, Paris, Gallimard, janvier 2014.
« Seul l’art m’agrée, parti de l’inquiétude, qui tende à la sérénité. » (Gide)

Avec une curiosité sereine, nous ouvrons ce petit livre : Cinq méditations sur la mort (autrement dit sur la vie). Car nous connaissons bien l’œuvre de François Cheng, le thème du dialogue qui ponctue ses textes et son écriture limpide. Ses essais, réflexifs et profonds, des romans au lyrisme apaisé (Quand reviennent les âmes errantes en 2012) nous accompagnent depuis quelques années déjà.
L’avant-propos de l’éditeur Jean Mouttapa annonce pour ces Méditations une conception alternative de l’existence et une réflexion « en spirale ». Ce qui est tout à fait exact, à condition de ne pas négliger le fait suivant : François Cheng se considère comme un « passeur » entre deux cultures. Et pour étayer sa réflexion sur la vie et la mort (liées), il convoque aussi bien l’intuition du Tao que les poèmes de Keats et Shelley.
L’objet des textes : faire toucher du doigt le mouvant de l’existence, le flux de la vie qui porte aussi la mort.
« Oui, c’est cela, la vie : quelque chose qui advient et qui devient. Une fois advenue, elle entre dans le processus du devenir. Sans devenir, il n’y aurait pas de vie ; la vie n’est vie qu’en devenant. Dès lors, nous comprenons l’importance du temps. C’est dans le temps que cela se déroule. Or le temps, c’est précisément l’existence de la mort qui nous l’a conféré ! » (1)
Cette pensée trouve un écho chez R. M. Rilke, dont la poésie touche intimement François Cheng : l’individu peut lire en sa propre mort le prolongement de lui-même, le prolongement du mouvement de sa vie. Tel est le sens porté par ce vers de Rilke :
« Seigneur, donne à chacun sa propre mort. »
L’auteur fait sienne cette pensée, qui rencontre, très heureusement, certaines philosophies orientales :
« Par la suite, Rilke élargira sa vision. Mais d’ores et déjà, nous remarquons une singulière coïncidence : l’intuition du poète correspond de près à la grande leçon dispensée par Lao-zi dans le Livre de la Voie et de sa vertu. Lao-zi affirme, au chapitre 25, que la marche de la Voie est circulaire. » (2)
Bonheur de la coïncidence. Etonnante convergence qui rapproche la plus ancienne pensée chinoise du poète allemand.
« Rilke ne connaissait pas le taoïsme. En tant que poète de langue allemande, il fut d’abord marqué par les grandes figures de la poésie germanique : Goethe, Hölderlin, Novalis, Heine, etc. »
Et traversant la souffrance amoureuse, Goethe, comme Rilke, comme Hölderlin, ont exploré une voie différente, appelée « L’Ouvert ». Un « double royaume » qui unit en son sein perceptions de la vie et de la mort. L’image qui s’impose entre les lignes fluides est un cheval blanc qui court, réminiscence des Sonnets à Orphée : icône animale, libérée des limites de l’existence perceptible.
« L’animal libre a toujours son déclin derrière lui ;
Devant lui, Dieu. Quand il avance, c’est
Vers l’éternel, comme coule une source. » (3)
Ce regard nouveau suggère d’envisager la mort, non comme une fin absurde, mais comme le fruit de notre être. Qui saura rejoindre, peut-être, « le chant de la haute enfance ».
« La vie engendre la vie, il n’y aura pas de fin. »
Le véritable exploit littéraire, le grand talent de François Cheng se révèle un peu plus loin – troisième méditation - dans cette faculté à dire l’humain, le réel, jusque dans la description de l’insoutenable. Qu’il appelle sobrement « le mal », et qu’il décrit sans détours, comme immonde inhumanité. Et de réaffirmer, au cœur même des enfers inventés par les bourreaux, l’essence humaine et la flamme de vie des victimes. Elle est retrouvée, célébrée par la phrase immémoriale.
« La vie engendre la vie, il n’y aura pas de fin. »
Gwenaëlle Ledot.
Cinq méditations sur la mort, autrement dit sur la vie, de François Cheng, Paris, Albin Michel, octobre 2013.
« Mais quelle est mon erreur, et que de soins perdus… »

C’est un portrait subtil et délicieusement cynique que livre Monica Sabolo. Celui, personnel et universel, de l’être aimant en ingénu. Celui d’une petite Bérénice contemporaine : l’histoire éternelle d’un amour loupé, peut-être jamais advenu. Une jeune femme découvrant la résistance, pour mieux le dire l’ « idiotie », du réel.
Avec une curiosité empathique, on verra l’héroïne progresser douloureusement sur son chemin funeste, prétendant tout d’abord ignorer les signaux manifestes du fiasco amoureux :
« Il est scientifiquement notable, pour ne pas dire émouvant, de relever les éléments précurseurs de la catastrophe, ces signes intrinsèques qui scintillent comme autant d’avertissements écrits en lettres de feu et que l’individu traverse, primesautier, avec le sourire innocent d’un enfant qu’on mène à l’autel sacrificiel. »
Sur cette page, une photo du Titanic quittant Southampton.
Le réel ainsi que son passé rattrapent la narratrice. Difficile d’ignorer les faits. Illusoire de déjouer le destin. Décidément, le réel est résistant.
Consciencieusement, son relevé égrène les espoirs fallacieux. Toutes les impasses déjà connues, largement pressenties. Monica Sabolo compose avec un soin délicieusement masochiste l’herbier toxique des amours vénéneuses : beaucoup de mails et SMS. Des photos, également (d’un briquet, d’un gant ou d’un carnet). Autant de petites traces ontologiquement inutiles. Autant de signes annonciateurs du Rien.
« En dépit de l’altération de ses facultés réflexives, l’être aimant est traversé d’une intuition aiguë : tout cela ne durera pas, voire pire, tout cela n’a pas lieu. »
Entre certitude du désastre et espoir vacillant, nous suivons les oscillations d’un cœur bientôt haché. Chanson sanglante et aigre de l’amour perdu. Refrain rebattu du vide annoncé.
« Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous… ? »
Dans un crescendo pathétique et nauséeux, la perte pressentie, inéluctable, se résout dans l’élaboration d’un cahier exhalant « le parfum macabre de la déchéance ». Pages et textes réduits en pourriture annoncée.
« Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts. »
L’être aimant tel qu’en lui-même : figure de l’Ecorché. La photo d’un organe sanguinolent au cœur du livre surprend le lecteur. Ironique comme la politesse du désespoir. Elle figure là, icône grand-guignolesque, la perte hémorragique de l’Autre. Révélant la béance de l’Etre.
Tout cela n’a rien à voir avec moi, de Monica Sabolo, éditions Jean-Claude Lattès, septembre 2013.
Gwenaëlle Ledot.
 De l’extérieur.
De l’extérieur.
Né à l’extérieur, Django Reinhardt, prince du jazz… Baptisé par l’esprit manouche à l’âge de trois ans, lors d’une fête endiablée qui ressemble à un rituel, il prend vite sa place (flamboyante) dans l’univers de la musique. De la Mare aux corbeaux jusqu’à Carnegie Hall, « le jazz avait chaussé ses bottes de sept lieues. » : grâce à son jeu, son génie et son charisme, Django parcourt le monde comme son royaume. En restant obstinément à côté, ou bien au-dessus, des gens et des choses ; traversant victoires, amours et succès. Sifflotant et insaisissable, éternel voyageur. Django, pour qui « l’enfer, c’était dedans. »
« Ne soyez pas hostile aux étrangers, de peur qu’ils ne soient des anges déguisés. » (Yeats).
Eclairée par ce personnage virevoltant, toute une époque renaît : c’est le Paris des années trente, des ruelles pentues du Sacré-Cœur aux jardins du Moulin de la Galette. « Un p’tit jet d’eau, une station de métro, entourée de bistrots : Pigalle. » Et les cabarets : la musique de l’artiste, des sons qui éclatent, comme une drogue… Dans l’ivresse inoubliable des jam-sessions, étourdissantes, effrénées.
Mais certainement, l’époque importe peu. L’essentiel, résolument intemporel, se mire dans les phrases de Salatko, vibrants échos des cordes de Django :
« Le ciel d’avril semblait passé à la toile émeri. L’air avait le coupant et la pureté de l’éther. Des plaques de givre encroûtaient les pavés. »
Folles de lui ? Peut-être… Sans doute. Là encore, peu importe ; tout est suspendu à une autre dimension, celle de l’ailleurs, s’échappant éternellement sous les doigts de Django. Folles de lui, toutes ? Oui, mais c’est une figure majeure qui se détache, telle une symphonie : la surprenante Maggie, qui permet l’éclosion et l’avènement de Django. L’unique et l’héroïque, qui vivra dans l’ombre, et mourra pour la lumière.
Folles de Django, d’Alexis Salatko, éditions Robert Laffont, septembre 2013.
Gwenaëlle Ledot.
« C’était à Megara, faubourg de Carthage… »

L’histoire commence à Carthage, époque d’Augustinus, ou saint Augustin. Son ancienne compagne, Elissa, se souvient : « Un siècle s’achève, un monde s’effondre. Toi, tu écris tes Confessions. »
Et c’est un long deuil qui commence. Le récit d’une mort intérieure.
Oscillation entre un présent suspendu et le passé dont l’héroïne tisse la mémoire, tire les fils : Elissa a quarante-cinq ans au début du récit, et vit chez un couple d’amis à Carthage. Bien avant les conquêtes barbares, avant l’arrivée sur la ville du peuple de ténèbres… Elle rappelle à elle les figures et les moments qui hantent une vie perdue : un passé errant où elle a été répudiée par son amant, le grand saint Augustin, pas encore figé par l’aura de la postérité. Elissa s’adresse à Lui, l’orateur, l’évêque, le présent-absent :
« Est-ce que j’existe encore dans ta mémoire, ton étonnante mémoire ? Une ombre tremblée ? Une erreur de personne ? Un objet sans importance largué en chemin ? »
Le grand homme l’a quittée, il y a fort longtemps déjà, et leur fils s’en est allé, dans la nuit et la neige. Le vide depuis guette Elissa, nouvelle Didon ; hantée par le constat renouvelé de la fuite :
« Les hommes fuient. Loin de la mère. Loin de la grande amoureuse. Peut-être les confondent-ils ? »
Le texte semble écrit en mémoire de Megara, d’Enée, d’Ulysse et Jason… Renvoie le reflet pourpre des guerres puniques et le reflet mordoré d’Alexandrie : aussi, un univers entier s’élève, sous une lumière crue.
Sous cette lumière crue, Elissa-Didon est blafarde. Pallida morte futura, écrivait Virgile. Pâle déjà d’une mort future.
« Ne te tracasse pas, je suis déjà morte. »
Dans l’ombre de la lumière, de Claude Pujade-Renaud, Paris, Actes Sud, janvier 2013.
Gwenaëlle Ledot.
 Fugitive
Fugitive